|
L'ÂME DES BOEUFS SERBES
par
GEORGES NIVAT
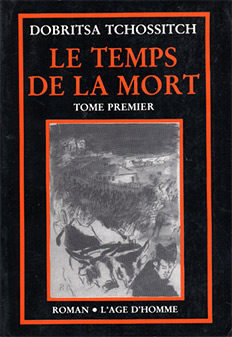
Le Temps de la mort / Vreme smrti
Il existe en Europe un immense romancier que l’Europe ne veut pas reconnaître, c’est-à-dire ne veut même pas lire. Il est serbe, il s’appelle Dobritsa Tchossitch. Il n’est pas grand parce qu’il est serbe, ni parce qu’il est, avec l’Albanais Kadaré, un des derniers écrivains vivants qui ont été malaxés par la grande utopie communiste et le grand hachoir humain qu’elle est devenue inexorablement. Il est un immense écrivain parce qu’il est le dernier des créateurs de grands romans épiques. L’épique meurt avec lui, l’épique est mort. Il nécessite une confrontation entre le vivant et le mort, l’individu et le collectif, l’homme et les dieux, le vouloir personnel et l’Anankè de la tragédie grecque. Tchossitch a su mettre en confrontation ces grandes et insolubles oppositions. Il la pu le faire parce qu’il est serbe et que la mort d’un destin national a été vécue par la Serbie plus tard que par les autres peuples de l’Europe, entre Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, titisme, bagne pour les staliniens antitistes, et écroulement de la Yougoslavie. Seul un grand corps à corps avec l’histoire, un combat à la vie et surtout à la mort avec l’histoire peut engendrer de l’épique. C’est ce que nous donne Tchossitch.
Superbement indifférent aux prêches sur « la mort du roman » (tout comme Soljenitsyne), Tchossitch tisse et trame une sorte de texte-essaim qui bourdonne, fanfaronne, gémit. Au centre de l’essaim – la reine, qui est la Mort. C’est elle qui malaxe le tissu de vie que le romancier épique a emmêlé : paysans de Prerovo, le village mythique, familles bourgeoises de Belgrade ou de Nich, parlementaires, jeunes gens s’égosillant en querelles politiques. Ce sont eux, les jeunes gens qui sont au cœur de l’essaim, parce que c’est eux qui vont mourir. Rarement l’âme, le désespoir, la naïveté, la présomption des jeunes hommes ont été si magnifiquement appréhendés. Il n’y a pourtant rien de juvénile dans ce monde de jeunes adultes pas encore tout à fait libérés de l’irresponsable jouvence. Ils se saoulent, ils jouent aux cartes, ils maudissent les rois, ils attendent la mort, comme des hommes adultes. Mais précisément, c’est leur extraordinaire et violente, instantanée métamorphose de grands enfants en hommes vieillis par la mort qui crée la fascination la plus profonde de ce livre.
Le reste, la gouaille, le chaos, la solitude du Commandant en chef, la lumière des vergers (surtout les prunelaies, les merveilleuses prunelaies de Prérovo !), la mer de brouillard, les amoncellements de cadavres et la ronde insoutenable des chevaux entravés que fauche une mitrailleuse allemande, la flûte du soldat Dragoutine, la canne du clairvoyant et solitaire misanthrope Voukachin Katitch – éternel opposant – tout cela, c’est le rucher de l’essaim, un rucher qui a nom Serbie, et qui chancelle et va s’écrouler.
Le cheval moreau d’Adam, Dragan, a presque plus de présence que le général Michitch. L’indomptable pur-sang, rétif comme la Serbie, dont la perte rendra inconsolable Adam, le poussant quasiment à déserter pour le retrouver. Il vaut plus qu’un royaume, plus que le cheval blanc de l’imposteur polonais, le Faux Dimitri, dans Boris Godounov, il vaut tout le reste du vivant. Mais les colverts ou les canards sauvages qui s’abattent sur l’effroyable tournis des chevaux massacrés n’ont pas moins de mystérieuse présence. La guerre concerne autant le monde animal que le monde humain, peut-être même plus… Le silence de la Serbie martyrisée par l’expédition punitive du général autrichien Potiorek, c’est avant tout le grand, l’incroyable silence animal. Quand la guerre est en l’homme, il se fait également en lui un silence effroyable.
Le journal de l’étudiant bigleux Ivan Katitch est un magnifique fragment de vie intellectuelle qui vacille et se recompose dans l’ensauvagement simplificateur de la guerre. La mort, c’est aussi bien celle du frère d’arme que la sienne propre. Il se fait quelque chose d’impossible à distinguer, une sorte de mort jumelle, des morts soudées entre elles. Ivan écrit en songeant à Bogdan, son frère d’arme qui vient de disparaître :
Nous n’allons quand même pas mourir tous les deux. Se souviendra-t-il de moi, est-ce que je le mérite ? Dans son combat pour l’avenir, ne pourrais-je pas être son chagrin dans une certaine solitude ? être un chagrin pour un ami, cet espoir change pour moi jusqu’au sens de la mort.
Et si Le Temps de la mort est un sombre poème, hymne et lamentation à la fois, pour les jeunes gens, c’est aussi parce qu’il est la forte et décidée révolte du fils serbe contre le père serbe. Une révolte qui sourd grandit et vainc l’amour des pères, l’amour du village, l’amour de Prerovo, une révolte dont le journal de l’étudiant caporal-chef Ivan contient, dans ses adresses à son père, des fragments explosifs comme une grenade à fragmentation.
La Serbie, pays séculaire, sept siècles courbé sous le joug ottoman, peu à peu relevé, tient debout, en apparence, par l’amour des pères, le respect des ancêtres, tout ce qui, en Europe, fait d’elle un pays archaïque, méprisé autant qu’admiré. Les jeunes gens réunis sous le fléau de la mort, entre la rivière Drina et les monts du Suvobor, exècrent leur naissance. Comme Cioran, ou comme Kierkegaard, ils désavouent le père qui les a engendrés, l’amour de leurs parents qui leur a donné naissance. Ivan va jusqu’à exécrer le Père, Dieu le Père, qui a sacrifié Dieu le Fils. Sacrilège et désespéré, il écrit dans son Journal : « Le Christ n’a pas réussi en tant que religion parce qu’il a été conçu en tant que fils. » Et Ivan Katitch, non moins révolté que son homonyme Ivan Karamazov, ajoute avec une incroyable insolence : « L’orgueil et la dureté, c’était et cela reste mon appréciation de Dieu le Père. » Dans la Serbie orthodoxe, va-nu-pieds et païenne, cette révolte est le ferment, elle est le noyau d’énergie de l’élémentaire serbe. Vénérer et récuser le père. Le récuser parce qu’on le vénère.
Tchossitch construit avec le général Michitch une magnifique figure de soldat paysan, de Napoléon issu de la glèbe, il le pétrit de ses mains de sculpteur à la Rodin, il l’exhausse, il en fait la figure tutélaire du Père qui prend sur lui le terrible poids du sacrifice des Enfants. Tchossitch le conduit jusqu’à la superbe scène finale, lorsque, revenu dans son humble maison natale où l’occupant « fritz » campait et souillait tout encore deux jours auparavant, le Père vainqueur et le père vaincu par ce sacrifice de tant d’Isaac trace dans la cendre des traits énigmatiques qui disparaîtront dès qu’on balaiera les cendres de l’âtre. Qu’est-ce que ce graffiti mystérieux ? dit-elle comme la main qui écrivit toute seule sur le mur du palais du roi Belchassar, fils de Nabuchodonosor, « Mené, Tekel, Parsin", ce qui veut dire comme l’interpréta Daniel le voyant : « Compté. Pesé. Dépecé » ? Une pesante prédiction semble en effet surgir des cendres de cette misérable et auguste maison paysanne.
L’arbre est aussi une des métaphores géantes qui bâtissent ce poème, on y trouve l’homme arbre, l’arbre dans le crépitement des combats, l’arbre refuge du vivant et l’arbre simple repère pour les tirs, l’arbre qui a brûlé par forêts entières dans l’âtre de l’antique demeure paysanne… Le paysage lui aussi entre en branle tout entier, se convulse littéralement. Le Rudnik, le Rajac et le Suvobor entrent en collision ; tout le relief enneigé, tordu par la tourmente, aveuglé par la neige en rafale entre dans une sorte de tragique sarabande. C’est la nature entière qui souffre, qui hurle, qui avance et qui recule comme la forêt de Birman.
Bien sûr, Tchossitch dialogue avec Tolstoï. De bout en bout, presque à bras-le-corps. Non qu’il ait fait un calque. Mais parce que le type de bataille qu’il empoigne et sculpte dans sa phrase gouailleuse, tendre et tendue, c’est le type de bataille qui a commencé avec Napoléon. Les stratégies à l’échelon de 10 000 hommes, le dialogue artillerie-infanterie, les assauts à main nue après la boucherie à cent mètres les uns des autres. Pas encore de blindés, pas encore d’aviation. La baïonnette achève l’ouvrage du canon et du fusil. La guerre sanglante, déjà sans héros, mais pas encore dépersonnalisée. Quiconque veut empoigner cette réalité humaine à dix mille têtes, dix mille corps, dix mille cœurs doit se mesurer à Tolstoï. Tchossitch se mesure à Tolstoï. Le grand-père Katitch connaît par cœur Guerre et Paix. Tous le connaissent. C’est le grand roman frère, et c’est le peuple grand frère. Mais, comme Soljenitsyne dans Août 14 (et très différemment, plus puissamment), Tchossitch corrige au passage.
Tu crois sérieusement que Bolkonski, mortellement blessé, a été ému par le bleu infini et les nuages bleus qui passaient ?
La puanteur, les excréments, les viols et les vols, la lourde cruauté humaine l’emportent, s’imposent et lestent la prose de Tchossitch comme un fardeau de boue, de fange, et avant tout de peur. Cela Tolstoï l’avait vu dès les Récits de Sébastopol, mais n’avait pas voulu en faire le cœur de son récit.
« On subsiste et l’on vit aussi grâce à la peur », écrit Ivan Katich dans son journal. Il faudrait apprendre aux hommes la peur. Elle est leur alliée…
L’hiver du Suvobor est bien plus terrible que l’hiver chez Tolstoï. Quelque chose l’apparente à l’hiver de Chalamov, à ces blocs de froid absolu, à ces assauts du gel qui congèlent jusqu’au tréfonds les âmes humaines. Entre la Kolyma et son goulag torturé par le froid et par les truands et ce Suvobor où errent des fantômes vidés de leur vie, où l’ère glaciaire semble à jamais revenue, où l’homme vidé de soi ne se sait plus soi-même – il est une comme une parenté, une historique connivence. Tchossitch décrit l’hiver 1914, mais il écrit après la Kolyma, une Kolyma que lui, le communiste dissident, a su deviner. C’est par l’absurde et par l’ignoble que l’humain peut être sauvé. Danilo Protitch écrit à ses parents et revoit la scène : une tourmente de neige « dont on ne trouve pas la description même dans les romans russes », et où l’on mourait de gel et de faim obstinée. Deux Fritz agitaient dans cet ouragan du froid deux clochettes pour faire croire aux affamés qu’il y avait là deux « béliers vivants » pour les attirer, les capturer ou les tuer. Danilo a descendu les deux « béliers vivants ». L’épisode est grotesque, humiliant. De faux béliers attirant à la mort des hommes moutons.
Ces épisodes où l’homme contrefait l’animal ne sont que dérision. Car le monde animal est meilleur que le monde humain, bœufs et chevaux serbes, battus, harassés tirent dans un océan de boue et de neige le peu de « pain de munition » et d’obus qui, alliés à l’incroyable obstination de l’homme serbe, feront tourner la roue de la guerre. L’ordonnance du général Michitch, ce simple paysan Dragoutine, qu’il a sauvé d’une bastonnade féroce que lui infligeait son supérieur, dit au général, devenu maréchal :
Quant à cette immense bataille serbe, je vous le dis du fond du cœur, ce sont les bœufs qui nous ont sortis d’affaire, Monsieur le Maréchal […]. Si cela est possible, quand dans votre ordre vous féliciterez l’armée, mentionnez aussi les bœufs serbes. Le bétail serbe, Monsieur le Maréchal. Pour l’amour de Dieu. Et de la justice. J’ai vu beaucoup d’hommes sans âme, mais je n’ai jamais rencontré de bœuf qui n’ait eu une âme.
On songe en aspirant le souffle violent de la prose de Tchossitch à l’épître de Paul aux Romains : « Toute la création ensemble soupire et souffle » (8-22).
De loin ceux qui n’ont pas lu Tchossitch et n’ont de lui qu’un vague souvenir de lutte nationaliste, de « mémorandum de l’Académie serbe » s’imaginent qu’il est un propagandiste serbe. Qui n’est pas entré dans ce puissant transfert d’espace, de temps et de souffrance qu’est Le Temps du mal de Dobritsa Tchossitch ne peut avoir idée de la mesure de cet écrivain. Ce ne sont pas les adversaires, ce ne sont pas les « autres » qui chuchotent « Delenda est Serbie », c’est la terre serbe qui se cabre sous ce chuchotement, sans que l’on sache, à hauteur de cette épopée si les Caton auront raison ou pas. La Serbie dans les poèmes narratifs de Tchossitch n’est que le souffle, le premier et le dernier souffle d’une poitrine humaine écrasée, torturée, à qui a été volé le temps, le temps de vivre, le temps de respirer, le temps de sentir l’âcre et délicieuse senteur des prunelaies à l’été déclinant.
Il y a beaucoup de têtes humaines sur cette funeste terre qui valent moins qu’un bœuf ou un beau fruit. Or le mal engendre le mal. L’aubépine ne donne pas de pommes.
In : Georges Nivat : Vivre en russe, Editions l’Age d’homme, 2007, p. 446-449.
> Le Temps de la mort - extrait
> Eloge de Dobritsa Tchossitch
> La roue épique de Dobrica Ćosić
> Oeuvres traduites de D. Tchossitch / Ćosić
> Dossier spécial : la Grande Guerre
|