|
UNE DOUBLE MORT, EN EUROPE
par
NORBERT CZARNY
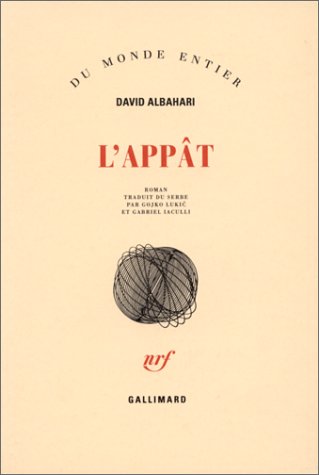
David Albahari : L'Appât [Mamac]
trad. du serbe par Gojko Lukic et Gabriel Iaculli, Gallimard, 1999, 156 p.
Lorsqu'on regarde la couverture de L'Appât, premier roman de David Albahari publié en France, une expression surprend, " traduit du serbe ". En d'autres temps on aurait écrit, " traduit du serbo-croate ", une fois le roman lu, la surprise laisse place à la révolte. Peu de romans sont plus "yougoslaves " que celui-ci, écho d'une utopie disloquée, disparue, terre et langue mêlées. Et sur ce vide tragique qui le rend d'abord incapable d'écrire, le narrateur de L'Appât bâtit un superbe récit.
Récit d'une seule coulée qui commence par un alinéa page 9 et se termine page 151 comme une bande magnétique se dévide jusqu'à son terme. Le narrateur vit ou plutôt "flotte à la surface de la vie " dans une périphérie de ville, sans véritable centre ni place. Il s'est réfugié dans ce nord-ouest canadien peu après le début de la guerre en Bosnie. Il n'a rien emporté sinon trois bandes magnétiques sur lesquelles il a enregistré la voix de sa mère avant qu'elle ne meure. Il a du mal à les écouter car le vieux magnétophone que lui a donné son ami Donald crisse, s'arrête, déforme cette voix qui parie en une langue désormais perdue : "en deux ans, on peut oublier une langue, en seize ans elle peut disparaître de la face de la terre, et quand elle disparaît, nous disparaissons aussi".
Cette peur qui l'étreint, le narrateur tente de l'expliquer à Donald mais leurs échanges se résument souvent à l'opposition entre deux cultures et deux incompréhensions. Le narrateur est indécis, incapable d'adhérer "ni au présent ni au passé, ne parlons même pas de l'avenir". Pour Donald, celui qui doute reste à jamais au pied de l'échelle ou sur le premier barreau. "La perception que chacun a du temps et de l'espace est également antinomique. Un simple symbole est révélateur : le narrateur aime le café bosniaque, encore plein de son marc. Pour lui comme pour sa mère, "celui qui boit du café sans dépôt existe seulement au présent". Donald se sent libre dans un espace sans limite, le narrateur se heurte à tous les angles bien qu'il dispose, en son exil, de plus de place que dans sa maison de Zemun.
Une autre voix, singulière, se mêle à celles des deux hommes, celle de la mère. Elle est morte au "bon moment ", "avant que l'histoire, qu'elle croyait irrévocablement achevée, ait ressuscité dans toute sa splendeur". Cette renaissance évoquée avec ironie est celle d'une histoire comme menace, pour reprendre le mot de Kundera, et dans le cas de la mère, cette menace n'a cessé d'être extrême.
Née Serbe en Bosnie, elle s'est convertie au judaïsme en 1938 et a décidé de vivre à Zagreb, dans une Croatie bientôt dirigée par les Oustachis.
Ma vie était devenue une réponse à la vie d'un homme
que je n'avais jamais vu
Elle a vu son premier mari partir pour les camps, a épousé le père du narrateur et élevé les deux enfants qu'elle a eus de lui dans le judaïsme, malgré la demande expresse du premier époux d'éduquer leurs enfants (entre-temps décédés accidentellement) comme Serbes et non comme Juifs. Le narrateur est le produit de cette histoire folle : "Ma vie était tout à coup devenue une réponse à la vie d'un homme que je n'avais jamais vu ; j'existais afin que lui, malgré l'inconcevable projet d'extermination de son peuple, pût continuer d'exister".
Héritier de ce passé, le narrateur cherche un moyen de le transmettre, de le rendre compréhensible. D'abord en le rendant sensible à Donald à travers une carte de son ex-pays : "si tu ne comprends pas ce que représente ce parcours [...] qui est une descente à la fois réelle et symbolique, et aussi cet autre parcours, intérieur, où une âme, tout en s'interrogeant sans cesse et en passant d'une identité à une autre, alors tu ne pourras jamais comprendre non seulement cette femme, ma mère, mais tout ce dont est fait ce coin du monde, et si une seule partie du monde échappe à notre entendement, alors le monde entier nous échappe". Mais Donald comprend mal. "[Il] ne se retrouvait pas très bien dans ces réflexions où s'enchevêtraient les temps historiques et les temps grammaticaux, la terre et le sang, les frontières et les partages". Au point qu'en une scène très forte du roman, il froissera la carte de la Yougoslavie pour amener le narrateur à préférer le monde réel à ce "monde de papier".
Et puis, comme un leitmotiv impuissant revient dans le monologue du narrateur un " Si je savais écrire" qui traduit son véritable désir et dont la réalité est sans doute le roman que nous lisons. Face à Donald, l'écrivain qui a des idées claires sur le "style", qui sait comment bâtir un récit, le narrateur jusque-là porté sur la poésie, s'engage dans l'écriture d'un récit et ce sera le contraire de ce qu'imagine le pragmatique ami canadien : un texte " flottant entre l'histoire, la chronique, le destin personnel et un bavardage poétique", un texte n'ayant "aucune intention" selon le goût du narrateur qui lit Schulz, Kiš et Nabokov, mais embrassant l'univers dans sa complexité, sa diversité. Un récit à son image, à l'image de sa mère et de ce qu'étaient ces confins d'Europe qui n'existent plus.
On rêverait, pour le roman de David Albahari d'un destin semblable à celui du Liseur de Schlink. Non que les deux romans se ressemblent. Ils ont en commun, en empruntant des formes très différentes, de dire la tragédie de notre continent en ce siècle, à travers des êtres qui sont à son image.
Paraît également Le Livre bref de David Albahari, trad. du serbo-croate par Ljiljana Huibner-Fuzellier et Raymond Fuzellier aux éditions Balzac-Le Griot.
In La Quinzaine littéraire, n° 761, le 1er mai 1999.
Publié avec l'autorisation de
http://www.quinzaine-litteraire.net
|