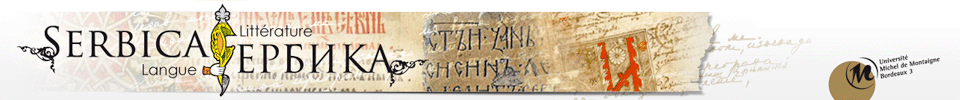|
A lire : Un extrai de ce manuscrit |
ERRANCES* - NEGOVAN RAJIC Présentation de l'auteur À la suite à la publication du roman Vers l’autre rive, naquit chez moi l’idée d’une trilogie susceptible de s’appeler Pèlerins de la liberté. Errance fut le deuxième tome de cette œuvre en devenir. Ce livre est l’histoire d’un long périple commencé, en compagnie d’un ami, par la traversée à la nage de la frontière austro-yougoslave et poursuivi durant quinze mois à travers une Europe en ruine. Il s’était terminé un matin d’octobre à Paris, à la gare de l’Est, là où doit commencer le dernier volet de la trilogie. Il pourrait s’appeler Dans la dèche. Les péripéties évoquées dans Errances débutent environ un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où nous avons quitté Belgrade, fermement décidés à atteindre la France, afin d’y poursuivre nos études. À partir de l’Autriche, nous avions commencé un long voyage initiatique au cours duquel nous étions obligés de traverser plusieurs frontières, sans passeport et ni argent. Durant ce long périple, nous avons eu l’occasion de faire l’expérience de plusieurs systèmes carcéraux et concentrationnaires dans différents pays de l’Europe de l’Ouest et en particulier en Italie. Certes, ces systèmes n’étaient pas aussi inhumains que ceux des camps d’extermination de la Second Guerre mondiale, mais, par une cruelle ironie du sort, il nous arriva de vivre dans des baraques dans lesquelles, il n’y a pas si longtemps, furent logés les hommes qui allaient être passés par les armes. On peut s’interroger sur les raisons qui avaient poussé les autorités, en particulier italiennes, à interner dans des camps un certain nombre d’apatrides et des réfugiés, tous de pauvres hères. On peut supposer, raisonnablement, que la phobie séculaire des hommes venus d’ailleurs et parlant une langue incompréhensible, avait joué un certain rôle, bien que les autorités évoquaient plutôt des raisons terre-à-terre pour justifier l’enfermement des étrangers, sans identité bien établie et sans moyens de subsistance. L’angoisse inspirée par des individus hors normes, se reflétait par cette horrible expression dont nous désignait la presse italienne rifiuti de la società, les déchets de la société. Bien des années après ma libération, je me targuais de cette qualification, comme d’un titre honorifique. Parqués dans des enclos, nous n’étions ni coupables ni innocents. Conséquemment, nous n’allions être ni accusés, ni jugés, ni condamnés à une peine quelconque, mais seulement retenus dans des colonies d’internement dont Kafka avait eu la prémonition et que les autorités italiennes appelaient pudiquement campi di profugi stranieri. Mon camarade et moi, nous avions eu le privilège de connaître deux établissements de ce genre, d’abord celui de Fossoli di Carpi, près de Modaine, puis celui installé dans la forteresse médiévale de l’île de Lipari. Le camp Fossoli di Carpi se trouvait en Italie du Nord, dans une plaine noyée dans les brumes matinales jusque tard dans la matinée et plongée dans celles du crépuscule. Ces brumes s’insinuaient dans le labyrinthe des ruelles du camp en transformant en fantômes les rares détenus qui s’aventuraient en dehors des baraques. Le camp m’avait laissé un souvenir inoubliable avec ses immenses bâtiments en briques rouges, ses dortoirs avec une centaine de lits à l’étage, ses lieux d’aisance aux odeurs nauséabondes et ses boues grasses aspirant nos chaussures comme les ventouses d’un monstre tellurique. Si l’enfer dispose d’une antichambre, elle doit ressembler à une baraque du Fossoli di Carpi, telle que je l’avais habité au temps de ma jeunesse. Le deuxième établissement d’internement dont nous avions eu le privilège de faire l’expérience se trouvait sur l’archipel volcanique des Îls Éolienes, très exactement, sur celle de Lipari. Par rapport au premier, il se présentait comme un romantique cimetière au bord de la mer, avec ses vieilles églises, ses cyprès, garde d’honneur d’éternité et ses sentiers pavés de moellons, décor rêvé pour un roman d’Alexandre Dumas. Comme si cela ne suffisait pas assez pour rendre l’atmosphère sépulcrale, dans l’enceinte de la forteresse on trouvait plusieurs sarcophages en pierre vides du temps de la préhistoire. Dès la tombée de la nuit, par la fenêtre aux lourdes grilles noires de notre dortoir, le volcan Stromboli nous offrait le spectacle d’un feu d’artifice permanent, digne d’une fête baroque. Les gerbes incandescentes se succédaient sans relâche décrivant mille arabesques contre un ciel d’encre noire. Nous remercions le Ciel de nous avoir offert une si belle image nous permettant d’oublier, du moins pour un instant, ce crie de la faim qui montait de nos entrailles! Et puis… Et puis n’aurions-nous pas à tirer une leçon pour la vie de tous nos malheurs? Ne devrions-nous pas être reconnaissants à nos geôliers qui, en nous privant de la liberté nous permirent de l’apprécier à sa juste valeur ! *Manuscrit en français |
|