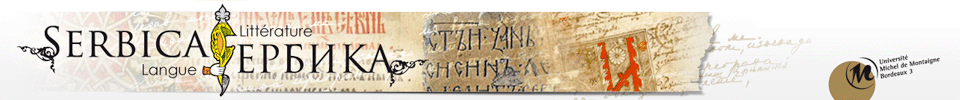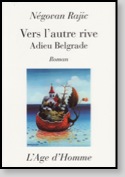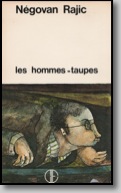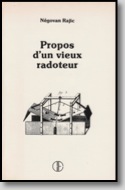Négovan Rajic
© Cormorant books
|
Négovan Rajic écrivain
L'exil ou la quête de la liberté l'entretien accordé à Serbica |
|
A lire : Trois amours... (manuscrit)
Pour en savoir plus :
|
Serbica : Vous sentez-vous personnellement comme un écrivain en exil ? Négovan Rajic : Toute la question est de savoir de quel exil il s’agit. Si l’on parle de la langue ou du pays, alors, sans doute, je suis un écrivain en exil. Exilé culturel ? Pas tout à fait ! L’apprentissage du français, durant mes huit années du lycée, m’avait permis d’acquérir des bases de la langue de Molière. Un séjour de deux mois à Paris, à l’époque de mon adolescence, avait également contribué à améliorer mon français. Après cela, je ne me sentis plus dépaysé dans l’espace culturel français.
Mes livres furent traduits en serbe et publiés à Belgrade, grâce à l’aide du Conseil des Arts du Canada. Mes ouvrages furent très bien accueillis dans les publications universitaires. Quelques exemples illustrent assez bien cette situation. (*) Des extraits du roman Errances de Négovan Rajic peuvent être lus sur le site internet qui est consacré à l’écrivain : http://www.negovanrajic.ca Juillet 2011 |
L’EXILE OU LA QUÊTE DE LA LIBERTÉ
Serbica : Vous sentez-vous personnellement comme un écrivain en exil ?
Negovan Rajic : Toute la question est de savoir de quel exil il s’agit. Si l’on parle de la langue ou du pays, alors, sans doute, je suis un écrivain en exil.
Exilé culturel ? Pas tout à fait ! L’apprentissage du français, durant mes huit années du lycée, m’avait permis d’acquérir des bases de la langue de Molière. Un séjour de deux mois à Paris, à l’époque de mon adolescence, avait également contribué à améliorer mon français. Après cela, je ne me sentis plus dépaysé dans l’espace culturel français.
Enfin, que signifie à notre époque un écrivain en exil ? Kafka, juif d’origine, qui vivait à Prague, écrivait en allemand et publiait parfois à Berlin, était-il un écrivain juif ou un écrivain allemand écrivant dans un pays de langue slave ? Que dire de Joseph Konrad qui, né Polonais, hésitait entre le français et l’anglais avant de commencer son œuvre ? On pourrait s’interroger aussi sur le destin littéraire de Canetti et surtout sur celui de Isaac Bashevis Singer dont l’éducation se fit dans trois langues mortes – l’hébreu, l’araméen et yiddish, et qui, vivant dans la trépidante Amérique, choisit d’écrire d’abord en hébreu puis se converti pour de bon au yiddish.
Avant tout, l’exil fut pour moi une mise à nu, car une fois la frontière yougoslave traversée, dans des conditions dramatiques, je me suis retrouvé en Autriche sans papiers d’identité, sans argent et sans connaissance de la langue. Il s’agissait donc de recommencer la vie à zéro ! À partir de cet instant, l’exil devint pour moi une riche mine d’expériences de toutes sortes. Dans le récit Sept roses pour une boulangère, j’ai évoqué un fragment de cette existence en marge.
Le choix de la langue par un écrivain en exil est complexe et personnel, mais il s’avère toujours comme une aventure passionnante. Quant à la question de savoir si je suis un écrivain en exil, j’avoue être perplexe. Bien sûr, au point de vue formel, je le suis, mais quelle signification doit-on donner à la notion de la littérature en exil quand déjà, deux siècles auparavant, Goethe écrivait: « La littérature nationale n’a plus guère d’importance, l’ère de la littérature mondiale est en train de naître, et chacun doit contribuer à son avènement » ?
– Quelles sont les raisons exactes qui vous ont poussé à quitter votre pays natal ?
– J’ai quitté clandestinement mon pays natal pour rester un homme libre. Il ne s’agissait pas de le trahir, mais de lui rester fidèle. Le lendemain de la guerre régnait à l’Université de Belgrade, comme d’ailleurs dans toute la Yougoslavie, l’atmosphère étouffante d’une idéologie du dix-neuvième siècle et qui, comble d’ironie, prétendait être d’avant-garde.
Dans le roman Vers l’autre rive, basé sur le vécu, j’ai décrit ce climat lourd et oppressant qui régnait à l’automne 1945 à la Faculté technique de Belgrade. Les étudiants se trouvaient soumis à une véritable chape de plomb imposée par une minorité d’activistes communistes. Ceux-là se recrutaient pour la plupart parmi les opportunistes. Ils essayaient d’embrigader l’ensemble des étudiants dans des kroujoks – ou cercles d’études – mais en réalité c’était des réseaux de surveillance idéologique et policière de tous les jeunes gens rescapés de la guerre.
Cette situation inquiétante reflétait celle qui régnait dans tout le pays. Elle aboutissait progressivement à un changement de la personnalité des individus. Placé devant le choix entre la soumission et l’évasion vers la liberté, j’avais choisi cette dernière.
On m’a souvent posé la question : « Comment ont fait les autres, ceux qui sont restés ? » Mais cette question, c’est à eux qu’il faudrait la poser ! D’ailleurs, je ne tire aucun orgueil de mon choix. Chacun agissait en son âme et conscience. En traversant clandestinement la frontière, puis lors de mes pérégrinations à travers l’Europe d’après-guerre, j’ai rencontré dans des camps de réfugiés des centaines de jeunes gens qui avaient fait le même choix que moi.
– Vous avez, à l’instar d’Émile Cioran et d’Albert Cossery, fait le choix de la langue française comme langue d’écriture. Comment cela s’est-il passé ?
– Les liens de ma famille avec la France dataient de la Première Guerre mondiale. Mon père dirigeait, à partir de 1916, jusqu’à l’armistice, un groupe d’élèves serbes réfugiés en France, à Rochefort sur Mer. Lors de son séjour, il avait appris le français et tissé des liens d’amitié avec un professeur du lycée de cette ville. D’autre part, les cours du français à partir de la première année du lycée m’avaient permis d’acquérir les notions de base de cette langue. J’avais quatorze ans quand mon père m’envoya passer en France les grandes vacances scolaires. Je vécus ainsi durant deux mois dans une famille parisienne. Cela se passait durant l’été 1937 au moment où à Paris se tenait la grande exposition internationale. Mon séjour dans la capitale s’avéra être une expérience inoubliable et probablement décisive pour ma vie entière.
Durant ces deux mois de canicule, je vécus comme un infatigable marcheur dans les rues et les boulevards de la capitale. Le réseau du métro, cette gigantesque taupinière humaine, me fascina particulièrement. Dans le récit Sept roses pour une boulangère, je lui ai consacré un certain nombre de pages. Ce monde souterrain s’avéra être pour moi un immense champ d’exploration. De ses voûtes, recouvertes d’affiches publicitaires, des milliers des mots obscurs me narguaient et m’obligeaient à chercher leur signification. Il y avait aussi ces camelots qui, à certains carrefours des galeries, vendaient à la sauvette leur pacotille. Ils m’impressionnaient par leurs baratins débités à une cadence infernale. Fasciné, je les observais en me demandant si un jour je serais capable de parler avec autant de facilité. Oh ! plusieurs de ces camelots m’avaient trompé en me vendant leur marchandise douteuse à un prix exagéré. Néanmoins, je leur suis resté reconnaissant, car ils m’avaient donné de précieuses leçons de la langue française.
Les souvenirs des jours heureux, passés à Paris durant l’exposition internationale de l’été 1937, furent, sans doute, à l’origine de ma décision de quitter clandestinement le pays et d’arriver en France.
Une fois à Paris, au fur et à mesure que mon séjour se prolongeait, ma fascination pour la langue française alla grandissante. Parallèlement à mes études d’ingénieur, je dévorais la littérature du pays. La langue aussi me séduisait et il m’arrivait d’apprendre par cœur des phrases entières d’auteurs français. Certaines se sont gravées dans ma mémoire comme un trésor inaliénable. Je pense à celle de Saint-Exupéry : « Les pierres d’un chantier ne sont en vrac qu’en apparence s’il est un homme, soit-il seul, qui pense cathédrale ». Ainsi commença mon long et passionnant apprentissage de la langue française qui ne s’achèvera qu’avec ma mort.
– La littérature française devait certainement, à l’époque de votre formation littéraire, avoir un rayonnement important dans l’espace de la Méditerranée orientale et les Balkans. Avez-vous été, en Serbie, orienté vers les lettres françaises ?
– Au temps de ma jeunesse, les auteurs français ne m’attiraient pas plus que ceux d’autres langues, car, de toute façon, mes lectures se faisaient en traduction serbo-croate. La langue d’origine n’intervenait pratiquement pas dans le choix de mes lectures.
– Votre œuvre littéraire se situe au croisement du fantastique et de la satire politique. Quels sont les auteurs qui forment votre propre tradition littéraire ? Quelles seraient les influences que vous revendiqueriez ?
– Dans mon aventure littéraire, trois genres ont ma prédilection : le fantastique, la satire et un réalisme dépouillé de tout enjolivement. Ces genres dominent, coexistent ou sont exclusifs et une classification rigoureuse n’est pas aisée.
Le fantastique me fascina dès mon enfance. Âgé d’à peine sept ans, je me lançai dans la lecture des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Bien sûr, si la satire de la société anglaise du XVIIIe siècle m’échappait, néanmoins, l’œuvre m’envoûtait littéralement.
Ma prédilection pour le fantastique date probablement de cette époque. Elle persista et me fit connaître plus tard Poe, Kafka, Orwell, Melville et d’autres écrivains ayant adopté ce genre littéraire. Inévitablement, mon premier livre, Les hommes-taupes, sorte de pamphlet contre le monde totalitaire, reflétera l’influence de ces maîtres.
Enfin, dans Les propos d’un vieux radoteur, j’ai continué dans la même veine avec autant de plaisir. Ainsi, dans trois des quatre nouvelles composant le livre, il est possible de reconnaître certains personnages. Bien entendu, leur identité réelle est secondaire. Ils sont seulement les acteurs anonymes sur la scène du plus grand théâtre du monde qui est la vie !
Je pourrais continuer ainsi longtemps à disséquer mes livres, au risque de les priver de leur parfum du mystère.
– À l’instar de Vladimir Nabokov, de Miloš Crnjanski, vous effectuez une critique du discours totalitaire.
– La critique du discours totalitaire est un sujet inépuisable et un grand nombre de penseurs et d’écrivains se sont attelés à cette tâche sans épuiser le sujet. Je me limiterai à une ou deux remarques d’ordre général.
Derrière chaque discours totalitaire et en particulier celui du marxisme, il y a l’obsession d’en finir avec l’histoire en établissant un ordre planétaire permanent. Dans l’esprit de ses penseurs, cet ordre doit reposer sur une sorte de justice géométrique. À la limite il s’agit d’un retour au paradis dont nous avons été expulsés par notre faute. Comment en est-on arrivé là ?
Si la conquête du pouvoir et de territoires apparaît comme le moteur de l’histoire, le progrès des sciences exactes au cours de trois derniers siècles a fait miroiter, à certains esprits, la perspective d’une gestion scientifique des rapports humains. Le jargon scientifique du marxisme le confirme indirectement.
Le hic c’est que les lois des sciences exactes appliquées à la matière ne tolèrent pas d’ambiguïtés, tandis que les lois des sciences humaines sont des lois vagues, comme on les désigne en anglais. Cette obsession du marxisme d’assujettir les relations humaines à des lois aussi rigoureuses que celles des sciences exactes a pour conséquence un phénomène intéressant : les théories marxistes sont perpétuellement en révision.
Mes remarques concernent uniquement le totalitarisme du type marxiste, mais nous assistons, aujourd’hui à l’émergence d’un totalitarisme basé sur la manipulation des masses comme l’avait remarquait Ortega y Gasset, mais celui-ci pourrait être objet d’une autre réflexion.
– Votre œuvre littéraire, protéiforme, révèle néanmoins une prédilection pour la nouvelle et le récit. Vous préférez, comme Branimir Šćepanović, la forme brève, concise, au souffle épique ou baroque du roman. Quelles en sont les raisons ?
– Si l’on examine la question de mes prédilections, il faut prendre en considération les circonstances dans lesquelles je m’étais lancé dans l’aventure littéraire.
Ma passion pour les mots et la littérature avait commencé très tôt. Néanmoins, au temps de mes études d’ingénieur, elle fut provisoirement reléguée au rang d’occupation secondaire, mais au fur et à mesure que j’avançais dans mes études techniques, mon intérêt pour la littérature revenait en force. Vers l’âge de trente-trois ans, je ressentis le besoin de noter tout ce qui me passait par la tête. Ce fut le début de mes carnets en vrac. À vrai dire, il ne s’agissait pas d’un journal, mais des notes prises au hasard d’une inspiration du jour. Au départ, cette pratique n’impliquait pas une ambition littéraire précise, d’autant plus qu’à cette époque mon français laissait à désirer. C’est seulement quelque vingt ans plus tard que je ressentis le besoin de créer une œuvre, si modeste qu’elle soit.
Au départ, je n’avais aucune prédilection pour la nouvelle et le récit. Ce choix se fit spontanément, mais non sans angoisse. Le temps n’allait-il pas me manquer pour sauver de l’oubli des êtres rencontrés au cours de ma vie aventureuse ?
Ces remarques concernent mes premiers livres. Depuis, j’ai terminé un assez long roman Errances relatant mes pérégrinations à travers une Europe en ruine, roman en attente d’un éditeur .
– La littérature serbe ne devrait pas être pour vous une littérature étrangère. Quels rapports entretenez-vous avec elle ? Comment vous positionnez-vous par rapport à cette littérature ?
– La littérature et les contes populaires serbes furent pour moi une sorte de vivier dans lequel j’ai pêché maintes images et inspirations pour mes livres. On en trouve des traces dans presque tous mes écrits.
J’évoquerai un exemple. Dostoïevski disait de la littérature russe du dix-neuvième siècle qu’elle était sortie du Manteau de Gogol. Mutatis mutandis, ma longue nouvelle Propos d’un vieux radoteur est sortie du même terreau que Vampire de Milovan Glišić. Les trames des deux histoires sont différentes, mais les atmosphères et les décors sont de la même inspiration rurale. Dans les Propos d’un vieux radoteur et le Vampire c’est le même monde des créatures d’outre-tombe qui dérangent les vivants habitant dans les lieux sinistres perdus derrière le dos du bon Dieu.
– Comment la critique serbe situe-t-elle votre œuvre ? La critique littéraire de votre pays natal a-t-elle mené à bien son œuvre de réception ?
– Je dois une reconnaissance particulière au professeur Živojin Živojnović d’avoir traduit en serbo-croate mon premier livre Les hommes-taupes. Cette traduction, sous forme du samizdat, circula à Belgrade et me fit connaître dans mon pays d’origine. En 1988, au moment du dégel idéologique, je reçus l’invitation de me rendre en Yougoslavie pour assister, quarante-deux ans après l’avoir quitté dans des conditions dramatiques, à un congrès des écrivains. Ce voyage me permit de prendre contact avec les milieux littéraires et intellectuels du pays retrouvé.
Mes livres furent traduits en serbe et publiés à Belgrade, grâce à l’aide du Conseil des Arts du Canada. Mes ouvrages furent très bien accueillis dans les publications universitaires. Quelques exemples illustrent assez bien cette situation.
– Et qu’en est-il de la réception de votre œuvre en France et au Québec ?
– Règle générale, la critique de mes livres en France et au Québec leur fut favorable. Au Canada anglais, en particulier, la critique fut unanime à saluer mes livres en soulignant leur originalité.
Je suis d’autant plus sensible aux critiques que mes livres ont reçues que j’écris dans une langue qui n’est pas ma langue maternelle.
– Y a-t-il un thème littéraire, un aspect de votre œuvre sur lequel vous aimeriez travailler davantage ?
– J’aimerais écrire encore deux ou trois livres dans le genre hors du temps et hors d’un lieu géographique précis dans la veine des hommes-taupes.
Cependant, je suis hanté par l’idée que le temps va me manquer pour raconter certains événements dont je fus le témoin au cours de la Deuxième Guerre mondiale, cette guerre qui comme un tourbillon du vent emporta tant de destins.
Juillet 2011