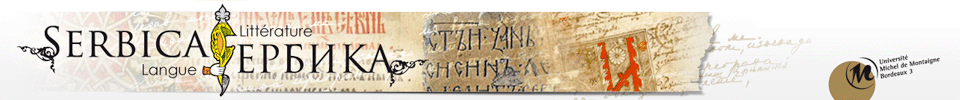|
Ivo Andrić
La terre, les hommes et la langue
chez Petar Kočić
 |
 |
| Ivo Andrić |
Petar Kočić |
Petar Kočić était issu d’une famille paysanne serbe de la Bosnie occidentale, plus exactement de la Krajina bosniaque ou, plus précisément encore, d’un endroit bien défini de cette Krajina du nom de Zmijanje. Nous soulignons cette étroitesse car plus un environnement est exigu, resserré, expressif, plus il est lui-même et éloigné du reste de la Bosnie, à l’image, au demeurant, de la Bosnie elle-même qui, éloignée, le fut longtemps du reste du monde. Ce sont là dans l’existence des traits déterminants qui rendent plus rigoureux, plus solide, plus virulent, et qui peuvent avec d’autant plus de force et de sévérité déterminer et conditionner un individu, ses œuvres et son action.
Cette contrée et ses grandes communautés de familles associées nous sont relativement connues car on a beaucoup écrit sur elles. À commencer par Petar Kočić lui-même (qui, à dire vrai, n’a rien traité d’autre sinon ce sujet), mais aussi grâce à d’autres auteurs qui se sont penchés sur Petar Kočić. Son père devenu veuf très tôt puis ayant pris la bure, Kočić a grandi dans la nombreuse famille de son grand-père, un foyer qui regroupait trente-six personnes, et l’un des biographes de Kočić ne s’écarte guère de la vérité quand il signale que dans la vie de l’écrivain, sa première école, et la plus importante, fut « la volonté collective de la maison en tant que communauté de vie ». Cette maison, affirme-t-il, « lui a donné une structure spirituelle et physique bien définie, complète ». À l’époque de Kočić, en réalité, ces regroupements de familles n’existent plus sous leur forme parfaite, compacte, mais avec les nouvelles conditions d’existence, commencent à se développer en unités domestiques de taille moindre, aux liens mutuels toujours plus distendus, et donc en personnalités distinctes ; mais par leurs réactions affectives, le regard qu’elles portent sur la société et la moralité, leur conception des choses et leurs coutumes, elles demeurent des restes puissants, souvent inconscients de tout ce qui a été. Car, quand elle est aussi profondément ancrée, la manière de sentir et d’appréhender les choses survit au cadre des conditions réelles et aux rapports qui les ont créées, elle agit en l’homme au travers des générations et demeure une force motrice encore et toujours vivace ou un frein et une gêne.
Il n’y a naturellement là rien de nouveau. Nous entrons tous dans la vie porteurs de traces ou, si vous préférez, de la charge pesante du groupe social auquel nous appartenons du fait de notre origine, mais je pense que nous n’avons pas d’autre écrivain moderne chez qui ces liens et obligations sont aussi proches et immédiats, aussi forts et criants, en contraste aussi frappant avec les conditions sociales dans lesquelles la vie l’a propulsé, et ce, en tant que première personne de sa communauté à l’être ainsi. Car Petar Kočić est le premier des siens à avoir quitté le cercle familial restreint ou, disons pour plus de clarté, à en avoir été extrait pour entrer dans le monde immense, complexe, et divisé par les contradictions de la vie européenne contemporaine.
Le lien qui unit Kočić à la Krajina et, plus étroitement encore, à Zmijanje, apparaît chez lui d’emblée, dès ses premiers pas, et ne s’est jamais rompu au cours de son existence brève, combative, spartiate de simplicité ; il pénètre son œuvre à travers une multitude de détails, si tant est qu’il ne la conditionne pas dans son entièreté, depuis ses fondements.
Chassé du lycée de Sarajevo, poursuivi pour ses positions militantes de patriote et ses emportements, Petar Kočić a fait ses études secondaires à Belgrade. Il lui arrivait de souffrir de la faim. Son père ne pouvait lui faire parvenir d’aide matérielle, il le lui écrivait, et la seule chose qu’il lui ait envoyé fut cette recommandation, de « faire montre d’un tempérament d’acier et de la persévérance que la Kočića glavica » (une colline abrupte qui domine leur village). Un homme vivant, encore un enfant, mais un enfant plongé dans des circonstances très différentes, est donc ici totalement identifié au paysage de la contrée qui l’a vu naître, il est exigé de lui qu’il fasse preuve de la ténacité de la terre et de la roche de son village natal. Ce ne sont pas là des mots creux, pittoresques, venant d’un père, ce que le fils lui écrit le montre. Reçu à l’examen de fin d’études, il informe son père et, parallèlement, à l’instant de faire son entrée dans la vie, il l’entretient non pas de sa santé ou de ses intérêts intellectuels, mais de son point de vue moral, il lui envoie une sorte de rapport quasi rituel, il en est redevable à sa tribu, arraché qu’il a été, balancé dans le monde. À cette occasion, donc, Petar Kočić écrit : « Je ne me suis humilié devant personne pas plus que je n’ai mendié car les Kočić en sont incapables. Il y eut des jours, et cela deux ou trois de suite, où je n’avais rien à me mettre sous la dent, mais je n’ai incliné la tête devant personne pour demander l’aumône. » (1898) Et sa fierté est toute entière contenue dans ce qu’il est, « le premier de la tribu Kočić reçu à l’examen ». Tout est donc dédié à la tribu, les souffrances comme le succès. Quand il accomplira d’autres choses plus importantes, son comportement, conscient ou inconscient, restera le même comme si toutes les familles de Zmijanje ne le quittaient pas des yeux : les Bosančić, Babić, Knežević, Mačkić, Gvozdenović, Kušić, Guslov, Blagojević. Car comme Petar Kočić en personne le dit quelque part : « Ce sont là tous des parents et ma famille ». Et les parents et la famille attachent et obligent. Et cela, profondément, durablement !
Dans cette insistance appuyée sur son indigence, il ne faut chercher aucune ascèse. À l’inverse, ce n’est là qu’un moyen de lutter et de se défendre, l’envers de la force, du pouvoir et de la richesse que l’occupant, qu’il soit ottoman ou austro-hongrois, s’est accaparés exclusivement pour lui-même. Cet accent mis sur sa misère afin uniquement, de souligner plus nettement encore son indépendance et sa liberté qui est en quelque sorte sa richesse et sa force, recèle quelque chose qui est typique de Kočić et de la Krajina, et, jusqu’à un certain point, de toute la Bosnie. Tout est déterminé par les circonstances particulières de l’histoire de la Bosnie, un pays soumis à deux occupations étrangères cinq siècles durant et sous lesquelles la raja dut développer sa propre éthique, une éthiqueoù les concepts de possession et de bien-être, surtout de luxe et d’éclat, devinrent – vu les conditions – pratiquement incompatibles avec ceux d’indépendance, de fierté, voire celui, fondamental, d’honneur. Il n’y a que « sur la montagne et au pied de celle-ci » où l’existence est besogneuse, rude de simplicité, que vivre est possible si on veut rester celui qu’on est. Cette conception est celle de communautés et de peuples asservis mais nullement défaits ou découragés, la psychologie d’hommes révoltés qui trouvent une satisfaction folle, presque sensuelle à n’avoir aucun besoin et, même, à être dépourvus du strict nécessaire, de gens qui, ne pouvant être ce qu’ils souhaiteraient être, veulent devenir ce que les autres – leurs bourreaux – jamais ne pourront être, des miséreux riches de leur fierté.
Cette attitude de renoncement et de misère mâtinée d’arrogance, et l’esprit de totale indépendance qui leur est lié apparaissent en permanence chez Kočić, notamment pendant sa jeunesse, à un âge où on est particulièrement enclin à sortir et à étaler tout ce que l’on a sur le cœur. En 1903, étudiant à Vienne, Petar Kočić écrit à Bogdan Popović à Belgrade : « Affamé, sans vêtements, pieds nus, les orteils qui sortent de mes chaussures, je vais par les rues de Vienne et je me remémore mon enfance, mes montagnes, mes chers montagnards, et si je rencontre où sais-je ? un bon camarade, je lui soutire un kreutzer, je vais dans un café pas cher et j’écris De la montagne et au pied de la montagne [C планине и испод планине]. Il m’arrive de passer trois jours sans rien manger de chaud. Mais je suis satisfait car je suis indépendant et je n’honore personne hormis celui qui pense et travaille avec honnêteté. »
Ce n’est pas là une exhibition de la pauvreté à laquelle se livrerait un bohème ou un derviche ; ce n’est pas non plus ce trait de caractère bosniaque que les Autrichiens, dans leur frivolité et incapacité à comprendre les autres peuples, qualifiaient de « kulturfeindlich ».
Ni chez Vuk Karadžić ni dans nos dictionnaires les plus récents nous ne trouvons le verbe honorer au sens de tenir quelqu’un en estime. Petar Kočić l’emploie dans sa correspondance personnelle mais aussi dans ses nouvelles où il désigne un trait caractéristique de l’homme. Le pope de Mračaj, dans la nouvelle éponyme, déclare d’un air sombre et fier : « Mais le prêtre de Mračaj, saisis-tu, honore peu l’évêque et la justice allemande. » David Štrbac lui non plus « n’honore » personne, « pas plus Dieu, que l’empereur, le patriarche, le moine, le pope, le patron, l’aga », pour reprendre les mots de celui qui interprète le rôle de l’avocat dans Јudiciade [Суданија].
Mais les hommes de Kočić, ceux, vivants, de la Krajina, comme les personnages de ses nouvelles, comme Kočić lui-même, ne sont pas uniquement résistants, orgueilleux et entêtés, ils possèdent un autre trait : ils sont moqueurs, avec un don particulièrement développé pour la satire qui vire aisément au sarcasme et à la négation. « Certains, dit Petar Kočić, sont d’humeur fantasque, d’autres aiment blaguer et se gausser, et chacun de très bon cœur se paiera ta tête. » En cela aussi Kočić appartient à sa tribu. Sa satire, vous le savez, était par bon nombre de ses traits, un véritable « fouet à tyrans », beaucoup de ses phrases sont entrées dans le langage populaire courant. Sa satire est tellement typique de la Krajina et de son peuple qu’elle sort parfois des frontières littéraires et, loin de la pondération et du bon goût, sombre, selon les mots d’un critique, « dans le rire graveleux de la čaršija ».
Dans sa vie personnelle aussi, tant physique que morale, Petar Kočić était entièrement un homme de sa contrée et de son peuple. Au Sabor de Bosnie-Herzégovine, il se montrait par ses interventions intempestives une vraie calamité pour tous ses adversaires, en d’autres termes pour le gouvernement et sa majorité. Quand le président constatait, par exemple, qu’une proposition du gouvernement avait recueilli la majorité absolue des suffrages, il s’écriait : « Pas absolue, soumise ! » Là où il n’y avait pas lieu de se bagarrer, il s’arrangeait pour trouver un motif de dispute. À peine avait-il été libéré de prison au terme d’une de ses longues incarcérations que dès le premier pas il manifeste son arrogance d’homme de la Krajina. Remplissant sa fiche d’hôtel, à la rubrique « Lieu de départ », il inscrit « Banja Luka, sans gendarmes », et à « Jour prévu de départ » « À ma convenance ». Pour ce qui est de son physique, voici comment Pero Slijepčević le décrit : « Forte corpulence, grands yeux, longues baccantes. C’est un colosse de haïdouk sorti hier des forêts bosniaques, se vêtir à l’européenne l’engonce et lui est mal seyant. Sur son haut front plat, comme sur un rivage, blanchoie la vague aérienne des clairières. Quand il prend la parole, c’est la montagne qu’on croirait entendre parler derrière lui. »
Voilà donc comment était Petar Kočić de sa personne avec, physiquement, l’air d’un rocher qui se serait détaché d’une colline ou, mieux, de la Kočića glavica ; moralement, c’était un homme de sa région, qui avait traversé Vienne, Belgrade, et Sarajevo presque sans une égratignure. Et du point de vue tant positif que négatif, il était tel resté qu’en lui-même avec, intérieurement, selon les mots d’Isidora Sekulić, « le complexe du caractère montagnard bosniaque ».
Ce qui constitue la difficulté et la grandeur de la vie de Kočić constitue également la force et la faiblesse de son œuvre littéraire. Il était de ces écrivains habités par une image du monde toute prête, formée d’avance, dont ils veulent et doivent donner une représentation, de ces écrivains qui ne mettent pas en œuvre plus de moyens intellectuels et de possibilités d’expression que ceux nécessaires à la réalisation de leur œuvre, de ces écrivains qui ne consacrent pas leur existence à la littérature mais qui placent la littérature et leur existence toute entière au service de la vie et de besoins vitaux bien définis.
Caractéristique est chez Kočić l’écrivain son abandon facile et sans regrets du domaine de l’art pour ceux de la politique, du journalisme, et de la science (ethnographie, sociologie, histoire). Il élaborait les thèmes de ses nouvelles dans ses discours au Sabor ou dans les articles qu’il composait selon la recette éprouvée de Jovan Cvijić à qui il a écrit ce qui suit à propos de son traitement semi-scientifique du thème de Zmijanje : « Je regrette infiniment de n’être pas géographe ou historien de profession car j’aurais pu parer de plus belle façon et plus consciencieusement cette intéressante province. » Si, au fond, Kočić était fort peu lié à une forme d’expression donnée, il l’était énormément à sa « province » et à la dette et au devoir qu’il estimait avoir envers elle.
La critique d’alors constata que Kočić s’était écarté du domaine littéraire, mais elle ne s’en tint pas là et, parfois, poussa même si loin qu’à propos de la trop longue et, en vérité trop lourdement chargée Judiciade, une nouvelle forte et intéressante par ailleurs, elle écrivit que c’était là « l’une des choses les plus ennuyeuses que le plus oisif des hommes eût pu en vérité écrire. »
Voilà ce que certains contemporains disaient de Petar Kočić, mais sans penser à jeter un coup d’œil derrière le rideau des faiblesses passagères et sporadiques de Kočić l’écrivain, à sonder les motivations véritables et les difficiles circonstances cachées derrière elles et qui valent d’être davantage pesées et plus profondément pénétrées que pouvaient le faire ces esthètes fin de siècle ou nous, ici, ce soir.
Pour Petar Kočić, « l’homme d’une seule réalité », comme quelqu’un l’a fort bien dit, tout s’effaçait devant la grandeur de son dévouement passionné à sa communauté. Activités différentes, distinctes, l’art, la science, la politique, ne faisaient au final plus qu’un face à sa passion ; et lui, de son point de vue, pouvait dire de l’art et de la science ce qu’il disait de ses paysans de Zmijanja : « Ce sont là tous des parents et ma famille ».
Écoutant plus sa nature instinctive, il faisait naturellement erreur sans même deviner qu’il avait en lui les moyens et les armes qui lui auraient permis de mieux « parer » non seulement Zmijanje, mais toute la Bosnie-Herzégovine ; qui plus est, il possédait une grande aptitude poétique à voir et à ressentir, à dire et à exprimer. Tout bien considéré, et dans la mesure où il en avait conscience, il tenait cette aptitude pour une arme parmi d’autres dans le grand combat qui était la substance, le sens et le but de sa vie.
Ce même dévouement passionné à ce combat, ce véritable sacrifice à cette passion sont à la fois la principale caractéristique et la principale imperfection de l’œuvre littéraire de Kočić. Ils font reposer l’ensemble de cette œuvre sur une base étroite, comme chez peu de nos écrivains serbes. Cet aspect a été pointé par ses contemporains. On a écrit par exemple, et à juste raison, qu’au-delà de l’horizon bosniaque, Kočić n’aperçoit rien, que « même l’Herzégovine ne s’y voit pas ». Poursuivre dans le même sens serait possible et, de nouveau à juste titre, dire que même la Bosnie ne s’y trouve pas en intégralité, et que loin s’en faut. Dans la trentaine de nouvelles qu’il a écrites, il n’en est pas une dont l’objet serait quelqu’un d’extérieur au cercle très restreint de Kočić. Jure Paligraf et Smajo Subaša ne sont que des exceptions apparentes ; elles confirment la règle. D’où, du fait de la grande concentration de l’intérêt et de l’attention, le ton monocorde que l’on sent dans l’œuvre de Kočić et qui rappelle celui de la guzla, une pauvreté de thèmes et de variations.
Sa première nouvelle, celle d’un écrivain débutant, Tuba, contient les éléments majeurs de la plupart de celles qui suivront. Dès la deuxième page, il est question de la souffrance des paysans, puis de la révolte de la Krajina, de David Štrbac et de son blaireau ; on y évoque la dime et le tiers, on se raille même de la langue officielle. Bref, le registre complet, tout l’inventaire de l’œuvre littéraire ultérieure y est déroulé. Sur la scène étroite de l’œuvre de Kočić, les personnages se heurtent nécessairement et réapparaissent, des comparaisons et des expressions entières se répètent, etc. Fait significatif, tous les personnages de Kočić sont effectivement originaires de cette étroite bande de terre, certains y vivent encore aujourd’hui si bien que les critiques et journalistes friands de ce genre de détails ont pu aisément les identifier. L’étroitesse de ce milieu et l’attachement qu’il lui vouait ont conduit Kočić l’écrivain à d’autres manquements et faiblesses, à traiter de thèmes faibles et ingrats, et, parallèlement à des satires et des invectives de qualité, à faire de pauvres plaisanteries à l’humour douteux – en un mot, à s’abaisser au-dessous de son don et de son niveau. En outre, ce que nous avons nommé l’étroitesse de sa base a amené toute son œuvre à s’élever et à prendre ce ton haut si caractéristique des gens de la Krajina « toujours une note au-dessus de la normale » comme l’a dit un contemporain.
Ce tribut que Petar Kočić devait payer également de son œuvre littéraire a été, me semble-t-il, le mieux perçu et exprimé par Jovan Kršić. Dans l’étude qu’il lui a consacrée, il écrit : « Peter Kočić est un bon auteur, un écrivain au talent rare, mais on a peine à le considérer uniquement comme artiste. Car c’était un homme constitué d’un seul bloc. L’artiste et le combattant, l’écrivain-poète et l’homme de son milieu étaient en lui indissociables. » Kršić dit encore que chez Kočić « il restait peu de ces surplus d’énergie vitale dont on gerbe une grande œuvre littéraire. »
Afin de ne pas laisser subsister devant vos yeux, ne serait-ce qu’un instant, une image erronée de l’œuvre de Kočić – et quoique notre tâche ne soit pas ici de montrer cette œuvre dans son ensemble mais, simplement, les conditions qui l’ont déterminée –, nous devons, fût-ce très brièvement, compléter cette image.
Il ne faut pas oublier que toute cette étroitesse n’a pas empêché Petar Kočić d’être ce qu’il est, le premier véritable écrivain et artiste de Bosnie-Herzégovine, un écrivain qui a « introduit le paysan bosniaque dans la littérature serbe », un écrivain qui, dans cette littérature, a redonné vie à la nouvelle paysanne.
Tel qu’il était, Petar Kočić écrivain exprimait plus la Krajina que la Bosnie, la Bosnie bien plus, disons, que l’Herzégovine ou, surtout, que nos autres terres serbes, mais à sa manière fondamentalement resserrée, typique de la Krajina, il a en parallèle et pour une bonne partie traduit le côté rebelle, porté à la révolte de toute âme de son temps, en Bosnie-Herzégovine mais aussi au sein de tout le peuple serbe et même au-delà de ces frontières. Il a donné à cette révolte et au désir de résistance profondément incrustés une expression littéraire et artistique, simple et limitée, ni totale ni parfaite, mais la plus parfaite qu’il lui était possible de donner vu son origine, les circonstances de sa vie personnelle et de son époque que nous avons, ici, déjà essayé d’évoquer. Voilà tout. Mais rares sont les écrivains dans notre littérature serbe dont on peut dire cela sans réserve.
Si nous pouvions également montrer ici Petar Kočić dans son rôle de combattant national et d’homme politique, nous pourrions voir clairement où s’est déversée et à quoi s’est employée cette « énergie vitale » dont, selon Jovan Kršić, « se gerbe une grande œuvre artistique ». Nous ne pouvons le faire ici ce soir. Il est toutefois une facette de Petar Kočić le combattant qu’il nous faudra, en conclusion, aborder ici : sa lutte pour la pureté de la langue, de sa forme, certes, mais aussi de son esprit, et de sa pérennité.
Dans les rapports complexes qui s’établirent entre l’occupant-exploitant de la monarchie austro-hongroise et le peuple de Bosnie-Herzégovine, la question de la langue s’était posée immédiatement, et Petar Kočić l’a fait avec une détermination aujourd’hui déjà plus difficile à comprendre, mais qui était justifiée et indispensable. (Rappelez-vous simplement le combat pour la défense de leur langue que menèrent au XIXe siècle tous les autres peuples slaves de la monarchie austro-hongroise !) L’administration de l’occupant avait, avant toute chose, introduit l’usage de l’allemand dans toutes les grandes institutions et les segments les plus importants de la vie. Et là où on avait concédé au peuple l’utilisation de sa langue, dans les échelons inférieurs du pouvoir, dans les écoles, etc., un autre danger menaçait : celui de voir cette langue corrompue, dénigrée, raillée de l’intérieur, ravalée jusqu’à n’être plus qu’un pauvre parler de bas étage, utile pour la compréhension mutuelle des petites gens ou, en cas d’absolu besoin, de ceux-ci avec leurs supérieurs, un parler sans plus de racines, d’esprit et de sel, de beauté et de style, sans plus de rapports avec la tradition et les sources vives de la langue populaire au sens large, mais avec des possibilités limitées, fixées au préalable, de développement culturel.
La sonore appellation de « langue bosniaque » que la perfide et bornée administration de Kállay voulait imposer à ce parler visait en réalité à détacher les peuples de Bosnie-Herzégovine des centres culturels croates et serbes les plus importants, à les séparer de Zagreb et de Belgrade.
Doué d’un formidable et infaillible instinct, prompt de réflexe, Petar Kočić l’avait pressenti. À la lecture de son œuvre, vous avez pu voir la place qu’il accordait à la question de la corruption de la langue, avec quelle rigueur il en parlait et la flagellait de son ironie, souvent en ergotant et avec trop d’outrance.
Mais Petar Kočić avait parfaitement deviné que la philologie n’était pas le problème, que la langue participait de l’oppression générale et du rabaissement systématique d’un peuple dans les bas-fonds de l’existence, de son assujettissement à une domination et à une exploitation de la même façon que le moine herzégovinien Joanikije Pamučina avait, en son temps, remarqué avec beaucoup de réalisme que sous le joug turc aussi, « après avoir perdu tous nos biens, nous avions perdu nos mots et notre langue pure ». Vasa Pelagić, le compatriote de Kočić, avait posé quarante ans plus tôt la question de la langue serbe sous domination étrangère. Traduit devant le Grand Medliš de Sarajevo il avait, écrit-il dans son autobiographie, le premier contraint celui-ci à écrire les interrogatoires en Bosnie (c’est-à-dire à rédiger le procès-verbal) en serbe, en déclarant que sinon, il ne répondrait pas ».
Mais dès le départ, entre l’occupant-ennemi et lui, Petar Kočić a posé la question de la langue. Dans le célèbre poème en prose Molitva [Prière], il dit ceci : « Ô mon Dieu, grand et puissant et impénétrable, donne-moi cette langue, donne-moi ces mots larges et lourds que l’ennemi ne saisit pas mais que saisit le peuple ». Pour Petar Kočić la langue ne fait qu’un avec les hommes et la terre, tout comme eux sacrée et inviolable. Il nous apparaît quelquefois que l’œuvre de Kočić elle-même repose en intégralité dans les profondeurs de cette langue, qu’il l’a excavée comme on met au jour une statue et qu’il l’a amenée en pleine lumière pour l’exposer au regard du monde. Kočić savait (ou, plutôt, sentait) parfaitement que parler et écrire une langue claire et correcte signifiait de cette manière-là aussi résister à l’ennemi, le mépriser, lui démonter sa force vitale ; à l’inverse, faire siennes les expressions nouvelles, monstrueuses, de la langue officielle signifiait tout autant accepter sa soumission à l’oppresseur et ouvrir la voie à une capitulation totale. L’un des personnages de Judiciade donne ce conseil au prévenu : « Si tu veux ne pas t’en sortir trop mal face au tribunal, mêle à ton discours le plus possible de leurs mots à eux ». Or la différence entre les deux parlers était grande. Un autre personnage de Judiciade prononce cette phrase déterminante : « Jusqu’à ce qu’un soldat n’ait remis sa baïonnette dans sa gaine, tu ne pourras savoir si tu es condamné ou remis en liberté ».
Cette langue, la langue de l’ennemi, Petar Kočić ne l’a pas fustigée que dans ses seuls travaux littéraires. Il s’est battu contre elle au quotidien, sur le terrain. (Au tribunal, quand on lui a demandé s’il avait compris ce dont il était accusé, il a répondu : pas tout à fait car « l’acte est écrit dans une langue qui n’a que des airs de ressemblance avec le serbe. ») Il tenait des discours contre cette langue, proposait des commissions spéciales, se disputait avec les représentants du pouvoir au sujet de certains mots. Il ergotait, faisait preuve de sectarisme, mais seulement en apparence car il sentait, il savait que les mots recouvrent une signification, qu’ils traduisent la pensée et la volonté de qui les prononce ou les écrit, qu’ils peuvent de ce fait se révéler une force vive, réelle, mobile, et, en certaines circonstances, s’assimiler, s’identifier – en partie – à la réalité qu’ils désignent. Et Kočić de forcer les représentants du pouvoir bosniaque à feuilleter le dictionnaire de Vuk Karadžić afin d’y chercher les arguments à même de contrer son opposition linguistique. Et déjà là, il remportait une demi-victoire, en ne permettant pas la séparation d’avec le peuple ni l’engagement durable sur l’étroit entre-rail de la voie ferrée autrichienne dite bosniaque.
Dans ce combat, Petar Kočić aura démontré, outre son opiniâtreté et sa fougue, une grande subtilité qui suscite l’admiration, du sens philosophique et du bon ton. Tandis qu’il travaillait sur les textes de projets de loi, il laissait de pareilles annotations : « Ces ‘il faut’, ‘on doit’, ‘il est interdit de’ sonnent de manière déplaisante dans notre langue ». (Exemple : ‘Il faut que ce soit le procureur qui détermine le titre, etc.’. Remplacer par ‘Le procureur en déterminera le titre, etc.). Et Petar Kočić d’expliquer qu’en Bosnie-Herzégovine, où tout n’est déjà que dureté, sévérité, « nul besoin n’est d’introduire cette sévérité, cette rugosité aussi dans les lois, c’est inopérant, surtout quand cela ne correspond pas à l’esprit de notre langue. »
Dans ce domaine non plus, Petar Kočić n’est donc pas resté un simple écrivain ou fonctionnaire de cabinet. Nous savons à travers ses données biographiques qu’aux moments où il était seul, il lissait et peaufinait ses phrases. Mais il savait aller plus loin encore. L’auteur de De la montagne et au pied de la montagne a livré dans la vie de chaque jour une bataille véritable pour la langue, ainsi que pour le reste, le pays et les hommes. Il me semble que nous allons terminer de la meilleure des façons ce court aperçu des trois éléments essentiels de la vie et du travail de Kočić en ressuscitant devant nos yeux sa stature de montagnard qui, des éclairs fulgurant dans les yeux, abat son poing sur son banc au Sabor de Bosnie-Herzégovine et, de sa grosse voix de paysan, sous son épaisse moustache blonde, interpelle les représentants d’une grande puissance : « On nous a tout pris, dans tous les secteurs de la vie nationale nous sommes asservis, mais nous ne vous donnerons pas notre langue. C’est notre espoir et notre réconfort. »
(1961)
Extrait de « Zemlja, ljudi i jezik kod Petra Kočića », in Eseji i kritike [Essais et critiques], Svjetlost, Sarajevo, 1976, p. 181-182.
Traduit du serbe par Alain Cappon
Date de publication : décembre 2015
Date de publication : septembre 2016
> DOSSIER SPÉCIAL : PETAR KOČIĆ
Date de publication : juillet 2014
> DOSSIER SPÉCIAL : la Grande Guerre
- See more at: http://serbica.u-bordeaux3.fr/index.php/revue/sous-la-loupe/164-revue/articles--critiques--essais/764-boris-lazic-les-ecrivains-de-la-grande-guerre#sthash.S0uYQ00L.dpuf
|