|
Isidora Sekulić
L'Orient dans les contes d'Ivo Andrić
|

Ivo Andrć
|

Isidora Sekulić
|
Il existe une grande différence entre les contes et les nouvelles de l’extrémité du monde où le soleil se lève et celles de l’extrémité où il se couche. En Occident, une nouvelle est avant toute chose une idée, un plan, une narration, une finesse d’esprit, un style ; en Orient, un conte est en premier lieu un enchantement. En Occident, les plus belles nouvelles sont racontées par des artistes ; en Orient, par des ermites, des mages, des sorciers et des saints. En Occident, le narrateur manie avec talent l’idée et le matériau ; en Orient, c’est un médium à travers qui le conte se narre lui-même. En Orient, dirions-nous, il suffit à qui est doué d’imagination de fermer les yeux… et le conte est là… Dans une large mesure, c’est ce qui est narré qui importe, y compris dans le cas du conte artistique oriental, c’est-à-dire de celui inspiré par l’Orient et écrit par un auteur qui en est originaire. Quand un écrivain occidental souhaite introduire un détail que la vie sociale ordinaire n’a pas assimilé, et qu’elle ne saurait assimiler, il emprunte de curieux éléments à quelque domaine de la métaphysique et ne parle qu’à un nombre restreint de personnes ; quand un écrivain oriental le fait, il dit kami ou taba, c’est-à-dire des mots du quotidien à l’homme du quotidien car là-bas, en Orient, les gens croient jour après jour au mystérieux et ont des preuves de l’existence du surnaturel. S’agissant de Maupassant, si « Orle » le qualifie de grand psychologue et artiste, on pense aussi qu’il avait un grain, l’esprit dérangé. Quant à R. Tagore et à ses pièces dramatiques, on envisage de même, outre la psychologie et l’art, un troisième élément dont personne ne songe à douter : une prédisposition à une maladie mentale. Quand Maeterlinck souhaite évoquer la mort, il recourt à une mise en scène théâtrale : la nuit, la frayeur, les spectres, « les portes ouvertes, les lampes éteintes ». Chez Tagore, un garçon attend la mort au grand jour, à la fenêtre et au milieu de ses jouets. La nouvelle occidentale est d’abord une tranche de vie, une étude, une vérité, une démonstration. Le conte oriental, même moderne, est avant tout « un tissu silencieux », une incantation ; une fantaisie et un tableau riche en couleurs ; l’enfer ou le paradis ; un vacarme et du sang versé, ou le murmure de secrets profondément dissimulés.
L’Orient est très présent dans les contes d’Andrić, mais sous toutes ses formes : effroyable, ténébreux, poétique, badin, sage. Habitant de Sarajevo, « enfant de l’Orient », Andrić éprouve un intérêt vif, infini pour l’élément islamique qui fut pendant longtemps le maître et le destin de son pays natal, pour tous les types de personnages qu’ils soient primitifs, cruels, terribles et, par ailleurs, énigmatiques et pittoresques du temps d’autrefois, turc, de la Bosnie. Cet intérêt est chez Andrić d’une profonde intimité. L’histoire de l’homme est de ce fait originale à en être bizarre, terriblement immédiate, et très en couleurs. On a parfois peine à croire que le conteur Ivo Andrić et l’écrivain délicat, sentimental, chrétien, typiquement occidental, auteur d’Ex Ponto et d’Inquiétudes, ne font qu’un.
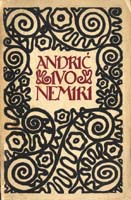
Ivo Andrić : Nemiri / Inquiétudes, 1920
La Bosnie aux mille tourments, incapable, tel un malade, de trouver le sommeil et empêchant un autre de s’endormir, cette Bosnie-là a laissé en héritage une grande partie de ses insomnies à l’un de ses meilleurs poètes. Dans les contes d’Andrić se présente donc à nous ce qui rendait l’existence de la Bosnie difficile mais, simultanément, jetait sur cette sombre existence de riches couleurs qui sont aussi celles de l’Orient musulman terrible et grotesque. Nous apparaît le non-quotidien avec ses campements et tavernes, ses routes toujours animées, ses marchands et ses cafés, son existence faite de cruauté et de saleté, ses personnages effroyables et mystérieux, voire même drôles, tels Đerzelez Alija, Mustafa Madžar, Mula Jusuf ; le suif, l’oignon, la sueur, les guenilles ; l’oisiveté et les aventures ; les ivrognes et les folles tocades ; les forces primitives demeurées intactes et les passions brutes. Néanmoins, si tout est tout réel et répugnant et horrible, il reste qu’il n’en est rien car tout a sombré dans cette noire et douce haute antiquité où tous plongeons si volontiers. Nous nous immergeons, clignons des yeux, tendons l’oreille, frémissons ; le chant de quelqu’un d’invisible, l’appel à la prière de quelqu’un d’invisible, une vieille coutume depuis longtemps disparue sous les eaux. Viennent ensuite de pleines poignées d'orientalismes dans les descriptions, de turcismes dans la langue que nous rattachons, quand ils nous échappent, à des représentations mystiques, ou, à l’inverse, si nous les comprenons, à de tendres souvenirs conservés de récits et de poèmes. Les plaisanteries dissolues et braillées s’effacent alors devant lepressentiment de quelque chose d’éternellement caché ou que l’on dissimule depuis toujours. Puis se font jour de sombres instincts qui, meute bestiale assoiffée de sang et avide de luxure, forts comme au premier jour du monde, mettent un terme à tout en un instant et commandent un festin de passions et d’agonie. Dans le sépulcral et sage silence qui subsistera se mêlent et s’uniformisent les destins, les superstitions, les vérités… Et tout, absolument tout, tant le blasphème que la lascivité, la cupidité, le comique et l’effroi, s’exprime avec lenteur, mesure, une certaine monotonie, un certain mystère, avec un calme et une ardente éloquence qui interdit la somnolence mais ne permet pas non plus un complet réveil. Nous ne pouvons pas nous réveiller pour tout ce qui existe au monde car, à l’instar du vieux Bagdad, l’Orient tout entier se découvre le mieux quand nous entourent « des chandelles, des recoins gorgés d’ombre, et un morceau de nuit bleue à la fenêtre ».
Quoique le conte d’Ivo Andrić soit sans nul doute réaliste et, en tout point, artistique à l’occidentale – rigueur du plan, ton personnel, contemporanéité de la composition et du style –, il est, comme dit ci-dessus, entièrement l’Orient, l’Orient à la fois comme document et comme poésie. Le conte récemment publié U musafirhani [À l’auberge] présente au lecteur frère Marko qui soigne l’odieux Turc Mameledžija gravement malade et qu’on laisse dépérir. Il le soigne et le tance : « Pouah, dženabet [vaurien], jamais tu ne verras le visage de Dieu » ; mais, dans le même temps, il conçoit en son for intérieur un plan visant à assurer le salut de son âme et, avant qu’il ne décède, à lui faire embrasser le christianisme. Au moment crucial, le Turc crache sur le crucifix que frère Marko lui a apporté. Mais peu après la mort de Mameledžija, frère Marko « affligé » prie Dieu pour le défunt. Non pas parce que c’est son devoir de moine ou dans le respect d’un commandement divin, mais de son propre chef, avec simplicité et naturel, ainsi qu’au même instant, avec les mêmes simplicité et naturel, il effeuille des betteraves dans le jardin et prie Dieu pour elles : « Allez, croissez avec l’aide de Dieu ». Dans ce conte sur l’obtus et rustaud frère Marko qui n’est pas fait pour le « saint ordre », il y a très peu de finesse, de profondeur, de généralités qui valent pour l’humanité, de subtilité et de douceur. Mais jamais ce conte, tel qu’il apparaît chez Andrić, n’aurait pu être inspiré par un moine occidental, jamais non plus il n’aurait pu être écrit par un nouvelliste occidental. Il est construit « sans psychologie », sans gradation des effets, sans point culminant. Il est en tout un « tissu silencieux ». Il ne faut pas se leurrer et croire que l’instant scabreux de la scène du crucifix constitue un sommet dans la narration. Au contraire. Le charme réside dans l’étrange, oserions-nous dire muette harmonie de deux silences, celui mortuaire de l’auberge et celui monacal dans la dissimulation et la sainte survie de frère Marko. Ce qui aurait pu être un sommet, la prière récitée par frère Marko, est exempte de tout pathétique ; elle est dite dans la douceur et le plein air du jardin, dans un mélange plus comique que mystique, celui de la betterave et du défunt. Le symbolisme au travers de détails comiques, voilà une qualité artistique éminemment orientale.
La première des caractéristiques orientales du conte chez Ivo Andrić est cette manière d’exposer le contenu qui rappelle le conte oral. Les épisodes et les détails sont légion, très colorés mais brefs, ils défilent, d’autres et d’autres s’enchaînent – sur une petite page de Đerzelez Alija[1], il s’en trouve parfois trois ou quatre – qui amusent pareillement le lecteur mais sans l’accabler de multiples liens et rapports. De par leur nature ces détails se doivent naturellement d’être un art parfait dans une coque de noix, et ils le sont vraiment. On rencontrera, par exemple, un frère qui, tout bien compté, ne se voit consacrer qu’une dizaine de lignes mais qui est peint de telle façon que vous ne cesserez jusqu’à la fin du conte de vous retourner sur son passage. Parallèlement à ces détails, la ligne principale de développement se conforme à l’antique schéma du conte oriental oral ; on voyage, on bivouaque et, le matin venu, on poursuit le voyage ; on rencontre un moine, puis un tsigane ; puis vient un moment d’amusement, puis une rivière à franchir. Đerzelez voyage et voyage encore, Mustafa Madžar chevauche et chevauche encore, fuit et fuit encore ; les soldats font paître leurs montures puis se déplacent et se déplacent encore, de cantonnement en cantonnement ; tous les passants, les hadjis et les nomades de la vie, l’Orient avec ses passionnés et jouisseurs oisifs, curieux et avides. Les événements les plus importants surviennent chemin faisant, sur la route, au han [auberge]. Chemin faisant on s’enivre, on aime, on règle les comptes, on tue, on meurt. Tels sont en gros le rythme et la tonalité du conte. Point de longues conversations, d’amples descriptions, d’interprétation d’une situation, de réflexion philosophique. La sagesse pointe dans le badinage : « La nuit, la rakija, et le peu d’esprit ignorent la mesure ». Jamais le dialogue n’est long ni embrouillé. La description de la personnalité est dépouillée, solide, sèche comme un coup de tampon. La description de la nature, d’un geste, de quoi que ce soit, est de même rapide, mais la plus colorée et la plus sonore possible afin, par la perception sensuelle, de pénétrer dans l’âme ou de demeurer aussi forte que possible dans les sens. « Les serrures grincent, les verrous raclent, les filles se cachent ». « Đerzelez s’éloigne, rapetisse sans cesse, comme si ses jambes lui rentraient dans le corps ».
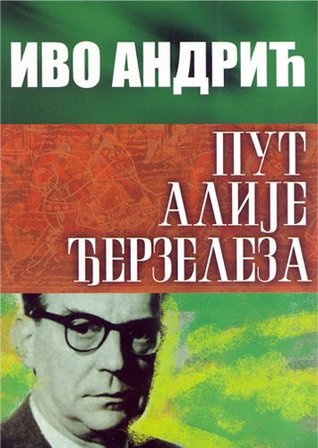
Ivo Andrić : Chemin d'Alija Djerzelez
Les descriptions d’Andrić sont des bruits, des odeurs, des panoramas, des impressions ressenties par le toucher. Une nouvelle fois rentré chez lui à l’improviste, Mustafa Madžar déverrouille le čardak [le balcon, la terrasse], attrape son zurle [une sorte de fifre] enveloppé dans une toile cirée : « Touou tititataa… Le silence prend une tonalité désagréable ». Et pour expliquer entièrement ces situations le talentueux Andrić recourt à la parole vivante et, plutôt qu’un exposé complexe, fait survenir la foule et la rue avec leurs exclamations indiscrètes, caractéristiques et ingénieuses. Quand Ćorkan – de la nouvelle Ćorkan i Švabica [Ćorkan et la Souabe] – sort de prison, quand l’histoire se dénoue donc et s’achève, la situation complète et la signification intérieure toute entière s’expriment à travers quelques clameurs malveillantes, canailles, qui montent de la čaršija [le bourg, la ville] et cet inoubliable, que rien ne saurait remplacer « ti-ridam, ti-ridam, tiridiridiridiridi-ridam » de l’homme qui s’est enfin et à grand-peine débarrassé du bonheur de l’amour… La chaleur, l’immédiateté et la parole vivante sont plus ou moins présentes dans tous les contes d'Ivo Andrić mais Đerzelez Alija en est l’exemple classique. Un bon récitant pourrait la déclamer comme une forme de poème épique populaire, et demeureraient de ce poème toutes les couleurs de la vie d’un temps et d’un peuple.
Le second trait caractéristique de l’Orient dans les contes d’Ivo Andrić est l’absence de toute vie bourgeoise, de personnages et d’intérieurs bourgeois. Il n’y a pas d’époux et d’épouse, de monsieur, de madame, et d’amant ; il n’y a pas de souffrances vécues dans l’intimité, ni d’héroïsme familial, qu’il soit celui de ses membres ou des membres de la société, il n’y a pas de crises de nerfs, pas de larmes. Dans le vieil Orient islamique, les intérieurs étaient pour la plupart inaccessibles, ils tournaient le dos tant à l’opinion publique qu’à la salle des audiences et ne cédaient pas à la poésie. Qui y pénétrait devait laisser yeux et oreilles dans le vestibule avec ses kondure [chaussures]. Et s’il se trouvait un delija [preux], un héros, un šaldija [plaisantin], un dégénéré, ou quelque force, présomption ou talent, cela s’extériorisait dans la čaršija, sur la route ou dans un duel. Il en est ainsi dans la plupart des contes d’Ivo Andrić. Ses personnages sont le plus fréquemment des héros et des assassins à l’état brut, ou des mendiants et des canailles, des aventuriers, des bâtards, des Tsiganes, des Hongrois turcisés, des Stambouliotes insatisfaits chassés en Bosnie, des « gens divers et variés » qui errent dans le pays et le monde, qui soi-disant « commercent » mais vont, en vérité, « là où les mènent leurs noirs et terribles instincts » ; ce sont des figures fantomatiques ou en sang qui passent la moitié de leur existence à cheval, si bien qu’ils ne sont connus que par leurs noms, par les histoires qui se racontent à leur sujet ou la peur qu’ils inspirent. De tels personnages sont certes loin, très loin de tout ce qui peut être bourgeois, surtout s’il se trouve parmi eux quelque moine ou quelque cadi local. Le conte qui dépeint ces gens est par-là même fort éloigné de la psychologie occidentale où le héros, tel l’homme dépeint dans Jestastvenica [Histoire naturelle], voit chacune de ses pulsations cardiaques, chacun de ses gestes et réflexes chiffrés et nommés sous leur dénomination exacte. À l’inverse, les dégénérés, les vauriens, les parasites, les idiots de la čaršija ou les hommes de Dieu se jettent devant nous en extériorisant leurs instincts, leur corps ou leur première pensée, ce, à deux ou trois moments où, chez l’individu, le fond jaillit à la surface, où le cœur tout entier prend le dessus, de sorte qu’elle apparait aussi forte et impérative que si elle avait à cet instant toute la vie à sa disposition. Un nombre assez important de personnages d’Andrić peuvent être « glorieux et comiques » à l’image, disons, de Đerzelez qui a parcouru « la moitié de l’empire ». À ceux-là, exception faite de frère Marko, d’Abdurahman efendi et de Ćorkan, se joignent Kriletić, le natif de Mostar de Dan u Rimu [Une Journée à Rome]. Il évolue certes sur la scène de la Rome de l’époque, mais il n’en reste pas moins foncièrement balkanique et oriental, inacceptable pour l’Occident. Kriletić est un ivrogne, un querelleur, un aventurier issu des gargotes, peut-être même se comporte-t-il en « goujat turc » avec les femmes, mais le hasard a voulu qu’au lieu de vagabonder sur les chemins de Bosnie ou d’Herzégovine, il vacille et titube comme coursier dans toutes les capitales européennes…
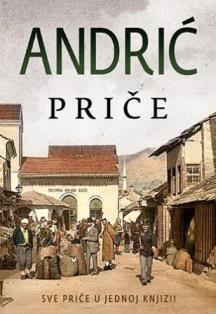
Ivo Andrić : Les Contes
Mais il y a chez Andrić d’autres personnages qui, pourtant loin de tout ce qui est bourgeois, le sont tout autant du trait caractéristique cité précédemment, celui qui les rend « glorieux et risibles ». Ce sont ces personnages bien connus d’Andrić, principaux et secondaires, que les sombres et terribles instincts et la dégénérescence entraînent, et le conte avec eux, dans une horrible balade et dans l’abomination criminelle et perverse. Ainsi Mula Jusuf de Za logorovanja [Pendant le bivouac], en partie seulement Abduselam beg de Mustafa Madžar et, avant et plus que tout, l’épouvantable, le complexe vaurien et pauvre Mustafa Madžar en personne. L’identité sexuelle de Mula Jusuf dépasse les tableaux de Rops, et Mustafa Madžar avec ses terribles insomnies, son horrible passé, est quelqu’un devant qui on tremble. Comparé à ces phénomènes le satanisme occidental relève de la spiritualité. Le sommet de la frénésie chez ces créatures bestiales ne se situe pas dans un objet qui, au final, se maîtrise mort ou vivant mais dans une folle poursuite où on se lance armé de poignards, dans une passion nourrie par la perversité et le crime jusqu’à ce que, si possible, s’effondre le poursuivant et non la victime. Mula Jusuf confine la fille qu’il désirait dans une pièce close, donc dans une cage. Mais il poursuit cette créature à demi folle dans cette cage, un rasoir dans la main ; et il ne se jette pas sur la fille après le premier sang, mais après le troisième, quand un jet rouge lui jaillit de la gorge, au moment, donc, où elle se meurt ou est déjà morte, quand la poursuite a donc atteint son terme ultime… À quoi aurait ressemblé ce matériau dans une nouvelle occidentale ? Nous aurions certainement jeté ce livre qui nous serait tombé des mains. Ces êtres étranges ne sont pas des bourgeois, ni la société, ils sont les pères et frères de personne, à coup presque sûr les fils de personne, ils sont les produits des effroyables récits orientaux. Des récits que nous lisons avec cet étrange tressaillement qui fait qu’aux côtés d’un vrai poète, y compris en enfer, nous nous sentons bien. Les hydres et les serpents n’appartiennent qu’à l’art oriental.
Autre trait caractéristique des contes d’Andrić, ceux qui portent l’événement, les héros, sont toujours des hommes. Les femmes sont dissimulées, secondaires, en dessous de la vie, elles ne sont pas des personnages mais des moteurs. Ou elles sont des apparitions mauvaises telle la femme d’Erzerum dans les effroyables rêves de Mustafa Madžar, ou elles passent la tête enveloppée dans une bošča [foulard] ; ou elles se laissent juste deviner derrière les fenêtres fermées, excitant ainsi – et comment ! – tout l’environnement masculin y compriscet idiot édenté d’Alija ; ou elles surviennent et passent de façon épisodique souriantes et dévergondées, faisant advenir chez un homme ce qui sera un détail du conte, ou comme Ivka Giguša, « la vieille pezevenkuša [maquerelle], pour servir d’intermédiaire à l’homme dans sa traque amoureuse. Ordinaire, voluptueuse, primitive, la femme est là pour que l’homme la poursuive, l’aguiche, lui fasse peur, l’agace, la chasse et la prenne ; ou pour causer à l’homme quelque souffrance, susciter en lui un véritable ou immonde héroïsme, faire en sorte qu’il soit « heureux de voir venue l’heure où la force va parler ». Đerzelez s’écrie devant Zemka : « Elle est… mon ennemi ! » ; d’un bond il est sur pied, il se débat, écarte les bras, et s’il n’était pas fin soûl, qui sait ce qu’il aurait fait… Le sevdah [chant d’amour triste (pluriel : sevdaci)], autre trait particulier de l’Orient balkanique (où l’abîme entre musulmans et les giaours créait de grandes peines amoureuses), n’entre pas au sens sentimental dans le conte d’Andrić. Ceci, parce qu’à l’inverse de Svetozar Ćorović qui nous a laissé d’immortels sevdaci, Andrić n’a pas encore travaillé l’intérieur, ni l’Orient mélancolique avec ses âmes orientales, subtiles et languissantes. Mais ce qui s’est inscrit dans son plan, l’amoureux ridicule, il nous l’a donné, comme personne d’autre, dans son Đerzelez. Celui-ci, avec une liste complète de chagrins et de scandales, soupire, aspire, et rate, l’une après l’autre, la kaurka [l’infidèle] habillée « de fourrure et de velours », puis Katinka, puis Zemka « sa blanche Tsigane », puis « la grassouillette veuve et juive passionnée », pour finir avec celle que chacun peut avoir dès lors qu’il en a envie et faute de mieux, Jekaterina à Donji Tabaci.
L’Orient apparaît chez Ivo Andrić avec un autre trait caractéristique, le désir aveugle, fou, barbare de posséder une femme, ce que Borisav Stanković nommait « le sang impur » et que lui appelle « le sang malheureux ». Les Turcs de ses contes tendent des bras de déments au passage des femmes. Le dépit et les querelles, les excès de table et de boissons aidant, le désordre sexuel est là, permanent. Quoique mourant, Mameledžija se traîne sur le sol nu pour toucher un dimije [pantalon bouffant porté par les femmes]. Đerzelez, devant la fenêtre fermée des femmes infidèles, entre dans une rage folle et enfourche son cheval poussé par « le désir insensé de tuer et d’offenser le premier venu ». Ces hommes tiennent entre eux des conversations des plus lascives quand le feu les soulève ; parallèlement au jeûne du ramadan, « pendant le temps crépusculaire qui précède ifter [repas pris après le coucher du soleil] », « de l’étoile à l’étoile » il leur est interdit de manger, de boire, de fumer ; la démence les gagne, toutes ces privations se transforment, la nuit, en un besoin de femmes. L’accord le plus doux dans lequel cette passion peut s’achever, c’est le dert [le chagrin]. L’imagination et la souffrance agitent Đerezlez comme un chiffon, il voit Zemka sur une balançoire et regarde son dimije « former cent plis et cingler le ciel ». Et quand des femmes tsiganes chantent : « Đerzelez est tombé malade, aman [pitié], aman », une chanson qui est apparue plus tôt, alors qu’il était gravement blessé, le chagrin s’empare de lui, il n’est plus à même de dissocier le temps présent de celui d’avant, il mélange tout, et « un frisson tantôt brûlant, tantôt glacial » le parcourt tout entier.
L’un des rayonnements intérieurs les plus puissants de l’Orient d’Andrić est le pouvoir de la suggestion, une suggestivité qui, dans ses contes, remplace l’analyse occidentale. Mustafa Madžar est sans doute l’exemple le plus fort et, certainement, le plus virtuose de ce pouvoir, un pouvoir qui fait que, le récit progressant, vous ne vous tenez pas immobile, dans l’expectative, dans l’attente que le héros se transporte jusqu’à vous et se conforme à votre compréhension et à votre ressenti ; plastique, entier, brûlant, il demeure au contraire à sa place et dans son temps, et vous, lecteur, êtes transporté dans sa proximité immédiate, introduit dans le cercle vivant de sa personnalité. Andrić est un vrai magicien quand il parvient à ses fins. Il vous arrache et vous emporte là où vous êtes comme entouré d’une multitude de miroirs où chaque détail, de chacune de ses faces, se reflète une centaine de fois, si bien que vous vous sentez formellement grisé par l’immédiateté et la couleur, que vous vous mettez à chantonner et à cligner des yeux, que vous seriez prêt à vous battre si la lanterne orientale bariolée s’éteignait et que le mejdandžija [le combattant] ou que la foule des hommes et des femmes tombait dans l’obscurité… Toute analyse s’avère là naturellement superflue. En vérité, devant aucune analyse l’homme ne tressaillira ni ne tremblera ainsi qu’il tressaillirait et tremblerait si une foule le prenait à partie ou si une personnalité mystérieuse l’observait et, à proximité de lui, poussait de profonds soupirs ou gémissements. D’un seul coup tout est clair…

Ivo Andrić : Contes au fil du temps
Le profil psychologique de Mustafa Madžar est très complexe. Dégénéré, hypocondriaque, halluciné, c’est un porc, une bête, un sanguinaire, un malfaiteur pervers qui, alors qu’un autre tirerait en l’air, « saisit un court fusil et ouvre le feu sur le coin sombre où sont couchés les frères ». Mais, par ailleurs, il possède une pensée plus raffinée – il est allé à l’école –, une âme plus raffinée – il jouait d’un instrument et goûtait la musique – il est même un malfaiteur plus raffiné : il tue Abdulselambeg avec esprit, élégance, et propreté comme s’il disputait une partie d’échecs. Avec plus de hauteur il observe les choses, il a des moments d’ébranlement et de peur ; dans toute une série de semblables héros dépeints par Andrić, lui seul atteint ce haut degré de répugnance qui, conséquemment, gagne en force et façonne une pensée déterminée et un regard sur le monde qui tiennent dans les paroles avec lesquelles il meurt : « Le monde regorge d’ordures ! » Et ce Mustafa, avec ses abominables insomnies, ses visions, ses crises de démence et ses crimes, est et reste exempt de toute analyse moderne, par la toute-puissance de suggestion du narrateur dont s’exprime la merveilleuse imagination mais dont jaillit aussi une force que l’on pourrait presque dire non baptisée avec laquelle il évoque les temps anciens et commande aux ombres de vivre… Nous le dirions parce que ce pouvoir de suggestion n’est pas le simple reflet du talent et de la technique artistique d’Ivo Andrić mais une qualité plus encore profondément ancrée. Un don en droite ligne de cette vieille Bosnie qui n’accorde aucune quiétude à Andrić à travers Dieu sait quels ancêtres ou Dieu sait quelle force mystérieuse provenant des contrées et de l’existence orientales…
Quelle était donc cette vieille Bosnie et que pouvait-elle offrir ? L’art d’analyser ou le pouvoir de suggérer ? La raya, puis les Bosniaques musulmans, puis les Stambouliotes ; le mélange, l’agitation, les frictions, les conflits, la violence, la haine – tout cela dans la peur éternelle et l’obscurité. Le Bosniaque turc martyrise et méprise la raya, le Stambouliote n’a que mépris pour tout ce qui est la Bosnie. La fourberie, les intrigues, l’espionnage, la surveillance, les vexations, les vengeances. Et, en fin de compte, les guerres et la misère. Et rien d’autre. De telles circonstances ont naturellement produit des existences amorphes, sans cours ni tendances, parfois affreusement dissociées et aliénées, parfois entremêlées en un écheveau telles les existences d’êtres les plus inférieurs. La čaršija stupide et paresseuse, les autorités friponnes, l’existence de la raya sans modalité aucune, les pulsions et passions sans véritable répit nulle part et que le moindre prétexte suffit à réveiller. Si en des temps plus récents, une danseuse de cirque – la Souabe de Ćorkan – avive ces passions, comment cela devait-il être auparavant, jadis, quand arrivait soudainement un prétendu brave, ou un bandit, ou un Stambouliote jouissant d’un « pouvoir dûment illimité ». Et une fois de plus nous nous interrogeons : qu’ont donc à faire ici l’analyse, la psychologie, l’abstraction ? Où faut-il qu’elles débutent, sur quoi doivent-elles s’achever ? Non, c’était là une vie étrangère aux conclusions. Ceci, parce qu’on ne se laisse pas aller à réfléchir sur elle. Parce que la réflexion est supplantée par l’imagination, l’amour de l’aventure, l’expression concrète et suggestive. Et aussi par quelque chose encore : ce mystérieux qui n’a pas de nom et qui se dissimule chez tout enfant de l’Orient et, notamment, chez l’artiste ; ce quelque chose de spécifiquement oriental et que nul ne peut posséder et que nul ne peut transmettre s’il n’est pas né là où le soleil se lève. Ce quelque chose que Pierre Loti n’a pu acquérir en Orient ; ce quelque chose qui fait défaut au grand poète français Barrès et le rend fastidieux dans son Jardin sur l’Oronte. Ce quelque chose qui, en Orient islamique enclot les maisons, les jardins, et les gens ; et, en Extrême Orient, compose les célèbres énigmes de la boîte et du sac dans lesquels on cache des lettres, des objets précieux, et, qui sait, peut-être aussi des larmes ; ce qui, enfin, brille d’un éclat vif et enchante dans les contes d’Ivo Andrić.
* * *
Le fossé qui sépare Ivo Andrić auteur d’Ex Ponto et d’Inquiétudes et Ivo Andrić conteur de la Bosnie ne manque pas d’intérêt. Dans ces œuvres il se révèle un prosateur et un styliste élégant, magnifique, tendre et sensible. Ici, avec sa puissance et son art, il transforme cette masse voluptueuse et frénétique en personnages ardents et pittoresques. Jusqu’à quel sommet élève-t-il l’histoire sur les violents sauvages et les âmes noires, il les met en relief avec un grand art, comme une première tempête d’individualisme et de volonté. Demeurent inoubliables devant les yeux et dans l’âme ces énigmatiques delije incapables de différencier le jour de la nuit, la honte de la peur, Dieu de notre prochain, la loi de la patrie, ces personnages que seule la mort devrait guetter et, telle la foudre, subitement frapper… L’Occident et la perception humaine en général, voilà ce qui dans les contes d’Ivo Andrić touche notre sensibilité artistique la plus délicate. Mais ce qui attire autant que les profondeurs, qui nous fait aborder ces contes avec soif, c’est l’Orient. L’Orient qui fait que c’est émerveillés que nous laissons les personnages d’Andrić. Des personnages qui bombent le torse de manière aussi magistrale et qui, en dépit de tous les scandales, sont en quelque sorte grands avec ce mystérieux dont « le sang en eux tisse et croît ».
[1] Le titre exact de ce conte est : Put Alije Đerzeleza [Chemin d'Alija Djerzelez]. (Note du traducteur.)
Traduit du serbe par Alain Cappon
In Srpski književni glasnik, 1923.
Date de publication : octobre 2017
Date de publication : juillet 2014
> DOSSIER SPÉCIAL : la Grande Guerre
- See more at: http://serbica.u-bordeaux3.fr/index.php/revue/sous-la-loupe/164-revue/articles--critiques--essais/764-boris-lazic-les-ecrivains-de-la-grande-guerre#sthash.S0uYQ00L.dpuf
|