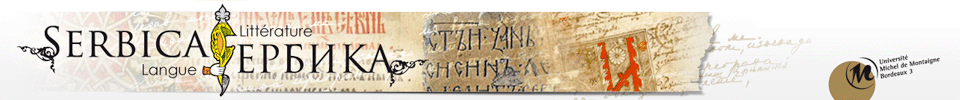|
Bibliographie
Site référentiel
|
Romancier de renommée internationale et unique prix Nobel de l’ex-Yougoslavie, Ivo Andrić était considéré dans son pays, déjà de son vivant, comme un classique. Après sa mort, il est devenu – malgré les contestations non fondées provenant ce dernier temps d’un cercle des intellectuels musulmans bosniaques – l’incarnation de l’écrivain absolu : celui qui représente non seulement une incontestable référence littéraire mais aussi une infaillible autorité morale. Andrić-écrivain et Andrić-homme : talent à multiples facettes, le premier possédait à la fois la connaissance de l’historien et la sensibilité du psychologue, la patience de l’archéologue et la profondeur du philosophe, la sérénité du sage et la clairvoyance du visionnaire ; le second, militant dans sa jeunesse dans l’organisation révolutionnaire « La jeune Bosnie » avant d’embrasser une carrière de diplomate durant l’entre-deux-guerres, avait tendance à s’effacer progressivement au profit du premier en se sacrifiant jusqu’à l’abnégation pour sa mission littéraire.
Opus magnum balkanicus Ce statut de véritable sanctuaire littéraire – fortifié par le succès de ses nombreuses traductions à l’étranger qui l’a hissé au rang des auteurs majeurs des Balkans et des lettres slaves en général – Andrić l’a mérité, bien sûr, grâce à son œuvre. Une œuvre considérable tant par sa portée que par son volume, qui se présente en fait comme une sorte d’archipel littéraire dont de nombreuses « îles » restent encore dans l’ombre de ces deux « phares » flamboyants traduits dans le monde entier : Le Pont sur la Drina (Na Drini ćuprija, 1945) et La Chronique de Travnik (Travnička hronika, 1945). Cet archipel andrićien, cet opus magnum balkanicus explore d'abord bien sûr les aléas et les mystères du destin troublant de l'hommo balcanicus. Mais, en même temps, il pourrait être lu comme une quête artistique sur le bien et sur le mal, sur l’histoire et la légende, sur la « réalité » et ses apparences… bref, sur le sort de l’homme en général. La meilleure expression de la quête de ce conteur-né que fut Ivo Andrić, ce sont évidemment ses romans et ses nouvelles : d’abord ses grandes fresques romanesques déjà citées, mais aussi ses récits « Le Pont sur la Žepa » (Most na Žepi), « Au Temps d’Anika » (Anikina vremena), « La Soif » (Žeđ), « L’Eléphant du vizir » (Priča o vezirovom slonu), « Mara la courtisane » (Mara milosnica) ..., sans oublier La Cour maudite (Prokleta avlija, 1954), une allégorie que l’on pourrait dire à la fois dantesque et kafkaïenne, et son dernier chef-d’œuvre, malheureusement inachevé, Omer pacha Latas. Adepte d’une esthétique reposant sur le principe de l’harmonie simple, « naturelle », et sur le sens de la mesure, Andrić privilégiait, dans la mise en forme de ses récits, les modèles narratifs dits traditionnels qui peuvent paraître presque trop classiques aux yeux d’un lecteur sensible à la novation formelle. Mais il travaillait sur la composition et la structure de ses histoires avec les scrupules et la conscience d’un artisan – d’un horloger, aurait dit La Bruyère –, toujours soucieux d’adapter leur forme à la logique intérieure émanant du récit lui-même. Andrić est souvent présenté comme le fidèle adepte d’une esthétique réaliste reposant sur les principes de la mimesis. Cette image de l’écrivain est, évidemment, réductrice. Andrić est un réaliste qui transgresse sans cesse les règles admises : s’il porte un tel intérêt au monde du réel, c’est pour tenter de percer ses secrets, pour mieux dénicher ce qui se dissimule derrière la réalité apparente. Et puis, cette image risque d’occulter le nombre des récits où l’écrivain traite de thèmes métaphysiques, donne libre cours à son imagination ou explore le domaine de l’inconnu : récits méditatifs, allégoriques ou encore récits d’inspiration poético-fantastique dont la parfaite illustration est la nouvelle « Yéléna, celle qui n’était pas » (Jelena, žena koje nema, 1962). Une ruche sur le volcan Ce qui impressionne en particulier dans cet opus magnum balkanicus, c’est avant tout l’immense galerie des personnages qui peuplent un univers littéraire ressemblant à une gigantesque ruche humaine. C’est un microcosme sans cesse tiraillé entre les anges et les démons, où existent l’amour pur, les sentiments nobles et raffinés, la bonté innée et généreuse… Mais aussi, et surtout, les bourrasques de la violence irrationnelle et les tempêtes du mal déchaîné, la haine souvent gratuite et insensée, les passions survoltées et destructrices, les instincts ataviques non maîtrisés… La preuve en sont tous ces « maudits », ces malchanceux en proie à des instincts opaques, incompréhensibles: leur vie n’est pas une vie mais l’enfer qui s’abat sur eux comme un châtiment de Dieu ou du Diable et qui leur paraît dépourvu de sens ou de raison apparente. Dans cet univers explosif coexistent – mais peut-on vraiment parler de coexistence s’agissant d’êtres souvent séparés par un fossé infranchissable ? – des peuples et des individus d’origine et de confession diverses, mêlés par le destin et l’histoire, par la force de la vie et l’instinct de survie. En un mot, un véritable tohu-bohu balkanique : les petites gens de Bosnie, la « raïa » sans pain ni droit, les dignitaires osmanlis au-dessus de la loi – vizirs, pachas, séraskiers, muftis, beys, kaïmakams… –, les haïdouks serbes, les apostats du murtad tabor turc, les hors-la-loi sans racines ni nationalité et les brigands de tout poil, les popes, les hodjas, les rabbins, les pères franciscains, les originaux sans domicile fixe, les solitaires errants, les clowns sans cirque, les fous du roi sans palais ni royaume, les crieurs publics, les poètes-nés, génies illettrés, et les artistes imaginaires ou ratés, les don Juans à la manière rustre, orientale et balkanique et les putains dégoûtées de l’amour humiliant, les femmes vieillies avant l’âge, les égéries paysannes hantées par le démon de la chair et les belles inconnues, miracles de la nature, à la grâce divine… Cet immense univers est un empire des mâles où les femmes sont contraintes de jouer un rôle secondaire, dans l’ombre. Leur destin, dénoncé fortement par l’écrivain, est de ne pas être mais de servir. Le plus souvent, elles sont réduites à un simple objet qui subit la volonté des hommes, qui obéit et qui souffre, ou que le mâle consomme pour assouvir ses besoins charnels. Dans cette ménagerie masculine, il y a cependant quelques femmes d’exception, au destin singulier (telles que Anika, Fata ou encore Saïda Hanum), dont les portraits sont brossés avec une force et une sensibilité étonnantes. Le destin de certaines d’entre elles est marqué à jamais par le sceau d’une beauté fatale, tragique ou maudite. Un mot clé : le pont Parmi les personnages andrićiens il y en un, cependant, qui mérite une attention toute particulière : le Pont ! Surtout celui qui surplombe la rivière Drina : magnifique et indestructible, cette œuvre d’art est bien sûr un personnage à part entière. Un personnage unique sans doute dans la littérature mondiale ! Le pont, la ćuprija, est tout d’abord un symbole et une métaphore. Peut-être même le mot-clé de la philosophie humaniste de l’écrivain. Car c’est à travers lui qu’Andrić a voulu, ne serait-ce que métaphoriquement, trouver un trait d’union salvateur et relier les mondes opposés, séparés, hostiles. Les mondes visible et invisible, réel et irréel, obsédé par le mal ou en quête du bien… Les mondes éloignés par le temps, celui de l’Histoire et de la légende et celui du présent, de la vie quotidienne… Les mondes coupés les uns des autres par les barrières géographiques, les fossés culturels et les différences spirituelles : celui de l’Orient et celui de l’Occident, celui ancré dans la tradition et celui tourné vers la modernité, celui de l’islam et celui de la chrétienté… Le monde des lisières, enfin, déchiré en son for intérieur et entre ceux qui, en conflit permanent, bordent ces lisières : la Bosnie avant tout, l’incarnation même, tragique et douloureuse, dans la vision andrićienne, de tous les clivages, de tous les fossés, de tous les malheurs. La Bosnie divisée, déchirée, blessée qu’Andrić a tenté, à travers cette puissante et majestueuse image du pont, de réconcilier avec elle-même et avec les autres. Originaire de cette région, Croate de naissance mais Serbe de son propre choix, Ivo Andrić s’est intéressé passionnément, douloureusement, toute sa vie durant, même après son installation à Belgrade, à son pays natal. Il lui a consacré la majeure partie de son œuvre en s’efforçant – contrairement à ce qu’ils affirment ses contradicteurs bosniaques, ceux qui l’accusent injustement d’avoir donné « une fausse image » de la Bosnie –, de sonder ses mystères, de cerner ses paradoxes et son destin historique tourmenté. Inspirés par l’Histoire et par l’héritage culturel populaire, les récits andrićiens consacrés à la Bosnie, hauts en couleur locale, dépassent pourtant largement le cadre d’une littérature régionaliste. Conteur au verbe ardent, héritier moderne du génie populaire, Andrić est avant tout, et surtout lorsqu’il parle de son pays natal, un quêteur opiniâtre de vérités universelles : ses histoires sur le destin émouvant des petites gens laissées à la merci d’une Histoire cruelle et aveugle soulèvent en effet les problèmes éternels qui touchent à l’essence même de la condition humaine. Parmi les écrivains serbes, Andrić est le plus connu à l’étranger. Ses livres sont traduits et régulièrement réédités dans le monde entier. Le prix Nobel, reconnaissance juste de la portée universelle de son œuvre, lui a été décerné en 1961. Milivoj Srebro |
|