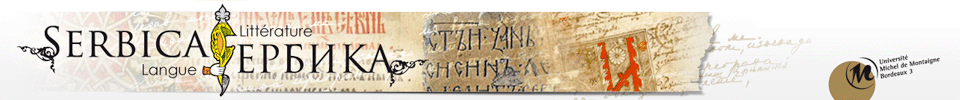|
|
IVO ANDRITCH : PRIX NOBEL DE LITTERATURE 1961 « JE SUIS UN PESSIMISTE TOURNÉ VERS LA VIE »
In : Le Figaro Littéraire, |
|
De notre envoyé spécial, à Belgrade, George Adam Belgrade, 27 octobre [1961]. Je n’avais pas fait deux pas dans la petite antichambre qu’une lumière éblouissante jaillissait d’un projecteur et m’aveuglait. Une caméra braquée sur moi se mit à ronronner ; quelques photographes enregistrèrent mon image de face et de profil. Je n’en tirai aucune gloriole et ne me crus pas devenu soudain une vedette de cinéma, ayant compris, depuis la veille, que la Yougoslavie tout entière a pris à son compte le prix Nobel 1961. Comme j’avais demandé en débarquant un numéro de téléphone, dont je ne pouvais m’imaginer qu’il en connût l’abonné, le portier de l’hôtel s’était écrié dans un grand rire : « Ah ! Ah ! Vous êtes venu voir notre Ivo Andritch ! » – C’est vrai, me disait celui-ci un peu plus tard, alors que nous étions installés en tête à tête dans son bureau, mes compatriotes en font vraiment leur affaire à eux de ce prix Nobel ! On dirait qu’ils se défont ainsi du complexe inévitable qu’éprouvent les petites nations devant les grandes. Tenez, j’ai reçu d’une localité perdue à l’autre bout du pays la dépêche suivante : « Ému et fier, je vous félicite. – Anka Milovanitch, lycéen de première. » Et Mme Andritch, qui m’a apportait le café à la turque et le cognac, offrandes traditionnelles de l’hospitalité yougoslave, de me montrer aussi une lettre d’étudiants ayant pour toute adresse un portrait du lauréat découpé dans le journal Borba.
Stockholm, décembre 1961 : Tout cela, pourtant, n’était venu que fort tard dans la conversation. Car, d’entrée de jeu – jamais je n’ai éprouvé tant de difficultés à faire parler un écrivain de son œuvre ou de lui-même – mon hôte avait renversé les rôles. Il me demande longuement des nouvelles de Paris, des dernières publications littéraires, d’amis que nous découvrons communs : Claude Aveline, Luis Guilloux, Jean Cassou « dont le texte sur la conscience humaine a été tellement important pour la Yougoslavie, il y a une douzaine d’années, au moment de nos ennuis avec Russes. » Et connaîtrai-je par hasard l’auteur de ce livre : Lire et écrire, qui se trouve là, à côté de l’Anthologie de la prose française de Marcel Arland, avec des revues et des journaux français tout récents ? Si, je connais Maurice Chapelan, lui dis-je, mais c’est mon voisin de bureau au Rond-Point ! Il en est tout ravi, car ses lectures préférées sont nos moralistes du dix-huitième et, dans l’admiration pour Joubert, il communie avec Chapelan « dont les pensées et remarques coïncident avec celles de ma propres expérience spirituelle ». Mais quand, ayant retenu ce propos et y revenant, je l’exhorterai à plus de confidences, il aura toujours pour s’en défendre ce sourire très doux et un peu triste qui ne le quitte jamais. C’est peu de dire que la gloire du prix Nobel ne lui est en rien montée à la tête ; il semble au contraire qu’on a déjà eu l’occasion, à Belgrade, de le vanter à plusieurs reprises. – On n’arrête pas maintenant de me demander des détails sur ma vie et mes conceptions d’écrivain. Or ma vie est dénuée de tout pittoresque. J’entre dans ma soixante-dixième année. Ma santé me cause un souci et j’ai dû me refuser de me rendre en Inde où j’étais invité aux fêtes pour le centenaire de Tagore. Il est vrai que, depuis mon enfance, je n’ai jamais été ce qu’on appelle bien portant. Mais, c’est ceux-ci dont on dit, jeunes, qu’ils ne feront pas de vieux os que l’on voit atteindre un âge avancé comme le mien… Avancé ? Je proteste avec vigueur. Il est loin de paraître son âge. Il est mince, droit, d’assez bonne taille : ce chevelure lisse, bien fournie et partagée par une raie sur le côté, grisonne à peine. Son regard rayonne de chaleur, de bonté, de jeunesse derrière les lunettes à la grosse monture d’écaille. – Et comme écrivain ? J’appartiens à la catégorie de ceux qui ne se connaissent pas. On vous croit difficilement quand on affirme cela. Mais, toute comparaison avec Michel-Ange mise à part, je pense souvent à ce qu'il écrivait dans une lettre alors qu'il était déjà vieux : « Vous ne pouvez pas croire à quel point je me sens de peu de valeur ». Et moi, il me semble que je n’ai jamais réussi à apprendre mon métier d’écrivain. Quand je m’assois à cette table pour commencer une nouvelle, j’ai le sentiment de n’avoir jamais rien produit auparavant. Je ne cesse de me dire : « Mon Dieu, voila qu’on te prend pour un écrivain, il faudrait le prouver. » Sans doute peut-on m’appliquer ce qu’a dit un des nos anciens poètes : « Il brûle, mais il cache sa flamme. »
Andrić devant le pont sur la Drina à Višegrad Il écrit pourtant depuis sa prime jeunesse. Né à Travnik (Bosnie), il est écolier à Vichegrad, puis lycéen à Sarajevo. Dès avant 1914, il traduit Walt Whitman et écrit des poèmes au cours de ses études à Zagreb, Vienne et Cracovie. L’étudiant, à juste titre suspect aux Autrichiens, est jeté en prison jusqu’en 1917, et cette captivité lui inspire un journal lyrique qu’il publie l’année suivante sous le titre, à la manière d’Ovide, Ex Ponto, et dont le fond spirituel se ressent de l’influence de Kierkegaard – le seul écrivain qu'il ait lu en prison. Il publiera encore un volume de poèmes en prose : Inquiétudes, avant d’aborder le conte, le récit romanesque. Il vient d’entrer dans la carrière diplomatique, ce qui ne tardera pas à lui faire connaître quelques grandes capitales : Bucarest, Madrid, Bruxelles, Genève. La deuxième guerre mondiale le trouvera en poste comme ministre à la légation de Berlin. A part cette dernière période dont il a chassé de son esprit les mauvais souvenirs (« J’ai tiré une barre là-dessus ! », me dit-il avec un geste énergique), la vie d’Andritch – comme l’a souligné son biographe Petar Dzadzitch – « se déroule paisiblement, comme sa carrière diplomatique, sans heurts venus du dehors et sans changements, et comme si toute son énergie était coulée dans la réalité de ses visions ». – Chateaubriand l’avait bien vu : il faut abandonner la lyre avec jeunesse. Très doucement ont commencé à mûrir en moi des nouvelles inspirées par ma Bosnie natale, par son histoire : trois siècles et demi d’oppression ottomane sur des populations diverses, opposées par l’origineou la religion – Serbes orthodoxes, Slaves chrétiens ou islamisés,Turcs, juifs… puis, trois quarts de siècle de domination autrichienne. Un chaudron de sorcière plein de haine et de passion, ce chaudron étant une Bosnie terrorisée, renfermée, prête au mal ! |
Entre 1924 et 1941 (année qui le vit rentrer à Belgrade et s’y terrer), Ivo Andritch publie trois recueils de contes, parfois d’un réalisme cruel, souvent pleins de la poésie qui émane d’une Bosnie un peu mythique, riche en légendes et en traditions populaires, il les a ciselés dans le calme, le silence et aussi dans la solitude qu’impose une langue (le serbo-croate) de diffusion faible, sinon, oserai-je dire, pratiquement nulle au regard des florissantes littératures occidentales.
Sur une terasse à Belgrade en 1944. A droite, une explosion : – Jusqu’en 1943, qui vit se concrétiser l’espoir né de l’existence des maquis yougoslaves, j’ai connu ici la même vie que celle de vos écrivains à Paris, sous l’occupation. Il m’est ainsi arrivé de rester des semaines sans mettre le nez dehors. J’écrivais avec le sentiment d’une liberté plus grande que celle connue jusqu’alors. Car je ne pensais pas que ces pages seraient jamais publiées. Un doute, même, m’habitait : resterai-je un conteur local, qui ne mettrait en œuvre que des qualités de pittoresque ou bien parviendrai-je à… comment dire ? sublimer, transcender la matière brute de mes récits pour leur donner une portée plus grande, plus universelle ? Il écrit ainsi coup sur coup trois romans qui, dans son œuvre, constituent jusqu’à présent le gros de la charpente. La Chronique de Travnik est, pendant huit années, celle de sa ville natale ; mais au début du siècle dernier, alors qu’un consul de Napoléon est venu s’y installer – le vizir ottoman ni la population ne comprendront jamais pourquoi – bientôt rejoint par un autre consul, envoyé, lui, par les Autrichiens. Entre ce roman et Mademoiselle – étude de caractère, assez balzacienne de facture me dit-on – se situe le roman qui, dès sa publication en 1945, devait lentement cheminer à travers le monde par le canal des traductions (il a paru chez nous en 1956, aux Éditions Plon, traduit par Georges Luciani) : Il est un pont sur la Drina. C’est encore un roman chronique, de Vichégrad cette fois, ville où la mère d’Andritch, veuve à vingt et un ans, était venue trouver asile auprès de parents et où son fils fit ses études primaires. Il est en effet, à Vichégrad, un pont sur la Drina dont certaines arches seulement (car il fut bombardé au cours des deux dernières guerres) remontent à la construction originelle en 1571. Au fil des ans, de sa fondation à 1914, il en a vu des choses, ce pont, surtout en cet endroit privilégié qui s’élargit tout en son milieu, où la bourgade se donne rendez-vous pour le café et les commérages et qui s’appelle « la kapia ». Le roman, ce sont quelques-uns des plus marquants parmi les souvenirs de ce pont. C’est surtout, puisqu'il peut parler par la plume d’Ivo Andritch, la philosophie qu'il s’est lentement constituée. – …Sur la kapia, entre le ciel, la rivière et les montagnes, les générations successives apprenaient à ne pas s’affliger outre mesure de ce qu’apportait l’eau trouble de la Drina. C’est là qu'ils adoptaient la philosophie inconsciente de la petite ville : la vie est un miracle incompréhensible, car elle se dépense et se dilue sans cesse et pourtant dure et se maintient solidement « comme le pont sur la Drina ». Sincèrement désolée, Mme Andritch est venue interrompre notre conversation : son mari est attendu à l’Union des écrivains yougoslaves – il en a été le président pendant plusieurs années et fait toujours partie de son comité directeur. Nous avons dû nous arracher au calme de son cabinet de travail, tapissé de bibliothèques comme il se doit, les livres français à la place d’honneur sur les rayons.
Andrić dans son cabinet de travail Dehors, le soleil d’octobre dore gaiement les arbres du parc des Pionniers que nous traversons en diagonale pour atteindre le boulevard de la Révolution et le Parlement – où Ivo Andritch a siégé naguère comme député. Même en longeant la place Marx-Engels devant le haut immeuble sévère qui abrite le Comité central du parti, il m’est difficile de me croire en pays « communiste », toujours, il est vrai, fortement hérétique aux yeux de cette Eglise. Autour de nous des photographes dansent un ballet incessant. Des passants, reconnaissant leur prix Nobel, le saluent d’un sourire, d’une exclamation joyeuse. – Je suis frappé par le rôle important que joue dans votre œuvre le thème du pont ! dis-je en pensant à la nouvelle : Le pont sur la Jepa, dont je lui ai demandé de me confier la traduction à l’intention des lecteurs du Figaro littéraire. – Ce thème me hante en effet depuis toujours. Tout dans la vie devrait être un pont entre les êtres, comme le sourire, par exemple. Dans un poème écrit vers 1932, je disais à peu près, en parlant des ponts : ils sont plus sacrés que les temples car ils servent aux hommes à se rapprocher. Pour les musulmans de ma Bosnie, le pont est même chose sainte. A sa création, disent-ils, le monde était une chose molle que le diable, pour se venger, griffa profondément, créant ainsi des vallées escarpées, en apparence infranchissables. Mais les anges y placèrent des ponts faits de leurs ailes !
(Andrić est le premier à droite) Philosophie optimiste, tout de même nuancée de ce détachement que souligne la phrase, citée tout à l’heure, du Pont sur la Drina. Et pourtant, bien des scènes de ce livre, pleines de cruauté et d’horreur, ne démentent-elles pas cette attitude foncière ? – Je sais, me dit Ivo Andritch, mais des empalés comme celui dont je décris le supplice, il y en eut des milliers en Bosnie. Le tableau que je peins est noir, peut-être, jusque dans le sens allégorique qui s’y trouve. Mais quelqu'un a fait remarquer qu'il y avait toujours dans ce tableau un point lumineux qui suggère une issue. C’est que, voyez-vous, peut-être suis-je un pessimiste qui a visage tourné vers la vie. George Adam |