|
UNE FORCE RARE DE SOUFFRANCE ET D'HUMANITÉ
par
CHRISTIAN MOUZE
C'est une suite de tableaux de l'exil et de la misère d'un couple d'émigrés russes à Londres, au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Cette œuvre a une surface qui étincelle : la fiction romanesque.
Pourtant l'envoûtante beauté du style nous conduit dans des abysses de douleur. Une souffrance telle, qu'un lecteur ignorant tout de la vie de Milos Tsernianski (1893‑1977), écrivain serbo‑croate, ne pourrait pas ne pas soupçonner une autobiographie et une confession morale voilées.
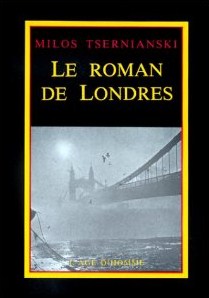
Miloš Tsernianski / Crnjanski : Le Roman de Londres
Trad. du serbo-croate par Velimir Popovic. L'Age d'Homme, 1992, 551 p.
Ce n'est pas un hasard si Tsernianski choisit des héros russes. On sait en France depuis la traduction de Migrations, cet autre chef-d’œuvre de Tsernianski, ce que, avec l'exil, représente la Russie pour les Serbes, peuple combatif et errant.
Tsernianski (émigré de 1941 à 1965) était précisément à Londres les mêmes années que son héros, le prince Repnine, ex‑officier d'état‑major de l'Armée Blanche. Comme son héros il connaît les emplois précaires et comme la femme de son héros, Nadia, sa femme confectionne et vend pendant la guerre des poupées de chiffon. Enfin, Repnine et Tsernianski se laisseront glisser vers la mort.
Londres
Le Roman de Londres c'est d'abord Londres, l'omniprésence de la ville à chaque ligne de l'œuvre et la fascination/répulsion qu'éprouve le prince. Le mouvement des rues et du métro, les ruines des bombardements, la course au travail et au logement, les devantures, monuments, jardins publics où l'on s'assoit pendant la pause de midi, la foule et la solitude ‑ tout ce quotidien d'une métropole qui capture et captive Repnine et cependant le rejette chaque jour dans sa condition de "personne déplacée".
C'est toute une coupe sociale que, de par sa situation, le héros alors connaît : cercles d'émigrés slaves mêlés de haute société, officiers démobilisés en quête de réinsertion sociale, personnel des ateliers, arrière‑boutiques et autres remises, restaurants de petits employés, files de chômeurs, fonctionnaires de l'agence pour l'emploi, bureaux des cartes de séjour, etc.
Il y a une vérité sociale dans Le Roman de Londres – toute cette remise en mouvement, cette réorganisation d'une société après la guerre –, et, face à cela, avec cela, à cause de cela, une vérité d'un homme de plus en plus dépouillé qui se simplifie jusqu'à cet os : le non‑sens et l'à quoi bon de sa vie. Et auprès de cet homme, l'autre vérité tout aussi humaine, tout aussi simplifiée, tout aussi dépouillée, jusqu'à la plus pure compassion et jusqu'au plus pur amour (ce sens du non-sens), de sa femme, Nadia.
La Russie réelle
La Russie est le ressort cassé du vouloir vivre de Repnine.
Œuvrer utilement, humblement, cela même Repnine ne le peut plus parce qu'il frappe tout de non‑sens pour ne laisser intacte que la Russie, fût‑elle devenue Rouge. Aussi il s'abandonne aux nostalgies de Saint‑Petersbourg, mêle les monuments centenaires et les parades de l'Armée Rouge (dont il remarque le pas de marche tsariste), parmi ceux qui ne pensent qu'à s'établir, comploter, parvenir, arranger de conserve leurs affaires, leurs fornications et leurs consciences.
Réminiscences qui s'imposent à partir de sensations, événements, hommes, lieux, tout le rapporte à la Russie et à son enfance, à sa jeunesse. Repnine ne se nourrit que de soi, que de son histoire individuelle à quoi la "Russie réelle" (celle qui a vaincu l'Allemagne et demeure la gardienne de ses sources et de sa mère restée à Leningrad), peut donner encore un sens.
Mais parce qu'il sait ne pouvoir jamais la rejoindre, Repnine préfère asphyxier en lui tout espoir et va et veut jusqu'à la dépossession de soi.
N'en rester qu'au passé et à ses images, c'est, en fin de compte pour le prince, ne pouvoir vivre dans ce passé mort et comme allongé, selon la coutume russe, sur la table de sa conscience nue : réponse pour jamais hostile à une vie extérieure étrangère.
Le renoncement à l'amour
Un autre thème, en contrepoint de la souffrance, court le long du roman : l'approche de la vieillesse et le refus, chez Repnine, de vieillir en exclu avec Nadia. Eloigner Nadia tient alors de l'acte ultime de dépossession de soi. Repnine ne s'attarde pas à comprendre que la vie de Nadia n'a de sens qu'avec lui, que par lui, et préfère savoir que sa vie à lui, sans Nadia, est le dernier degré à descendre au désastre qu'il appelle.
La vie quotidienne de Repnine s'accompagne de souvenirs, d'images et de voix qui sont autant de commentaires sans merci, autant d'accusations mais aussi d'élans de fraîcheur dans le motif triste de Londres. Repnine se dédouble continûment, par rapport à son moi le plus reculé comme par rapport à son individualité sociale, et ce dédoublement n'est qu'un chemin d'identification au désespoir et à la mort.
Les expressions et mots russes, anglais, français qui émaillent le roman ressortissent à cette brisure, à ces fêlures, à ces fragilités, à cette déstabilisation sociale et culturelle des "personnes déplacées", eussent‑elles réussi en apparence leur insertion, et indiquent qu'une "personne déplacée" (peremechtchnaïa persona, displaced person) ne l'est pas seulement de son pays, de son histoire, de sa famille ou de sa langue mais, plus profondément, de soi – comme déjetée de son être.
Si dans ces conditions la réconciliation avec soi devient improbable, Milos Tsernianski nous prouve que l'œuvre d'art peut s'édifier à ce point précis de douleur et réconcilier en elle seule le désespoir et la vie.
| Extrait
Cet hiver‑là, quand commence cette histoire, commencèrent aussi le choc de deux mondes et le choc d'un homme avec une ville immense de quatre, huit et quatorze millions d'habitants. A cet homme‑là, les Anglais voulaient apprendre ce dont il avait et n'avait pas besoin. Apprendre ce qui avait un sens pour la vie et ce qui n'en avait pas. Ils s'échinaient à démontrer à tous ces malheureux qu'ils ne seraient bien que lorsque leurs enfants se seraient métamorphosés en citoyens anglais de ces britanniques îles. Les yeux ronds, ces personnes déplacées regardaient alors vers le lointain où, comme au travers d'une brume matinale et de larmes, s'estompaient les visages de leurs proches tant aimés et que – ils en étaient certains – ils ne verraient plus. Jamais plus, – nikogda.
Des visages de mères, de femmes, d'enfants.
Mais où donc existait‑elle cette vie si agréable dont on leur parlait aux cours de rééducation ? En Angleterre ? Où était ce bonheur ? "Vot tchoudnyï metamorfoz", marmonne un homme qui, au moment de frapper avec le heurtoir "anglais" quelques coups à la porte et d'appeler d'une voix sourde "Nadia, Nadia !", se retourne pour scruter les alentours.
|
In La Quinzaine littéraire, n° 603, le 16 juin 1992.
Publié avec l'autorisation de
http://www.quinzaine-litteraire.net
|