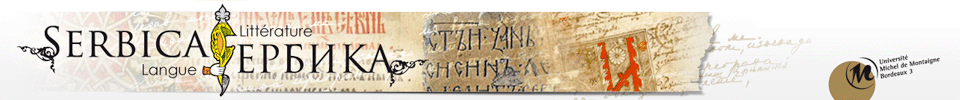|
|
Entretien avec Danilo Kiš Qu'est ce qu'un écrivain yougoslave à Paris ? Propos recueillis par Janine Matillon In : La Quinzaine littéraire , Publié avec l'autorisation de
|
|
Janine Matillon. ‑ Danilo Kis, un jour, à Belgrade, vous m'avez dit que s'il vous arrivait de donner une interview à un journal français, vous aimeriez surtout parler des intellectuels du même pays. Vous sembliez avoir un compte à régler avec eux. Ils vous ont fait quelque chose ? Danilo Kis. ‑ Oui, c'était il y a deux ou trois ans, et ah la la ! je pense bien qu'ils m'ont fait quelque chose ! À cette époque, l'intelligentsia française faisait des courbettes à Moscou, et tout ce qui ne croyait plus au "bilan globalement positif" faisait des courbettes à Mao. Et puis, soudain, tout s'est écroulé. Il ne leur reste plus que l'Albanie : à la vôtre !.… C'est à tout ça que je pensais à Belgrade, à la crédulité des Français (je tire mon chapeau aux exceptions), à ce rêve d'un monde nouveau et meilleur, dans lequel ils ronflent comme dans un bon lit, à toutes les illusions qu'ils s'entêtent à fabriquer, en dépit des faits, en dépit de tout. À leur monde en noir et blanc, ici c'est le Bien, ici c'est le Mal, là c'est la Gauche, là c'est la Droite, ils s'accrochent à cet équilibre. Et le plus bouleversant pour moi, c'est que ces intellectuels français, qui barbotent dans l'illusion, ces Français, hein, ces hommes libres et riches, ils disposent d'un vrai trésor, des témoignages, des voyageurs, des récits, des livres traduits, la presse, tout, les mass media, le train, l'avion pour aller voir ‑ ils pourraient tout savoir et ils ne savent rien, ils se trompent quand ils n'ont pas le droit de se tromper : il n'y a pas d'excuses ! Quand Madame de Beauvoir parle de son "bilan positif", quand elle dit "qu'elle ne savait pas", quand elle avance comme excuses "qu'ils étaient tous bêtes à l'époque", elle ferait mieux de se taire. Ils étaient peut‑être "tous bêtes", mais il y en a qui l'étaient plus que les autres, puisqu'ils sont allés à Moscou, ils ont entendu des témoignages, ils ont entendu ceux qui voulaient et pouvaient encore témoigner, ils ont entendu mais n'ont rien écouté. J. M. ‑ Oui, mais ça, c'était "avant". Ne trouvez-vous pas qu'un certain changement… D.K. ‑ Mais certainement, mais certainement… deux‑trois ans après notre conversation de Belgrade, l'intelligentsia française sait (en gros) qu'elle n'a plus pour mesurer le monde de mètre-étalon (reste l'Albanie !), alors ça lui cloue le bec, elle médite, l'intelligentsia, elle travaille dans le concret, hors système, c'est bien aussi grâce à certains nouveaux philosophes, mais quoi ? À la fin, rien. "Tout est bu, tout est mangé, plus rien à dire (1). (Rire)… C'est Verlaine !.… (Rire)…" J.M. ‑ Verlaine, bon, la culture française… D.K. ‑ Pourquoi, quand vous dites "la culture française", avez‑vous toujours l'air d'en avoir deux ? J.M. ‑ L'air d'en avoir deux ?.. Dites donc, c'est vous l'interviewé, pas moi. Attendez‑vous quelque chose de ce qu'on appelle la culture française ? D.K. ‑ Vous voyez, "de ce qu'on appelle"… la culture française, pour moi, aujourd'hui, c'est d'abord une culture de médiation, un sol, si vous voulez, où peuvent fleurir, enfin je veux dire pousser, une culture européenne et même une culture universelle. Pour être plus précis : il me semble que Paris est toujours, et de plus en plus, une vraie foire, vous savez, une foire aux enchères, où l'on vend aux enchères tout ce que le monde de la culture a craché ailleurs, sous d'autres méridiens…
Danilo Kiš, Strasbourg, 1964 J.M. ‑… Ça ne va pas mieux… D.K. ‑ Eh bien quoi, ce n'est pas vrai ? Il faut passer par Paris pour exister. La littérature hispano‑américaine, la grande littérature hispano-américaine, elle a existé avant les Français, comme l'existentialisme, le formalisme russe, etc., etc., mais pour être élevée au rang de patrimoine universel, pour devenir le Bien de la terre entière, il a fallu qu'elle passe par Paris. Voilà à quoi ça sert, la cuisine parisienne. Émigrations, universités, thèses et thèmes, traductions, explications : la cuisine, quoi. C'est ça, la culture française. Faire cuire et recuire, bien mâcher… Les recettes sont françaises. Seuls l'os à moelle et la viande sont d'importation. Vous voyez le danger : c'est la logique d'une société de consommation qui consomme tout, qui mâchouille tout, ça risque de tourner ratatouille… |
J.M. ‑ Attendez ! Vous allez peut-être, vous, lui apporter quelque chose. L'espérez‑vous ? D.K. ‑ Pensez‑vous ! Nous, Yougoslaves, marginaux nous sommes et marginaux nous resterons, comme culture, comme littérature, nous n'existons ni à Paris, ni dans le monde. C'est le destin des petites nations, plus précisément des petites langues. Oui, c'est comme ça. Nous sommes "exotiques", et n'intéressons qu'à ce titre.
Danilo Kiš, Belgrade, 1973 J.M. ‑ Alors, qu'est‑ce qu'un écrivain yougoslave à Paris ? D.K. ‑ Tout ce qui se passe ici, en culture, en politique, en littérature, c'est mon monde à moi, une partie du moins, c'est même ma culture. Je connais tous les noms de la culture française. Je vis avec eux, je leur parle, ils me répondent. Mais ils ne vivent pas avec moi. Entre nous, aucune référence n'est possible à ma culture, à ses grands thèmes. Leurs thèmes sont les miens, mes thèmes à moi ne sont jamais les leurs.
Danilo Kiš, Paris, février 1989 J.M. ‑ Qui est‑ce qui parle ainsi, le Yougoslave, le Balkanique ? D'ailleurs j'y pense : dans la littérature de langue serbo‑croate, rares sont les romans dont le matériau (espace géographique, espace historique, problèmes, hommes) est autre chose que yougoslave. C'est pourtant le cas de Roman o Londonu, du grand Crnjanski. C'est aussi le cas de Un tombeau pour Boris Davidovitch. Quel Kis a écrit ce roman : le Yougoslave, le Balkanique, l'Occidental, ou un autre encore, qui n'a pas de nom ? D.K. ‑ Tous ceux‑là, et d'autres encore, dont chacun apporte sa forme de connaissance. Pendant le conflit avec Moscou, le Yougoslave a pu apprendre ce que c'est que le fanatisme. Le Juif a compris la haine raciale et le péché originel en Hongrie, pendant la guerre. Le Balkanique fait chaque jour l'expérience du malheur des petites nations et de l'indifférence des grandes. Enfin, c'est bien l'Occidental en moi qui a pu comprendre à quel point l'Occident était privé de ces connaissances expérimentales qui sont nécessaires pour saisir la nature du mal. À quel point l'Occident est responsable du mal qui sévit sur la terre. À quel point les mythes sont nécessaires à sa survie… Voilà pour l'expérience de l'homme… Mais enfin, celui qui écrit, c'est l'écrivain, un homme essentiellement sans qualificatifs (1), un obsédé, qui ne se pose qu'une question : comment donner la forme d'un livre à cette obsession ? J.M. ‑ Chez vous, c'est l'obsession du Mal ? D.K. ‑ C'est‑à‑dire que je sens le Mal sur ma peau, dans mon âme… (un silence)… J'ai survécu par miracle au massacre des Juifs et des Serbes de Novi Sad, en janvier 1942… oui, j'ai passé toute mon enfance et une partie de ma jeunesse dans le voisinage immédiat du Mal… Mon père est mort à Auschwitz… Et presque toute ma famille… Les survivants m'ont raconté… Ensuite, pour les autres camps, vous savez, les survivants m'ont raconté, Karlo Steiner, par exemple, l'auteur de Sept mille jours en Sibérie… Oui, je sens le Mal sur ma peau. (Long, très long silence de Danilo Kis, et fin de l'entretien). 1. En français dans le discours. |