|
Mihajlo Pantić
L’HISTOIRE, CONTESTATION DE LA MORT
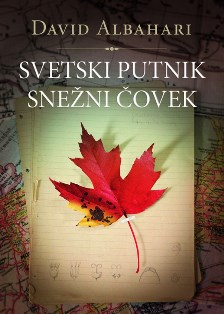
David Albahari (né en Yougoslavie en 1948), écrivain d’origine juive et de langue originellement serbe, appartient à la littérature serbe et compte parmi les écrivains contemporains de tout premier plan et les plus influents de la lignée postmoderne. Installé à demeure au Canada depuis 1994, au cours des années passées dans un nouveau milieu culturel et linguistique, il a écrit une série de romans et de recueils de nouvelles dont certains, bien évidemment, ont été publiés en serbe, sa langue maternelle, mais aussi traduits dans un nombre significatif de langues étrangères. La prose « canadienne » d’Albahari témoigne de l’expérience du changement d’environnement (le phénomène de l’immigration), d’où les interrogations qui s’imposent de manière naturelle et dominante sur l’identité, sur toutes les conséquences psychologiques qui en découlent (qu’il s’agisse de la langue, de la politique, de la famille, de l’histoire. Dans les dits romans, et quoi que l’évocation explicite du Canada soit chose relativement rare, apparaît à l’évidence un changement dans le topos narratif, en d’autres termes, une modification de l’espace et du chronotope de sa prose. Par ailleurs, Albahari s’est lancé dans la traduction de ses propres livres vers l’anglais, de sorte que se présente à nous une situation intéressante, dans une certaine mesure très spécifique mais aussi typiquement comparative dans laquelle le système d’un auteur, Albahari en l’occurrence, se met dans le même temps à se diffuser dans deux systèmes culturels et, de la sphère de la langue maternelle, sans la quitter un seul instant, se répand dans celle d’un autre milieu culturel, certes par la langue, mais aussi par l’image du monde qui se projette à travers elle. Très révélateur est le fait que reprend vie dans cette transmission linguistique et culturelle complexe l’archétype littéraire du juif Ahasvérus, l’homme voué à l’errance éternelle, condamné à se poser en permanence la question maudite : Qui suis-je ? Avant de nous attacher à une analyse exhaustive de la période canadienne d’Albahari, nous évoquerons la manière dont le phénomène de l’intégration est envisagé d’un point de vue autre, complémentaire, canadien. Dans The Literary History of Alberta (vol. II, p.194, The University of Alberta, Edmonton, 1999), l’historien de la province de l’Alberta George Melnyk écrit :
„Fiction writer D.A. (1948), who came to the University of Calgary as international writer-in-residence in 1994-95, has remained in Calgary and now uses Alberta in his fiction. Written in Serbian and published in Yugoslavia, these novels are partially situated in Calgary or the Rockies.
The stance of the narrator is invariably that of a writer living in Canada but remembering things back in Europe. Albahari’s sensibility is a product of pre-partition Yugoslavia and its multinational dimension (he is of Jewish background). He published nine books (short stories and novels) prior to his arrival in Calgary, and has written a novel each year since. His first English-language collection, Words Are Something Else, was published in the US in 1996. Then he translated his 1988 novel, Cink, into English, published in 1997 as Tsing. That year, he won the NIN literary award for the best novel published in Yugoslavia for Mamac (The Bait). Some of Albahari’s fiction has been translated and published in Germany and France, but until his Alberta-written works are available in English translation, his relationship to Alberta letters remains distant, even while his contribution to Yugoslavian literature continues to grow (he returns annually to promote his latest title).”
1. L’Homme de neige [Snežni čovek]
Emporté par le tourbillon de la guerre, un écrivain européen part au Nouveau Monde, quelque part dans le lointain nord. Nous ignorons son nom, nous n’avons aucune précision quant à l’endroit dont il est originaire, le camp auquel il appartient car il n’appartient à personne, pas même à lui-même. Tout baigne en quelque sorte dans l’indétermination et dans l’éloignement de soi. Le roman nous apprend néanmoins que le pays de cet écrivain, situé quelque part aux confins de l’Europe centrale et de l’Europe orientale (sont cités le Danube et les Balkans), s’est effondré lors d’un conflit sanglant, et que l’écrivain anonyme – qui dit n’avoir « jamais eu pour lui-même de nom permanent » – est arrivé dans un lointain pays nordique laissé également sans nom, afin de continuer à écrire. Dans un premier temps, ce sont le silence et la solitude qu’il y trouve, ainsi que l’hospitalité conventionnelle des gens qui lui donnent refuge, une hospitalité dont l’autre nom est incompréhension. L’ordre parfait qui règne dans la nouvelle vie ne saurait combler la vacuité intérieure du héros, bien au contraire : cet ordre irrite le vide, l’accentue, et l’approfondit encore. Tous ses interlocuteurs, personnages secondaires dans le roman, pensent que l’écriture devrait être une libération des souvenirs. Mais de souvenirs concrets, traumatisants, il n’y en a pas. Pour le héros, seule subsiste la langue et, en elle, une représentation floue de l’infortune de l’Histoire. L’Histoire est une fable, une fable morne, sombre, pour ainsi dire « un trou noir », et le quotidien l’absence de fable. En réalité, le héros vit et pense sa sortie de l’Histoire, qui se présente comme une fable douloureuse, et son passage dans le quotidien comme une facilité offerte par l’absence de fable. Sa conscience glisse sur le monde, enregistre au microscope toutes ses perceptions – toutes, jusqu’aux moindres détails de l’espace visible et les réactions psychologiques les plus infimes qu’il suscite.
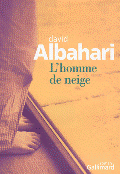
En fouillant la maison où il s’est installé, le héros découvre une collection de cartes de géographie. Le locataire précédent était visiblement cartographe. Entouré de ces cartes accrochées aux murs, le héros du roman L’Homme de neige (1995) s’efforce d’établir le rapport qu’il entretient avec lui-même et avec le monde, tant le monde dont il est venu que celui où il est arrivé, mais sans déceler nulle part de point d’ancrage solide sur lequel parvenir à nouveau à la plénitude de son être. Pas même dans la langue. Sinon, et à son propre dire, le héros qui est entré dans un nouvel environnement avec l’intention de prendre « un nouveau départ » n’a rencontré que l’idée de vieillesse et le sentiment progressif, toujours plus marqué, de la perte de sa propre matérialité, de la disparition de son être. « Je suis venu, ai-je pensé, parce que l’espace se restreignait, parce que je ne parvenais plus à me rappeler mon nom, parce que je ne m’exprimais plus qu’à coup de phrases courtes, avec un nombre toujours plus limité de mots (…), je suis venu parce que la langue ne signifiait plus rien, parce qu’elle se disséminait comme de la farine au moulin, parce qu’en fait elle n’était plus. » Mais en dépit de l’aspiration à voir au Nouveau Monde un changement se produire, un « nouveau départ » ou le réveil du cauchemar de l’Histoire, une transfusion d’énergie vitale intensive et justifiée, rien de tel ou de semblable ne survient. Les cartes sur les murs, tout autant que les paroles de ses interlocuteurs, rappellent au héros que la vie, tant individuelle que générale, est par avance un état donné d’incompréhension durable, d’absence persistante de communication authentique, et en l’être lui-même et dans l’Histoire qui est une sorte de surêtre, un surêtre abstrait mais très actif (le diable dans la vieille théodicée) qui conditionne toute vie et celle de chacun, ceci d’autant plus que cette vie souhaite fuir l’Histoire, se garder de réfléchir à son propos, exactement comme souhaitait le faire le héros de L’Homme de neige.
Dans ses nouvelles conditions de vie où le quotidien prend le dessus sur l’Histoire, où il est éloigné de son ancien moi et médite sur son expérience passée qui ne vaut pas qu’il s’en souvienne mais l’oppresse d’autant plus, le héros condense ses réflexions en une seule et unique interrogation : Comment fuir l’Histoire ? De réponse carrée, salvatrice, il n’y en a certes pas. C’est la vie en tant qu’action inachevée dont il est naturellement question ici car la vie en tant que telle, et en soi, est une fuite perpétuelle devant l’Histoire. Quand cette action acquiert sa forme parfaite, quand l’apaisement se substitue à elle, alors chacun, et donc le héros du roman également, parvient à la limite extrême, à la fin elle-même. En d’autres termes, fuir l’Histoire est possible, mais pas de manière définitive, sauf à fuir dans la mort. Toute autre forme de fuite de l’Histoire est en réalité, et selon le cas, une fuite détournée ou directe dans l’Histoire. La guerre règne partout, partout des migrations de peuples sont en cours, partout les frontières se rétractent. Par un caprice du hasard le héros s’est trouvé dans sa vie là où la fréquence et l’intensité de ces processus étaient les plus grandes ; au Nouveau Monde l’attendaient, involontairement dirait-on à première vue mais inexorablement, des images qui lui rappellent à chaque instant que l’Histoire n’a pas d’issue exceptée celle qui conduit au néant.
La projection symbolique de cette issue prend corps dans les phrases qui concluent L’Homme de neige ; non seulement le plus beau fleuron de l’art poétique de David Albahari, elles s’élèvent en outre au faîte de la prose serbe contemporaine. Après une relativisation globale de la langue et du monde et, avec pour unique certitude l’impossibilité d’exister en dehors de l’Histoire (ce qui marque un tournant cardinal dans la poétique de David Albahari, le héros décroche les cartes des murs de sa maison, contemple leur périlleuse blancheur comme il aurait regardé une toile représentant la défaite finale, et se lance une nuit de neige sur les traces d’un lièvre polaire dans la nature immaculée et sous le clair de lune. Il les suivra jusqu’à se perdre et rester totalement seul dans le désert de neige. Tout disparaîtra, il s’assimilera au vide et sur une colline balayée par le vent sa langue franchira les limites de son sujet. (Ce qui, naturellement, ne se peut que dans un texte littéraire qui, sous forme de réplique, c’est-à-dire de recontextualisation de symboles bibliques, nous présente une scène boréale où une voix à peine audible s’adresse verticalement à une inexistante transcendance, en des temps où l’Histoire détruit tout ce qui était susceptible d’être détruit : l’homme et donc, en premier lieu, le sujet humain.)
Si telle est notre interprétation de la fin du roman d’Albahari, on ne sait plus à qui attribuer les dernières phrases. La première personne a disparu, le narrateur objectif ne s’est pas manifesté, la langue exprimée au nominatif, le cas grammatical du sujet, a disparu car il n’est plus de sujet, il est devenu le vide, c’est-à-dire la blancheur. Ne subsiste en fin de compte que le glacial cliché d’une nuit d’hiver : « Et quand, un peu plus tard, le lièvre s’approcha prudemment de la courte forme de neige et fourra son museau entre les flocons collés, personne ne lui dit rien. Puis la neige cessa de tomber et, dans le ciel, comme de coutume, apparut la lune. » Qui prononce ces mots, qui contemple, qui décrit cette scène ? Impossible de répondre avec certitude ou, plutôt, il ne se trouve personne pour apporter de réponse. Le vide s’est fait dans le paysage, le vide s’est fait dans la langue, la luminosité neigeuse de la lune en suspens sur le désert de la nature, dans la nuit du monde où règnent les démons de l’Histoire, du diable et de la mort.
Dans L’Homme de neige, Albahari a mis en pratique et élevé à un niveau plus expressif encore les qualités poétiques et stylistiques qu’on lui connaissait, il les a enrichies grâce à un thème tiré directement de sa biographie mais élaborés dans le texte du roman par un acte de pure fictionnalisation, une fictionnalisation soulève des interrogations, celles, personnelles, de l’auteur mais aussi d’autres, générales, marquantes, du monde contemporain et de l’homme qui y vit subordonné à l’œuvre démente de l’Histoire et si peu apte à résister à son énergie frénétique. En prenant ses distances avec sa propre expérience, mais en faisant usage de la force intérieure qu’elle recèle, Albahari dépeint dans L’Homme de neige l’une des multiples confrontations possibles de l’homme d’aujourd’hui (de n’importe quel homme issu de cette partie du monde) avec une force qui, incommensurable, n’a de cesse que de lui prendre son âme. Il le fait sans détours, par la métonymie et la métaphore, ainsi que cela se pratique dans les œuvres que nous dirons artistiques par immanence et qui vont au-delà de la réalité et de l’expérience de ce monde dont elles sont issues. Par cette entremise réalisée avec toute la force de ses qualités littéraires, Albahari a écrit son livre le plus suggestif, sinon le meilleur. S’il avait procédé différemment, en suivant, disons, le sillon aujourd’hui traditionnel, directement narratif, L’Homme de neige eût été un livre de plus sur l’exil. Un livre parmi une multitude d’autres, de qualité ou de qualité moindre, peu importe.
La suggestivité de la fable d’Albahari sur l’exil repose sur le balancement de la forme, de la langue, de la signification de la narration, ce qui constitue le trait poétique premier et la qualité esthétique première de L’Homme de neige. Chantre de la concision poétique, de la réduction de la langue à l’expression des détails essentiels, microscopiques observés dans l’existence humaine, dans L’Homme de neige et contrairement à ses textes précédents et à première vue proches (Le Zinc [Cink, 1988], Livre bref [Kratka knjiga, 1993]), Albahari a lancé le débat sur l’Histoire et la politique actuelles mais d’une manière indirecte, subtile, toute en ironie et en relativisation intellectuelle qui, au final, embrassera également le héros lui-même / le « je » narrateur. Léger paradoxe, L’Homme de neige dévoile son horizon romanesque en mettant en doute les postulats épiques fondamentaux de la prose la plus riche et la plus complexe. La fable y est narrée en doutant de la langue et de la fable, l’Histoire est vue à travers le quotidien et la vie dans le pressentiment constant de la vieillesse et de la mort. Le raffinement de la langue, sans être un but en soi, se rattache directement à la description précise de la sensibilité nomade de la vie du sujet qui ne peut trouver le repos nulle part, pas même en lui-même, fait d’Albahari l’un des meilleurs stylistes de la prose contemporaine serbe.
2. Goetz et Meyer
Sans surprise pour qui a lu les livres précédents de David Albahari, le thème de la souffrance des juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale attendait tout simplement l’écrivain. Dans sa prose, ce thème s’était dans un premier temps trouvé confiné dans un silence permanent, obstiné, sans doute à cause de son insupportable intensité tragique. En lien direct avec ce silence est le fait que tous les héros juifs du cercle fictionnel d’Albahari, du « je » narrateur, parlent bas, durablement affligés, en derniers gardiens du souvenir de la mort massive, monstrueuse, qui glacerait le diable en personne tant elle outrepasse toutes les formes de son imagination. Pour exprimer les choses différemment : le thème de l’Holocauste est le fonds implicite, actif dans le mutisme, de l’histoire que narre Albahari. Quand il n’est pas de mots pour la traiter, reste le silence. Et il en fut longtemps ainsi.

Puis l’Histoire, en tant que forme collective, et la biographie, en tant que forme individuelle (comme protoforme) de toute narration, ont foisonné dans les livres de David Albahari. Plutôt, dirait-on, contre le gré, voire la résistance de l’auteur qui, accoutumé à la microscopie narrative de l’existence, ne se sent jamais bien nulle part sinon dans la destruction de n’importe quel contenu modelé par l’idéologie, qu’il s’agisse de la désintégration du pays ou d’un fait plus ou moins trivial de la mythologie de la vie quotidienne, disons les courses à faire au libre-service qui représentent la forme ordinaire et sans doute aujourd’hui unique de communication avec la nature d’autrefois dont on garde un souvenir diffus. D’où cette abondance d’ironie dans les derniers livres d’Albahari (les quelque part et jamais ici, envisagés d’une distances spatiale et linguistique) et, conséquemment, cet état final de relativisation ultime du sujet, de l’histoire et du sens (les citer dans l’ordre inverse est possible) incarné dans les figures qui concluent ses romans (si ce sont des romans ou, plutôt, avant toute chose, les enregistrements de monologues sans fin, interrompus l’espace d’un instant, le temps qu’une nouvelle inspiration soit prise et que s’exprime une autre voix), dans des contrées compressées, remarquablement suggestives, où continuellement, inexorablement, d’une façon ou d’une autre, se dessine la mort. L’analogie avec Shéhérazade est inévitable : tant que nous contons, il n’y a pas de mort. Tant que nous sommes travestis en conte, la mort, en quelque sorte, se tient loin de nous. Mais un temps seulement. Que l’écrivain l’ait voulu ou non, la mort apparaît dans le thème du conte. Quoi que nous touchions, la mort est là. Nous sommes enclins un certain temps à jouer à cache-cache – une phase que nous pourrions appeler naïveté narrative fondée sur la croyance que ne pas mentionner quelque chose signifie la non-reconnaissance de son existence. C’est là un alibi qui ne tient pas quoique passer les choses sous silence est parfois ou, plus exactement dans le cas d’Albahari, presque toujours plus suggestif et plus exigeant qu’expliquer avec des mots. Cette différenciation permet selon moi de discerner aussi la possibilité sur le plan axiologique les nouvelles et romans d’Albahari ; c’est davantage le calme qui préside au développement du thème plutôt que sa proclamation à pleine voix qui le caractérise. Mais le sous-entendu doit, à un moment, être dit ou, plus exactement, d’abord annoncé et ensuite exprimé. La mort souffle en bourrasques de l’Histoire, et choisir de parler de cette dernière revient en fait à parler de la mort, à la légitimer par le conte, ce qui est paradoxal car le conte tel que le conçoit et le façonne la tradition de Shéhérazade est une contestation magique de la mort. Que le mécanisme du conte, vu sur les longs sentiers historiques et poétiques, se complique en permanence, en l’occurrence ne signifie rien : la mort se fait toujours plus simple et plus facile, technologiquement toujours plus accessible. Dire que le XXe siècle n’a rien inventé d’important pour l’humanité est une litote. Une tâche lui était en réalité assignée : développer au cours de ce siècle d’une technologie particulière visant à donner la mort. Les usines où cette technologie fut mise en pratique s’appelaient les camps.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Belgrade connut un tel camp. Il était situé sur la rive gauche de la Save, jadis de Zemun, aujourd’hui de Novi Beograd, dans les pavillons nouvellement construits de Sajmište, la foire ; un an ou deux avant le déclenchement du cataclysme planétaire y avait été diffusé dans les Balkans le tout premier programme expérimental de télévision. La télévision et la mort entretiennent un certain rapport, peut-être même de cause à effet. Où est la télévision, la mort est aussi. À Sajmište, il y eut d’abord la télévision, puis la mort l’a remplacée. La télévision relativise le monde et relativise la mort en faisant d’eux un contenu inauthentique, une apparition, une image. L’image électronique suscite l’indifférence, l’indifférence engendre l’oubli. Le récit annihile l’oubli, et c’est là que réside la motivation profonde de David Albahari dans son roman Goetz et Meyer (1998). Il y réitère sans cesse et en diverses variations l’idée que l’âme qui vit dans le souvenir n’est pas morte. Les âmes vivent dans le souvenir, mais grand nombre d’hommes sont morts, à tout jamais, inexorablement, et là, aucune fable n’y peut rien. Parler de l’Holocauste se cantonne toujours nécessairement à la lisière du silence. Dans leur grande majorité, les quelques milliers de juifs belgradois ont compté leurs derniers jours à Sajmište. Ils furent exterminés d’une manière spéciale, méthodique, bestialement efficace. On les transportait et on les gazait dans un camion de marque Zaurer, spécialement conçu à cet effet, et ils achevaient leur parcours terrestre à Jajinci. Les documents qui furent conservés nous apprennent que les chauffeurs de ces camions s’appelaient Goetz et Meyer. Rien de plus. Ce flou qui entoure leurs personnalités réelles (leur identité, leur origine, leur physique) et la certitude indubitable de la mort dans le camp ont donné naissance à cette histoire.
Et le camp, le besoin de le raconter aidant, s’est ainsi installé dans la conscience du narrateur. Il faut en parler, absolument, pensait Danilo Kiš, sinon il n’est rien qui vaille que l’on en parle. L’écrivain, dans le cas présent David Albahari, put différer quelque temps cette histoire, articuler et, d’une certaine façon, frapper sa propre voix de censure, mais la conscience et la pensée ne souffrent aucun interdit. Ce qui un jour existe dans la conscience doit, le temps venu, être exprimé. Pour Albahari, ce fut après onze livres de prose. Auparavant, et de façon nullement fortuite, le camp de Sajmište fut simplement effleuré dans L’Appât, mais il occupe dans Goetz et Meyer l’espace central de l’histoire. Et celle-ci est relatée par un héros albaharien typique, un homme entre deux âges, quelque peu en proie à la confusion, inadapté, en quête de sa propre origine, qui trace son arbre généalogique où sur une branche, frêle, la plus haute, la dernière, frémit une feuille transparente, la sienne. De manière une fois encore aucunement fortuite mais presque naturelle et judicieuse, ce personnage est un professeur de littérature conscient qu’un récit ne saurait accomplir de miracle mais est, à tout le moins, susceptible d’obtenir des résultats. Il faut rappeler ce qui était est possible, et ce qui était sera en permanence préservé dans le présent : si nous le gardons à l’esprit, tout ce qui était existe en quelque sorte en nous, à travers nous. En outre, raconter donne à l’existence de n’importe qui une apparence de sens incontournable et rédemptrice. Et ainsi, selon les dires du narrateur : « Pauvre de nous, ai-je lancé aux élèves, si nous cessons un jour de raconter des histoires, car si nous le faisons, rien ne pourra nous aider à supporter la pression de la réalité, à alléger le fardeau de l’existence qui pèse sur nos épaules ». Et le narrateur d’ajouter : « L’existence, c’est l’absence d’histoire ». Qui raconte donne du sens à la vie, au premier chef à la sienne, puis à celle de ceux qui écoutent ou lisent l’histoire.
La quête de l’origine, nous le savons par les livres anciens, épiques de structure et volumineux, n’est rien d’autre qu’une quête de soi. La signification de ceux qui nous ont précédés témoigne aussi de notre propre signification. Qu’ils ne soient plus, que le passé soit un lieu de ténèbres, alors nous non plus ne sommes plus. L’ignorance de ce qui s’est passé peut jusqu’à un certain point se neutraliser par l’ironie, par l’équilibre rhétorique, par la contestation à coups de commentaires d’un contenu encore inconnu mais pourtant annoncé, irritant et souhaité, mais viendra le moment où tout se retournera contre celui qui professe pareil état d’esprit. La manipulation par le vide conduit naturellement au vide, rappelez-vous ce petit récit sur l’abîme : que l’on plonge longuement le regard en lui, et il plongera le sien en nous. Il en est de même du professeur de littérature d’Albahari.
Ne possédant rien de tangible hormis des documents stériles et des statistiques brutes, sans aucune voix vivante pour témoigner du passé (personne ne répond à ses lettres), le héros s’empêtre peu à peu, toujours plus profondément ensuite, dans une somme inextricable d’images et de faits qui échappent à toute organisation parce que les ordonner de manière sensée est à dire vrai impossible. Dans cette désorganisation, lui-même se désintègre ‒ ou se complexifie, comme il vous plaira. Dans les romans antérieurs d’Albahari, les héros étaient portés à se fondre dans le monde, à abattre les frontières entre eux et ce qui les entourait, ils n’étaient toujours, pour être précis, que le centre de transmission par la parole des sensations les plus diverses, mais le héros de Goetz et Meyer est allé le plus loin dans ce changement. « En somme, dit-il à son propre propos, je n’étais que le reflet des reflets d’autrui, un ensemble de composantes, le résultat d’une soustraction, le produit d’une multiplication, de la pure mathématique ». Ce héros est tout le monde, tout personnage qui lui passe par l’esprit, et même Goetz, et donc Meyer car Meyer est Goetz, et Goetz vraisemblablement Meyer, le passage de l’un à l’autre est la caractéristique de tous les personnages du nouveau roman d’Albahari ; quand ils existent, ils existent en tant qu’autres, et grâce à l’aide des autres. Seul le fait de mourir ou d’être confronté directement avec la mort les fera devenir ce qu’ils sont en réalité. L’enfant qui ne parvient pas à s’extraire du lieu des exécutions ne deviendra lui-même qu’une fois la mort traversée, ce qui constitue la variante albaharienne de la vieille théorie psychanalytique selon laquelle l’identification de soi n’est possible que dans la mort. De même dans la scène finale du roman où le personnage principal, un parapluie entre les mains, en vient à faire face à un mur, nous savons lequel ; cette scène est en réalité une volte-face comparée à l’image ultime du roman L’Homme de neige.
Tous les livres d’Albahari se ressemblent et, par-là même, se distinguent les uns des autres. Vu sous l’angle de ce paradoxe depuis longtemps signalé, Goetz et Meyer sont le plus concret, et le plus documenté de ses romans. Ce qui ne va pas à l’encontre de l’intensité toujours très perceptible de la relativisation narrative et poétique tant de la langue et du locuteur que des objets dont parle ce dernier. Ce qui signifie qu’en dépit de la forte matérialisation du thème, un profond silence persiste aussi dans Goetz et Meyer car on ne saurait raconter l’Holocauste qui est un état définitivement réduit à la production permanente de mort, et toute forme de fiction ayant pour finalité la compréhension de ce qui est relaté pour l’expliquer aux autres se trouve ici déplacée, superflue, et d’avance vouée à l’échec. Dans Goetz et Meyer se cristallise de manière peu visible, et avec discrétion, l’idée que l’homme ne parvient pas à cultiver l’Histoire, c’est-à-dire qu’il la cultive de la seule et unique façon possible, en perpétuant sa propre mort à une vitesse toujours accrue et avec une perfection toujours plus achevée dans les phases technologiques supérieures de la civilisation. Repartant de l’endroit où s’était arrêté Danilo Kiš, Albahari a dans sa manière – esthétique et surtout suggestive (avec une factographie et un rythme narratif parfois condensé) ‒ écrit le livre en réalité « écrit » par le XXe siècle. Un siècle où toute invention, notamment celles portées par de bonnes intentions, y était déplacée et indigne.
3. Globe-trotter [Svetski putnik]
Le trait essentiel de la prose de David Albahari est peut-être la différence dans la similitude. C’était du moins l’impression qui se dégageait jusqu’à l’installation de l’écrivain au Canada : analysés de l’extérieur Le Juge Dimitrijević [Sudija Dimitrijević, 1978] se distinguait de Livre bref [Kratka knjiga], et Description de la mort [Opis smrti, 1982] de Terreur au hangar [Fras u šupi, 1984]. De l’intérieur, ces livres traitaient néanmoins, quoique différemment, les mêmes sujets : le silence, la mort, l’incapacité de la langue à exprimer l’indicible, tout cela d’un point de vue très personnel, qui, avec une aversion non dissimulée, passait sous silence la politique, l’Histoire, la nation, des thèmes synonymes de migraine endémique pour maints écrivains serbes portés sur le « discours fort » de type autoritaire, arbitraire, déclamatoire car la spécificité du mainstream de la prose serbe, et en remontant cent cinquante ans en arrière, traduit des efforts à se donner mal à la tête pour tenter d’une manière ou d’une autre de nous arracher aux soucis collectifs trop pesants que le temps nous amène. Pour Albahari, il s’est ensuivi un changement de contexte d’écriture existentiel et culturel, un changement qui s’est manifesté sur-le-champ dans ses textes de prose. Tout en conservant son inclination pour le « minimalisme de la langue » qui, sans aucune relativisation, est la caractéristique fondamentale de son style, Albahari s’est ouvert de manière subite mais non déroutante à des thèmes « forts » mais sans grand attrait pour lui jusque-là. Nous avons ainsi pu lire L’Homme de neige, L’Appât, Goetz et Meyer. Pour pimenter encore l’histoire, et par le croisement dans ses romans courts de deux éléments poétiques de prime abord incompatibles, le pointillisme linguistique et l’actualité (la provocation) thématique, Albahari est devenu un écrivain qui est beaucoup plus lu, ce qui n’avait pas toujours été le cas s’agissant de ses livres précédents, et qui n’aura connu le succès auprès du public serbe qu’après son départ...
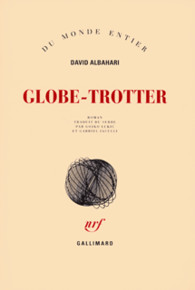
La réorientation thématique n’a toutefois pas changé radicalement l’écrivain. Quoique son opus, considéré une fois de plus de l’extérieur, se scinde au bout du compte en deux périodes, belgradoise (en réalité, zémounienne) et canadienne, Albahari a continué à cultiver la différence dans la similitude, à nuancer et à étoffer ce que nous pourrions appeler son intérêt de narrateur et sa langue, toujours très subjective de tonalité (la qualifier autrement serait possible). De ce fait, son roman « canadien » Globe-trotter (2001) est un livre fondamentalement (auto)maniériste, et il faut de ce pas avertir les lecteurs potentiels : qui aime les livres d’Albahari y découvrira très vite quelque chose « du même auteur » et, je présume, se trouvera plus rapidement encore en terrain connu ; par contre, qui n’est pas très convaincu par cet auteur figure du post-modernisme serbe ne parviendra certainement pas à dissiper ses réserves. Nous sommes donc ici à nouveau en présence d’un roman qui développe, dans un esprit de suite, un monologue intérieur, écrit en mégaparagraphes, d’une manière qui nous est familière depuis les livres précédents. Nous y reviendrons, mais plus tard. Voyons un peu de quoi traite Globe-trotter.
Un certain peintre figuratif (« certain » parce qu’anonyme), par ailleurs le narrateur du roman, originaire de la prairie (le Saskatchewan, province du centre du Canada), fait la connaissance dans le village d’artistes de Banff (dans les montagnes Rocheuses) de Danijel Atias, un écrivain serbe d’origine juive qui, non sans se garder de faire allusion à l’histoire d’Ahasvérus, le juif errant, a quitté sa hier encore patrie démantelée dans le sang, la Yougoslavie. Le peintre souhaite se rapprocher d’Atias guidé par le désir presque irrationnel (partiellement homoérotique) de faire son portrait, et s’y emploie en permanence et plus ou moins en vain. Le succès de son entreprise est constamment contrarié, cette tentative instinctive semble par avance vouée à l’échec et, chuchote Albahari à l’oreille de son lecteur, de réalisation finale, il n’y en a pas ; ce qui nous entrave et se refuse à nous nous incite à en parler. Néanmoins, le titre Globe-trotter ne se rapporte pas au seul Danijel Atias (ce nom, apparemment de l’alter-ego fictif de l’écrivain, est apparu déjà précédemment dans la prose d’Albahari ; cette fois il est et il n’est pas question de ce héros « antérieur »), mais aussi d’un troisième protagoniste de l’action du roman, un Croate canadien laissé lui aussi dans l’anonymat ou, plus précisément, de son aïeul, Ivan Matulić. Au début du siècle, ce dernier relatait dans des livres ses voyages à travers le monde et, entre autres, son passage à Banff.
Selon l’avertissement de l’auteur en ouverture du livre, seul Banff est réel, et tout le reste imaginé – imaginé pour lui donner plus de réalité encore. Se constitue donc ainsi un triangle où Danijel Atias et le petit-fils d’Ivan Matulić échangent sur la guerre en ex-Yougoslavie et finissent par conclure que, d’une manière particulière, le conflit rapproche ses protagonistes, que l’inimitié se mue peu à peu en une forme d’attachement, bref, que l’inimitié a plus d’authenticité que l’amitié. Ce jugement se hisse alors au niveau de principe universel et se transforme en interrogation : le monde peut-il aller de l’avant de manière pacifique et non pas uniquement, comme l’Histoire nous le montre, par la culture abominable des conséquences tragiques que les horreurs guerrières produisent sans cesse ? Là encore, pas de réponse définitive. La différence de points de vue entre Atias et le petit-fils de Matulić, qui se mue progressivement en proximité, est observée de côté, sans la comprendre, par le peintre du Sasatkewan, le narrateur. Après la disparition du petit-fils d’Ivan Matulić dans un malheureux accident, il détruira les papiers d’identité croates destinés à Atias puis fera un effroyable rêve visionnaire : la disparition du Canada dans les flammes de la guerre…
L’histoire que raconte Albahari dans Globe-trotter se déroule à deux niveaux, psychologique et socio-historique, et recherche les points de conditionnalité réciproque qui nous sont familiers depuis les livres précédents, L’Homme de neige et L’Appât. Pendant tout le déroulement, essentiellement linéaire, du récit, le narrateur nous livre un traité sur de nombreux thèmes qui occupent ses réflexions ou qui lui viennent à entendre la conversation des deux personnages centraux originaires d’un pays qui n’existe plus : la peinture, le déterminisme géographique qui modèle le caractère de l’homme, l’Histoire, la présence et l’absence, l’incapacité à communiquer notre ressenti et à représenter l’essence de ce que nous voyons. En un mot, nous sommes en présence d’une fable typiquement albaharienne racontée suite à de nouveaux thèmes que l’auteur a fait siens. La manière dont elle est narrée m’enferme cependant dans certains dilemmes : comme il ne s’agit pas d’un récit « d’un seul souffle » (ce qui est le cas de L’Homme de neige et de L’Appât), le choix du mégaparagraphe provoque par instants et par association une sensation d’asphyxie, l’arythmie de ce qui est dit et de la façon dont il est dit. J’ai l’impression de sentir ce dont il aurait pu être question. L’auteur qui condensait chacune de ses fables, qui donnait la primauté non à l’histoire mais à l’image, au drame de la langue plutôt qu’à la dynamique du récit, a cette fois, et pour la première fois dans Globe-trotter, choisi la solution inverse.
Ou, pour dire les choses très simplement, Albahari s’est délayé.
Traduit du serbe par Alain Cappon
Date de publication : juillet 2014
> DOSSIER SPÉCIAL : la Grande Guerre
- See more at: http://serbica.u-bordeaux3.fr/index.php/revue/sous-la-loupe/164-revue/articles--critiques--essais/764-boris-lazic-les-ecrivains-de-la-grande-guerre#sthash.S0uYQ00L.dpuf
|