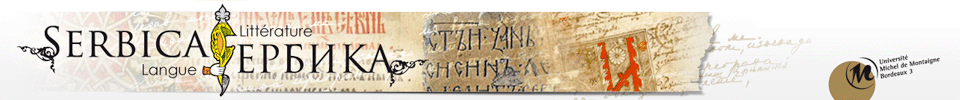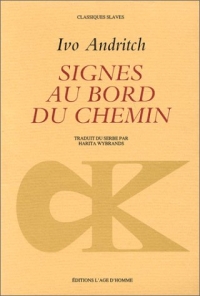|
A lire :
|
Andrić, l'écrivain et Andrić, l'homme : la critique s’est naturellement intéressée davantage au premier. L’homme, quant à lui, a longtemps réussi à garder ses mystères. Plutôt pudique et d’une nature introvertie, l’unique Prix Nobel de l’ex-Yougoslavie est resté très discret sur sa vie privée en gardant, dans la mesure du possible, ses distances avec la scène publique et les médias. « Je ne suis jamais aussi bien », a-t-il expliqué, « que lorsque j’écris et ne parle pas, et lorsqu’on n’écrit ni ne parle de moi. » En fait, ce n’est qu’après sa mort et la publication à titre posthume de Signes au bord du chemin – d’où nous avons tiré cette citation – que le public a eu l’occasion de connaître un peu mieux cet homme discret, dévoué jusqu’à l’abnégation à sa mission d’écrivain. Les Signes, livre le plus personnel des oeuvres andriciennes, ne sont, cependant, ni une autobiographie ni des mémoires, encore moins un journal intime. D’ailleurs, l’écrivain n’a jamais tenté, d’après son propre aveu, de tenir un journal car il y voyait « quelque chose d’impur et de laid », un « besoin de s’assurer un alibi ». Il s’agit, en fait, d’un recueil de notes, brèves et lapidaires, que l’auteur a rédigées au fil des années ; recueil forcément hétérogène où se côtoient aphorismes et méditations métaphysiques, réflexions sur l’actualité et images rapides des voyages, bribes des souvenirs de l’enfance et anecdotes de la vie quotidienne d’où surgit brusquement le monde bigarré de petites gens, prototypes des héros andriciens. Parsemés de détails autobiographiques, de confessions inattendues et d’aveux courageux, les Signes se présentent, cependant, avant tout comme un document authentique sur la personnalité de l’auteur et sur son laboratoire secret d’écrivain. Ainsi, le lecteur français aura l’occasion de découvrir, tour à tour, un juge impitoyable qui fait le procès de soi-même, un homme solitaire terrassé par les innombrables nuits d’insomnie et un artiste tourmenté, traversé par les doutes et profondément angoissé aussi bien devant la prise de parole publique que devant la page blanche. Mais il comprendra vite que ces faiblesses, d’ailleurs très humaines, ne sont rien d’autre que le symptôme d’un désir, celui d’être meilleur, d’être parfait. Il se rendra compte, en effet, que les angoisses d’Andrić-artiste sont du même ordre que celles d’André Gide écrivant : « Je ne vaut que devant papier blanc » ; et que sa solitude était un choix, un sacrifice volontaire d’un écrivain qui s’est adonné à la littérature comme on s’adonne à un destin. *Traduit du serbo-croate par Harita Wybrands, Éditions l’Age d’Homme, 1997. Milivoj Srebro |
|