|
Françoise Genevray
Université Jean-Moulin Lyon 3
MALONE MEURT (S. BECKETT) ET LA BOUCHE PLEINE DE TERRE (B. ŠĆEPANOVIĆ)
OU COMMENT FINIR
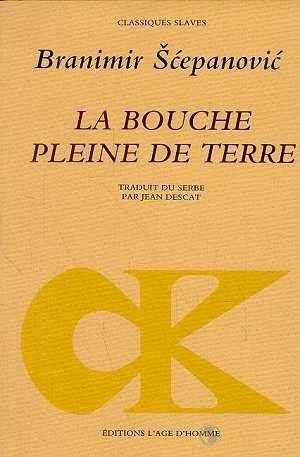 |
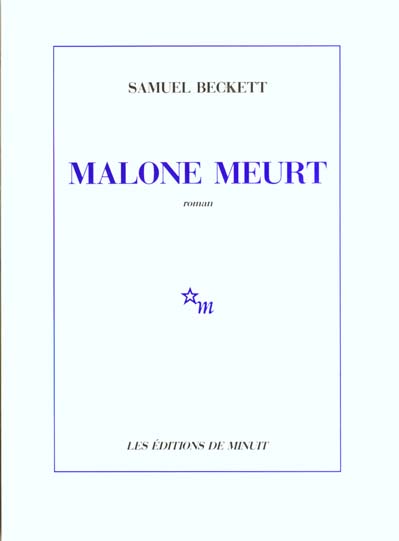 |
| |
|
Que la lecture de Samuel Beckett ait ou non retenti sur l'écriture de Branimir Šćepanović, plusieurs récits de l'écrivain serbe mettent en œuvre des situations limites, comparables à celles qu'explore l'auteur de Fin de partie. Le parallèle ici proposé n'entend pas déceler une hypothétique influence ou la trace de quelque réminiscence. Il vise à éclairer l'une par l'autre deux narrations (Malone meurt, La Bouche pleine de terre) organisées chacune autour d'une figure de « frontalier » : ce terme désigne, dans l'espace littéraire, un être dont l'expérience et le langage sont déterminés soit par une double appartenance (nationale, culturelle, linguistique), soit par sa position en suspens dans un intervalle psychique, une zone de passage (entre vie et mort, raison et folie)[1]. Les deux écrits retenus semblent de prime abord n'avoir que ce point commun : leur protagoniste s'apprête à finir. Malone au seuil de la mort ratiocine et se distrait comme il peut au fil de l'attente[2] ; cheminant quant à lui vers un suicide annoncé, le héros de La Bouche pleine de terre se trouve également en sursis[3]. Nous partirons de cette analogie sommaire pour confronter deux œuvres a priori fort éloignées - tant par leur facture que par la position respective des auteurs dans l'Europe littéraire[4] -, mais tout aussi saisissantes, l'une par sa vertu à la fois hypnotique et énergisante, l'autre par le mystère et la puissance propres à l'univers de Šćepanović, sur lequel nous mettrons l'accent au moment de conclure.
De même que finis en latin signifie borne, limite, frontière, et pas seulement fin ou terme, le verbe finir permet d'estomper la composante funèbre et les connotations négatives (peur, tristesse) couramment attachées au mourir. Il permettra surtout d'envisager simultanément le plan de la fable (approche de la mort) et celui de l'écriture, simultanéité essentielle à Malone meurt où le discours intérieur du protagoniste abonde en équivoques sur ce thème : finir soi-même ou finir l'histoire ? Il s'agira par conséquent d'explorer les ressources propres à l'écriture de la fin, d'où Šćepanović et Beckett font émerger des occasions insolites de rencontrer la vie, de la redécouvrir après un âge d'oubli, de confusion, de méconnaissance.
« Je serai quand même bientôt tout à fait mort enfin » : l'incipit beckettien affiche le double programme – partir, freiner - régissant le parcours existentiel et discursif de Malone. Au démarrage abrupt de la phrase (sujet, verbe) succèdent en effet quatre groupes adverbiaux qui font mine d'appuyer le propos et d'encourager l'élan, mais qui contribuent de fait à le ralentir. M. Depussé épingle avec des mots justes ce « futur entravé, si adverbeux », « temps abusif, coup de force soutenu en même temps qu'entravé par les béquilles de tous les adverbes »[5]. Contrastant avec le huis-clos où végète Malone impotent, l'histoire relatée par Šćepanović débute en deux lieux à la fois, une tente plantée dans la montagne au mois d'août et le train dans lequel un homme entame son dernier voyage. La tente abrite des estivants amateurs de chasse et de pêche, parmi lesquels se trouvent « Iakov et moi » (B 11), un « moi » narrateur qui restera sans nom. Quant à l'homme du train, tout aussi anonyme, nous l'appelons "le fugitif" vu son projet de « fuir au hasard » (B 13) pour se détacher du monde.
Tandis que Malone alité inventorie ses humbles « possessions » (deux crayons, un bâton), le fugitif n'a aucun bagage et ne laisse personne derrière lui. Être quelconque et dépouillé, sa vie passée lui semble vide, « un désert d'où il ne pouvait faire resurgir nulle image, nulle voix, nulle odeur, rien qui lui donnât l'assurance d'avoir réellement vécu » (B 45). Malone paraît avoir atteint le même dénuement : « Monde mort, sans eau, sans air. C'est ça, tes souvenirs » (M 45) et encore « si mes souvenirs sont miens » (M 86), car il trébuche fréquemment sur le possessif. Se raconter des histoires sur Louis, Sapo, Macmann ou Lemuel remplace les souvenirs, à moins peut-être qu'il ne déguise ces derniers en histoires... Mes souvenirs ou leurs histoires ? Ici pointe la question à venir de l'identité du parleur.
Découvrant qu'il n'a plus que quelques mois à vivre, le fugitif est d'abord un fugueur : il a quitté en catimini la clinique où on le soignait à Belgrade, ne voulant pas finir (notons : comme Malone) sur un lit de grabataire « imprégné d'une triste odeur de sueur et de médicaments » (B 18). Son train roule vers le Monténégro, mais il descend lors d'une halte et marche à travers champs dans la nuit sans savoir où il va, orienté cependant par l'intention « d'aller mourir, comme une bête à l'agonie, en quelque endroit silencieux et désert » (B 13), de « se pendre à un arbre solitaire ou se précipiter dans un gouffre » (B 14). Le jour venu, il aperçoit les campeurs, songe à les aborder, puis se met à courir, fuyant la tentation de se maintenir parmi les hommes. Sa volte-face déclenche la poursuite qui forme l'essentiel du récit. D'emblée l'inconnu a fait figure d'intrus, dont la silhouette dérange « l'harmonie et la pureté familière de ce pays désert » (B 15) ; sa course le transforme maintenant en fuyard, suspect de quelque faute à punir : les campeurs s'élancent à ses trousses.
Les deux protagonistes sont des solitaires. Celui de Šćepanović a toujours redouté ses semblables « plus que les loups » (B 57), et Malone a connu « cette vieille frénésie » de fuir les vivants (M 33). Lui aussi d'ailleurs fut chassé, pourchassé, enfant ou tel un enfant occupé à sa façon en marge du monde adulte : « ils me poursuivaient les grands, les justes, me rattrapaient, me battaient, me faisaient rentrer dans la ronde, dans la partie, dans la joie ». Mais c'est fini à présent, « j'arrête tout et j'attends » (M 33). Fin de partie pour chacun, sauf que Malone habite l'attente, tandis que le fugitif précipite l'action. Quels motifs ont les estivants pour rattraper cet homme ? D'abord, disent-ils, pour l'aider ; mais bientôt s'avoue une impulsion moins innocente, « tirer ça au clair » (B 21). « Qui donc était-il [...] pourquoi fuyait-il s'il n'avait pas peur de nous? » (B 23). Ils veulent « être fixés » (B 24), volonté lourde de menaces. Leur « amour-propre offensé » (B 29) les stimule, ils se croient provoqués, nargués, défiés. Plus grave encore, après la rencontre d'un berger et d'un garde-chasse, l'inconnu devient pour eux un coupable : il a prétendument tué le chien du berger l'été dernier et volé le fusil du garde-chasse ; il a sûrement fait pire, pensent les autres. Le hors-venu devient leur proie, traquée comme un animal. Des poursuivants sortis de nulle part se joignent aux premiers sans savoir pourquoi ils courent, sinon parce qu'ils veulent s'affirmer, « lui régler son compte » (B 47). L'affaire prend un tour étrange, quasiment onirique : le berger n'a ni bâton ni chien, le garde-chasse est bizarre, puis surgissent des femmes mi-pleureuses, mi-furies. La troupe grossit en meute soudée par l'effort, la haine, l'appétit d'une obscure vengeance.
L'agencement énonciatif rehausse sous la plume de Šćepanović l'étrangeté de sa fable. Tandis que le soliloque malonien émane de l'intimité du personnage, appréhendé tout du long par son discours intérieur, l'organisation textuelle de La Bouche... creuse un écart non mesurable entre le protagoniste et la source inconnue de la voix narrative qui l'a pris en charge. L'appréhension du fugitif par le lecteur restera tributaire de cet écart qui maintient le second à distance. Si Beckett disjoint le je grammatical de Malone et son je entité psychique, dont la coïncidence s'avère problématique, Šćepanović refuse entièrement la première personne au fugitif. Ce dernier est toujours approché du dehors, tantôt par les poursuivants (texte en romain), tantôt par la voix blanche, anonyme et insituable, du narrateur relatant ses faits et gestes (en italique). Cette voix a beau véhiculer aussi la focalisation interne qui transmet les impressions et les pensées du fugitif, le désigner toujours à la troisième personne maintient une distance irréductible. Distance fort troublante, de surcroît : ceux qui disent « nous » sont les meurtriers en puissance, auxquels le lecteur répugne à s'identifier ; inversement, l'altérité maximale au plan de l'énonciation est celle nous séparant de la victime, avec laquelle nous inclinerions pourtant à compatir. Tandis que le discours malonien se joue de lui-même et du lecteur, invitant ce dernier à entrer activement dans le jeu, l'écriture de Šćepanović n'assigne aucune place au lecteur, qui ne sait, comme on dit, 'où se mettre'. La force du texte tient pour partie à ce dispositif qui nous fait témoins de choses que nous ne devrions pas voir, confidents d'un quasi-meurtre et d'un quasi-suicide, spectateurs d'une cérémonie barbare mêlant chasse à l'homme sacrificielle et noces païennes avec la nature, hallali sauvage et rédemption secrète.
Très vite surgissent dans La Bouche... des phénomènes d'écho entre les narrations alternées (en romain, en italique) qui se prolongent mutuellement autant qu'elles s'opposent : les motifs sont repris, dupliqués d'un énonciateur à l'autre, tissant des affinités entre les antagonistes. Les poursuivants prennent d'ailleurs conscience de ce lien obscur, ils se sentent captivés, « ensorcelés » (B 63) par celui qu'ils nomment « notre fuyard » (B 37). Quand ce dernier disparaît à leurs yeux, couché dans les herbes de la prairie : « cet homme s'était réellement mêlé à notre vie, et nous ne pouvions accepter l'idée de l'avoir perdu pour toujours » (B 68). Comme si s'emparer de lui le fusil à la main, voire le mettre à mort était leur façon de ne pas le perdre. À force de traquer leur proie, il leur semble qu'elle « détenait la réponse à toutes ces questions » que faisaient naître en eux « la peur et la perplexité » (B 73). L'inconnu n'a aucune réponse à leur offrir : simplement, le regard d'autrui sur sa personne fait de lui le catalyseur d'un impensé collectif, le révélateur de la tentation d'exclure l'autre, l'étranger, le dissident, au besoin par la violence. La mécanique de la haine prend sous la plume de Šćepanović un relief effrayant : difficile aujourd'hui de ne pas voir dans cette fable une parabole politique sur les tensions nationales en ex-Yougoslavie, voire une anticipation visionnaire de la guerre civile qui éclata vingt ans après la sortie du livre.
*
À la traque haletante du fugitif silencieux s'oppose l'immobilité bavarde du personnage beckettien, que seul animent encore la parole et le geste d'écrire. Si Malone entreprend de « [se] laisser mourir, sans brusquer les choses » (M 7), La Bouche... développe au contraire une ample dramaturgie, resserrée toutefois en quelques pages, où les sentiments sont intenses et tranchés, où les actions s'enchaînent selon une logique plus affective que rationnelle, et où le dénouement semble inéluctable. Un pathétique théâtral se déploie dans l'aspect du fugitif blessé et défiguré, pareil à un fou ou à un aveugle (B 56), éveillant la stupeur, puis la terreur, une sorte d'horreur sacrée qui transforme la meute en chœur tragique. Alors que Malone entend s'effacer : « je serai neutre et inerte » (M 7), « muet, obscur et fade » (M 19), Šćepanović dresse l'univers héroïque de l'exploit, de la lutte désespérée qui affirme et magnifie l'acteur. Dans cette ultime péripétie de son existence, le terne protagoniste prend un relief nouveau jusqu'à paraître grandiose, on voit son chapeau « saisi dans les rayons obliques du soleil, s'embraser comme une auréole flamboyante » (B 22). À ce grandissement épique[6] s'oppose chez Malone un épuisement graduel du personnage, processus qui débute par la désidentification du sujet diégétique : « et à la veille de ne plus être, j'arrive à être un autre », « ce n'est plus moi, j'ai dû le dire déjà, mais un autre dont la vie commence à peine » (M 55), et qui s'achève dans l'impersonnel « rien », dernier mot d'une dernière phrase (est-ce une phrase ?) sans ponctuation, sans verbe, sans procès, pur constat :
« voilà voilà
plus rien » (M 191).
Cet ultime énoncé rompt avec nombre d'incertitudes, celle du lieu redoublant chez Beckett celle du temps[7]. Les deux fables s'inscrivent en des espaces à coup sûr frontaliers, mais mal définis. Le fugitif ignore où il se trouve au juste, « il s'était peut-être rapproché du Monténégro » (B 70) : le fait est qu'allant de Serbie vers son pays natal il passe une frontière immatérielle, faute de limite marquée au sol entre les républiques fédérées yougoslaves. Malone reste lui aussi dans le non-savoir du lieu présent : sa chambre n'est pas dans un hôpital, plutôt dans une maison (allées et venues, cris d'enfants) ou dans un asile. Mais est-ce une chambre, ou un réduit, ou encore un caveau ? Et l'invalide de pasticher le doute méthodique des Méditations cartésiennes (M 74)[8].
Ainsi l'acteur du finir ignore-t-il où passe la limite (finis) définissant sa position. Plus généralement, l'écriture de la fin s'accompagne d'une tendance à déréaliser les référents. Une aura fantastique émane ici et là chez Šćepanović de détails insolites, et les poursuivants se demandent s'ils n'ont pas rêvé le fugitif en croyant le voir (B 76). La déréalisation s'effectue chez Beckett par l'opération du discours lui-même : c'est comme fait de langage que le soliloque tend à s'autodétruire à coup d'équivoques sournoises, de torpillages furtifs et de significations réversibles. Le parleur affirme une chose et son contraire : « pressé de finir. Et pourtant non, je ne suis pas pressé » (M 55), « oui, on dirait vraiment que non » (M 111). L'instabilité du dire et celle de l'être vont ainsi de pair dans la duplicité d'un texte émaillé de calembours, d'équivoques et de paronomases insidieuses[9] qui font jaillir un sens second venant parasiter le contenu premier et manifeste : le propos se conteste chemin faisant et « tout se divise en soi-même » (M 12). La déréalisation atteint jusqu'aux catégories du vivre et du mourir, estompant la frontière entre ces états quand « se sentir vivre de cette façon » remplace « se sentir mourir » qui précédait de peu (M 15), quand on se demande « si l'on n'est pas mort à son insu ou né à nouveau quelque part » (M 86)[10].
L'imminence de leur fin introduit les deux personnages à une problématique de l'identité qu'ils abordent différemment. C'est la nature même du sujet qui se trouve questionnée par Malone : « D'ailleurs peu importe que je sois né ou non, que j'aie vécu ou non, que je sois mort ou seulement mourant, je ferai comme j'ai toujours fait, dans l'ignorance de ce que je fais, de qui je suis, d'où je suis, de si je suis » (M 85). La phrase précédente revêt une portée singulière si l'accent dubitatif porte sur le pronom sujet (je) plutôt que sur les verbes prédicats (faire, être) : le doute concerne alors la cohésion du moi plutôt que son existence, « n'ayant été toute ma vie qu'une suite ou plutôt une succession de phénomènes locaux » (M 99). Ce thème, fondamental chez Beckett, du sujet décentré et insaisissable, a été maintes fois commenté. Le je par lequel se désigne Malone ne réside clairement ni dans le corps ni dans la pensée, aussi le cogito cartésien ne lui sert-il de rien pour rétablir une certitude : sa pensée le cherche « là où je ne suis pas » (M 19). C'est d'ailleurs parce que le sujet infailliblement se dédouble, échappant à la prise, que Malone peut évacuer l'angoisse et se promettre de finir en paix : pendant que la pensée sera en proie « à sa rage d'agonisante », « je serai tranquille » (M 19). Inversement, le parleur se projette dans les histoires qu'il invente, s'identifie à Sapo ou à Macmann, autre façon d'ignorer son je moribond pour s'amuser du reste : « C'est un jeu maintenant, je vais jouer. Je n'ai pas su jouer jusqu'à présent » (M 9). Il vivait auparavant les histoires, le voici maintenant disponible pour les raconter : quelle liberté ! Mode d'emploi, somme toute, « pour un usage guilleret de l'agonie », observe un critique[11] faisant écho à l'humour noir de Beckett : « la fin d'une vie, ça ravigote » (M 62).
Ainsi Malone se met-il en texte comme subjectivité aussi excessive qu'évanescente. Déficit et excès d'identité constituent les deux faces inséparables d'un sujet qui flotte entre des supports multiples et qui déborde d'un trop plein de mots, qu'il s'agisse de l'involontaire « charabia » (M 30), « galimatias effréné » (M 54) emplissant son cerveau ou des récits qu'il invente à plaisir. Vivre et faire vivre – par le jeu, l'affabulation, l'écriture – se confondent, la vie étant ce que l'on raconte, « c'est ma vie, ce cahier » (M 168).
Le fugitif de Šćepanović suit le trajet inverse : sujet d'abord creux, épuisé, évidé, il finira par s'emplir de ce qui lui avait jusqu'alors échappé. Il n'a que faire de jouer comme Malone avec des substituts ou avec l'idée du « rien »[12] : lui veut au contraire se reprendre, se ressaisir comme unité d'un être pensant, désirant et libre. Et c'est lui-même qu'il réinvente au moment de finir.
*
Si finir revient pour Malone à survivre en attendant le terme irrévocable, et pour le fugitif à revivre contre toute attente, l'enjeu pour chacun d'eux consiste pareillement à « mourir vif » (M 57). Le personnage de Šćepanović a manqué sa vie, mais l'espoir de mieux faire éclot soudain et il renonce à se supprimer, voulant « remplir chaque instant qui lui restait de quelque chose qui méritât d'être vécu » (B 39). La course-poursuite ranime son sentiment d'exister à travers la souffrance et la félicité. Tout lui semble à présent « plus beau et plus réel » (B 53) que son passé inconsistant. De ce dernier il ne récupère in extremis qu'un fragment précieux, le souvenir du blanc sommet de la Prékornitsa qu'il aspire à revoir « comme l'unique chance de salut » (B 57). Ce vœu se trouve exaucé quand la cime couronnée de neige lui apparaît enfin : mirage peut-être, mais source d'un bref bonheur absolu, vision épiphanique lui offrant ce qu'il cherchait avec désespoir - la vie, sa vie qu'il croyait perdue. Il la tient dès lors dans ses mains, les siennes. On ne lui volera pas sa fin. Ce qu'il nomme « salut », c'est d'avoir soustrait à l'issue imminente, épuisé par la course ou lynché par les poursuivants, cet instant d'exception grâce auquel il pourrait « dire au monde entier son bonheur d'avoir enfin échappé à sa destinée » (B 80). D'abord prévu dans le désespoir comme délivrance violente, le terme de son destin a finalement changé : plutôt que fracassé au fond d'un gouffre ou pendu à un arbre solitaire, l'homme meurt rayonnant de la beauté du monde, étendu dans les herbes, souriant.
*
Pareille issue conduit à reprendre la question qui sous-tend les deux textes, celle du sujet et de son identité. Si la vie est ce « trop long exil hors de soi-même », ce processus par lequel un « je » cherche à saisir son « moi » et à coïncider avec lui, « cette tâche harassante du moi cherchant à s'atteindre »[13], alors écrire la fin et approcher par l'imaginaire cette limite dénude la vie dans sa vérité élémentaire. Ivan Illitch agonisant fait certes une expérience similaire, mais la découverte du héros de Tolstoï, qui se reproche d'avoir vécu dans le mal et dans le mensonge, concerne les valeurs morales et religieuses[14]. Pour Malone et pour le fugitif monténégrin, c'est plutôt la question de l'identité psychique et ontologique qui se referme. En renvoyant leur haine à ses poursuivants, le je de l'homme traqué, sujet jusqu'alors fantomatique, rejoint enfin son moi, constitué par le regard et l'action des autres en objet de curiosité, de haine, de fascination. En échappant à la mise à mort, signe d'aliénation au collectif nationaliste ou totalitaire, l'inconnu se reconstitue comme être autonome. En rejoignant la Prékornitsa - vue ou rêvée, qu'importe -, il fait coïncider passé et présent, annule le temps, trouve une éternité au cœur de l'instant. Enfin, mourant « sa bouche pleine de terre » (B 81), il subvertit le verdict d'infamie émis par les chasseurs qui les premiers ont employé ces mots pour le menacer de mille tourments affreux (B 51). Sa mort accomplit certes le verdict, mais le transfigure en effusion panthéiste : immergé dans la splendeur du monde, dans ces prairies d'herbes odorantes[15] qu'il dévore à pleine bouche, le malheureux redécouvre l'existence comme plénitude, expirant à la fois souillé et extasié, corps glorieux et corps humilié.
Se raconter des histoires, est-ce pour se quitter ou pour se trouver ? Tout en l'énonçant avec un inlassable brio, Malone congédie la problématique de l'identité, celle qui dissocie je et il (M 55), je disant et je écrivant (M 57), je et moi (M 59, 128), Malone et l'autre (M 82). Finir, c'est mettre un terme à la question, la découvrir caduque, ne plus avoir ni à se définir ni à s'abandonner : « j'ai fini de me chercher. Je suis enfoui dans l'univers, je savais que j'y trouverais un jour ma place, le vieil univers me protège, victorieux » (M 40). Dans cet enfouissement cosmique le parleur beckettien trouve une jouissance de plus à finir.
*
Que conclure du parallèle ? Chacun des deux livres peut s'envisager comme une mise en abyme de l'écriture littéraire. Se raconter des histoires (Malone), transformer sa mort en légende (le fugitif) n'est pas esquiver ou travestir la réalité. C'est pour le second réenchanter l'existence, c'est pour Malone reconstituer le réel fissuré : si tant est que « rien n'est plus réel que rien » (M 30), l'écriture du finir réalise ce rien, l'accomplit, forge l'identité du réel et du rien actualisée par la toute dernière ligne (« plus rien »). Actualisation illusoire, à vrai dire, puisque Malone meurt n'est pas le terme de la trilogie beckettienne, juste une fin provisoire qu'il faudra rejouer. « Finir est à souhaiter, finir serait merveilleux, qui que je sois, où que je sois », dira bientôt l'Innommable[16] : cette relance confirme que l'écriture de la fin ne raconte pas le mourir et fait juste semblant. C'est cela aussi, « mourir vif » (M 57) : mimer ce que serait la véritable fin, l'absolue, celle où coïncideraient l'énonciateur et son propos ultime - issue reportée tant qu'il y a un esprit pour la concevoir, un mot pour la dire. Malone habite donc un no man's land frontalier dans lequel mourir n'est jamais la mort, finir n'est jamais mourir. Le goût de vivre reconquis in extremis par l'anti-héros de Šćepanović n'est pas moins équivoque. Aux « vieilles apories » (M 10) du parleur beckettien, champion de l'auto-réfutation, répondent dans La Bouche... l'ironie tragique dont se charge le mot de « salut » (B 57) cité plus haut, ainsi que l'ambivalence du dénouement, acmé dionysiaque où l'horreur s'unit à l'exaltation : le fugitif près d'expirer chante et crie à la fois - hymne à la joie et cri bestial d'agonie lugubre. Faute de représenter l'authentique fin d'une vie, l'écriture du finir opère du moins comme un charme magique : elle change le visage abstrait de la mort en le réfléchissant dans ce qui n'est pas elle, en le réverbérant dans une alternative bien vivante, ouverte de ce côté-ci du miroir et de la frontière - à savoir le vertige infini des mots chez Malone et l'extase matérielle[17] du fugitif.
*
L'héritage complexe dont procède La Bouche pleine de terre[18] démultiplie les résonances du livre et les significations qu'on peut lui prêter. Expression d'une conscience malheureuse liée à un conflit d'appartenance (l'auteur semble avoir un compte à régler avec son Monténégro natal[19]), le texte offre aussi une parabole de l'aliénation à un ordre collectif tyrannique : comme dans d'autres fictions de Šćepanović (Le Rachat où la meute sociale impose sa loi, La Mort de Monsieur Golouja où la communauté villageoise s'empare du destin d'un solitaire), l'individu doit payer le prix fort pour s'appartenir, rançon parfois mortelle. Enfin, à la lecture chrétienne ébauchée par P.-E. Dauzat[20] nous préférons ici une lecture ontologique, mieux partagée entre les deux auteurs. Le réel dans ce cadre équivaut au néant, au rien (axiome malonien déjà cité), qui se traduit chez l'écrivain serbe par diverses formes de mort symbolique : dépersonnalisation comme dans La Honte[21], remplacement du vivant par un simulacre (la statue de Gregor Zidar) comme dans Le Rachat. Dès lors, la vie et la mort véritables, hors simulacre, loin de s'opposer résident du même côté - le côté du salut, de l'être authentique enfin ressaisi au travers d'une expérience paradoxale. L'ardeur à vivre du fugitif se réveille avec la possibilité de finir libre et seul : vie et mort se rejoignent alors dans l'être, finir signifie être vraiment.
Date de publication : juillet 2014
> DOSSIER SPÉCIAL : la Grande Guerre
- See more at: http://serbica.u-bordeaux3.fr/index.php/revue/sous-la-loupe/164-revue/articles--critiques--essais/764-boris-lazic-les-ecrivains-de-la-grande-guerre#sthash.S0uYQ00L.dpuf
|