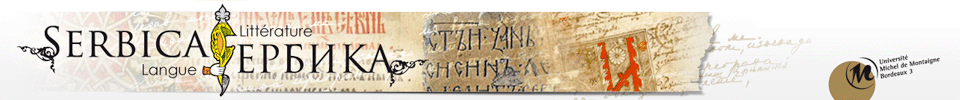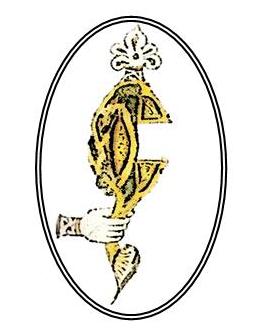|
MILOŠ CRNJANSKI
(1893-1977)
A LA YOUGOSLAVIE
Pas un verre que l'on boive,
pas un drapeau qui flotte au vent,
qui soit nôtre.
Salut, mon noir Croate de Zagorié,
rusé, sinistre, cabochard.
tu me plais.
Salut à vous, là-bas dans le doux clair de lune,
vous tous mes frères, tapis en embuscade,
je ne vous en veux plus.
Salut vous tous, sourcils touffus,
troubles regards, tristes chansons,
terribles frères.
Mêmes jurons ouvrant nos bouches,
fille et couteau sur la grand-place,
honte à demeure.
Salut nos femmes, feu et flamme !
Des mêmes pleurs, peur et douleur,
brodant nos linges et nos noces.
Et que nous font fêtes à boire,
les saints patrons et les églises ?
Nos yeux n'ont point vidé leurs larmes,
les morts se taisent, les autres crient.
Salut, sombres regards dans les chaumières,
haine et discorde.
Salut, dans le remords, la honte, le malheur,
frères nous sommes !
Zagreb 1918
STRAJILOVO (1)
J'erre, encore svelte, avec un arc d'argent,
guettant, pour les leurrer, les cerisiers en fleurs,
mais, par delà ces bois, je sens déjà ma terre,
où, sous les peupliers, je mènerai mon rire
pour l'y ensevelir.
Ici, en ce soir printanier,
le froid me prend les os,
comme si le Danube hantait cette vallée.
Mais, là-bas où les nues vont sombrant dans l'Arno,
où dans l'azur frémit le vert cru des bois,
je vois le pont mener par-delà l'horizon,
dans l'ombre épaisse des Monts de Fruchka (2).
Et, au lieu de saluer la lune, celle de Toscane,
qui brille dans le fleuve, épanouie comme un lys,
je sais qu'en ce printemps me prendra la toux sinistre
et je vois ce corps svelte, comme feuille tombant,
fidèle et triste,
par l'ombre et par le pas, dans les flots résonnants,
au fond des cieux limpides.
Et, ainsi, je pressens
que mon âme, bientôt, s'emplira de tourments.
Et désormais je vis,
pris de malaise, au-dessus de ces fleuves pigeon gris.
J'ai autrefois mené cette ombre au dos voûté,
et, si j'avais voulu, j'aurais, là-bas dans la montagne,
connu les grappes, la nuit, le boire et bavarder,
et le torrent, dont le murmure, en notre lieu, témoigne.
Et, ainsi, sans tristesse,
mes yeux se sont troublés de quelque mal, sans cesse,
et ainsi, sans luxure,
à mes lèvres mûrit l'âpre pourriture.
J'erre, encore, svelte, avec un arc d'argent,
guettant, pour les leurrer, les cerisiers en fleurs,
mais, par delà ces bois, je sens déjà ma terre,
où, sous les peupliers, je mènerai mon rire
pour l'y ensevelir.
Depuis longtemps je sens que fond et se disperse
tout ce que je bâtis, de nuage et d'eau, sur les monts,
et que, par quelque peine qu'apporta la jeunesse,
l'amour me rend fragile, frêle comme un rayon,
diaphane et vagabond.
Je sais qu'en mes cheveux
une lasse main étrangère
en cette rouge aurore sème un couchant cendreux,
et que ma joie ne peut, exultante, incendiaire,
à cause de deux seins, endormis, douloureux,
parcourir en criant les cerisiers en fleurs
qui me sont restés au pays de mes aïeux.
Et, au lieu d'accompagner d'un regard vert,
comme avant, le fleuve qui dérive,
de bondir, comme la lune, de par les monts déserts
et d'attiser les bois incandescents,
maintenant, dans la neige bleu clair,
épaisse, et dans la glace, j'apaise, en souriant,
tout ce qui arrive.
Et, ainsi, sans nul lien,
un frisson familier, douloureux, pourtant me vient.
Et, ainsi, sans maison,
le destin, pourtant, me sera compagnon.
Non, nulle peine n'est venue précéder ma naissance,
une main étrangère a parsemé de tout cela mon être.
Je sais que j'entre lentement dans une longue souffrance,
je le sais, quand jauniront les feuilles, je courberai la tête.
Et, ainsi, sans souffrance,
je reviendrai, souffrant, aux vergers de l'enfance,
et, plein de mauvais sang,
je ferai tant souffrir tout ce qu'irai touchant.
Depuis longtemps je sens que fond et se disperse
tout ce que je bâtis, de nuage et d'eau, sur les monts,
et que, par quelque peine qu'apporta la jeunesse,
l'amour me rend fragile, frêle comme un rayon
diaphane et vagabond.
J'erre, encore, svelte, par des ponts étrangers,
je me tais, allongé sur les eaux parfumées,
mais, sous les flots, déjà, je perçois la contrée,
d'où je vins, semé de feuilles dorées,
éparpillées.
Ici aussi, ce rouge de lys,
à l'aube, fatigué, je l'essuie
sur ce flanc virginal, sans délices.
Mais, quand j'aurai noyé la nef de l'astre de la nuit
dans la mer neuve du matin et dans les herbes,
m'asseyant sur un nuage, je verrai la lumière,
jaillie de ma passion, de par le ciel, en gerbes.
Car, au lieu de ma vie, depuis longtemps j'habite
les trombes et les ombres des ceps lourds de fruits.
Je poursuis un destin, depuis chez nous scellé,
une enfance malade, sans cesse ni repos,
venue quand je suis né,
dont les feuilles, tombant du tombeau de Branko (3),
se posent sur ma vie.
Et, ainsi, sans tombeau,
une gaieté, en moi, laide comme un crapaud.
Et, ainsi, sans un corps,
mon âme est invisible, sans liesse, sans essor.
Un printemps est venu quand, amer, j'ai compris
que je jouais ma santé aux flûtes du flanc virginal,
que, dans les grappes, je déchirais ma poitrine en un cri,
nu, au fond du ciel, soûl de mon pays natal.
Et, ainsi, sans visage,
mon front s'ombre du bouc, du cerisier, des oiseaux de passage.
Et, ainsi, sans demeure,
je titube, sans fin, dans l'ici, dans l'ailleurs.
J'erre, encore, svelte, par des ponts étrangers,
je me tais, allongé sur les eaux parfumées,
mais, sous les flots, déjà, je perçois la contrée,
d'où je vins, semé de feuilles dorées, éparpillées.
Je palpite, encore, svelte, de fleuves et de cieux.
J'étreins l'air, de mon ultime force, de mon dernier espoir,
mais je mourrai d'amour, je le sens même ici,
pour ce monceau de terre, qui fut jeune autrefois,
sous le vignoble du terroir.
Pour ce corps si charmant,
qui, le premier, fit osciller
guigniers et cerisiers, chez nous, en m'embrassant,
qui surgissait, par ci par là, des marais et bourbiers,
pour ceux qui partageaient la gourde, la semant
de feuillages flétris, en leur trouble sourire,
sautant, pour la première fois, les ruisseaux, en riant.
Mais, au lieu de ma vie, je sais qu'un peu partout
j'ai dispersé ce rire, sur tant de corps, nus,
et, au-dessus de ce sol où l'Arno rose passe,
plein de rayons et d'astres, mon murmure dérive
dans la poitrine lasse,
puisque, chaque printemps, c'est cela qui m'arrive,
partout, l'amour venu.
Et, ainsi, sans rien dire,
toutes les autres morts, je saurai les guérir.
Et sans traces laisser,
ma main dispersera les corps vivants des bien-aimées.
Car mon amour mélangera, secrètement,
dans l'univers tous les ruisseaux et les aurores,
faisant descendre, sur la vie, sereinement, infiniment,
chez nous aussi, le ciel, et l'ombre des Monts de Fruchka.
Ainsi, sans bruissement,
mon rire ira tombant de l'arc du firmament
Ainsi, sans fermenter,
à ma suite la vie se fera cerisier.
Je palpite, encore, svelte, de fleuves et de cieux.
J'étreins l'air, de mon ultime force, de mon dernier, espoir,
mais je mourrai d'amour, je le sens même ici,
pour ce monceau de terre, qui fut jeune autrefois,
sous le vignoble du terroir.
J'erre, encore, svelte, dans mon trouble souriant,
et je croise les bras, dessus les nuages blancs,
mais, peu à peu, clairement je pressens
que, moi aussi, je me meurs, l'esprit s'assombrissant,
taciturne et pesant.
C'est un fleuve, ici aussi, que je vois, sous mon corps,
rafraîchissant la terre, légère, argentée, infinie.
Mais, quand les cerisiers sèment mon âme en sa douleur,
quand l'astre, ici comme au flanc de la lune, s'allume,
je vois que la jeunesse, en sa précoce agonie,
qu'elle soit autre ou mienne, est amère et la même.
Et, au lieu de mon destin, dans ses nouvelles affres,
je rencontre ma vie d'antan, diaphane, douloureuse,
mais, par delà cette terre ici, translucide et soyeuse,
dès que, pris d'effroi, je dépose le corps virginal
dans un olivier calme,
je revois, au loin, les feuillages flétris
et, sous les nuages, ma patrie.
Et, ainsi, sans bouger,
j'élève en un baiser ce sol-ci dans les vents printaniers.
Et, ainsi, sans un signe,
je fais surgir l'aimée, nue, de la nuit molle de Toscane.
Mais cendre, tout est cendre, quand je lève le bras
et le passe, sur les monts transparents, et sur l'eau.
Et si faibles sont tous ces guigniers qui, avec moi,
se traînent, de par le monde, comme terre en sanglots.
Et, ainsi, sans ténèbres
mon esprit me recouvre de vergers sombres.
Et, ainsi, sans un nom,
je caresse les monts là-bas de la même affliction.
J'erre, encore, svelte, dans mon trouble souriant,
et je croise les bras dessus les nuages blancs,
mais, peu à peu, clairement je pressens
que, moi aussi, je me meurs, l'esprit s'assombrissant,
taciturne et pesant.
J'erre, encore, svelte, de passion murmurant,
et je secoue mes membres, par le rire envahis,
mais, lentement, de par ma trace, je pressens
que le silence me prendra, quand tout sera flétri,
moi aussi, moi aussi.
Il n'y a de vergers, même ici,
qui n'ait cette couleur cachée,
cette couleur de ciel, amère et infinie.
Et quand, de mes deux mains, j'écarte les vallées,
pour en sonder les abîmes argentés et lactés,
j'y retrouve au fin fond la douleur, incertaine et légère,
des vergers et des corps baignés d'air.
Et, au lieu de sillons d'argent, de coteaux et de fleuves,
je rencontre, comme en rêve, des pensées lasses, miennes ;
or, sur les guigniers et jeunes cerisiers, partout,
un brouillard sombre et long se répand, se déploie
dans la vie devant nous,
où la passion, lentement, dans l'agonie décroît,
et les sens se déprennent.
Et, ainsi, sans rien suivre,
je lange ma jeunesse de paix, paix de neige et de givre.
Et, ainsi, sans chemins, errent mes caresses sur l'agonie et le déclin.
La paix, partout la paix, quand j’éparpille ce qui fut,
quand j'incline le front sur ce que vie m'amène ;
sur ce pays, d'où le vin coulait sans retenue ;
le rire aussi, et la divine impudeur, lointaine.
Et, ainsi, sans effroi,
J'inonderai notre vie des aubes de Fruchka.
Et, ainsi, sans rien boire,
je danserai, jusqu'à la mort, du joyeux rythme des soûlards.
J'erre, encore, svelte, de passion murmurant,
et je secoue mes membres, par le rire envahis,
mais, lentement, de par ma trace, je pressens
que le silence me prendra, quand tout sera flétri,
moi aussi, moi aussi.
Fiezole, 1921
|
(1) Strajilovo : localité de Fruška gora, où se trouve tombeau du grand poète romantique Branko Radičević.
(2) Monts de Fruchka (Fruška Gora) : montagne en Voivodina, près de Novi Sad.
(3) Branko Radičević (1824-1853), la grande figure du renouveau littéraire serbe.
|
SUMATRA
L'instant nous est léger, plein de tendre insouciance.
L'idée soudain nous vient des neiges, du silence
au sommet de l'Oural.
Que vienne nous peiner quelque visage blanc
Que nous avons perdu autrefois dans le soir,
nous savons qu'à sa place un torrent,
rougeoyant, ruisselle quelque part !
Un amour, un matin, dans un pays lointain,
enveloppe notre âme, accentuant son emprise,
de la paix infinie des mers bleues
où les grains de corail sont aussi merveilleux
comme, au pays natal, les cerises.
Nous éveillant la nuit, nous faisons, tendrement, un sourire
à la lune dont l'arc est tendu rayonnant.
Et puis nous caressons les lointaines montagnes
et les forêts glacées, de la main, doucement.
Belgrade, 1920
|