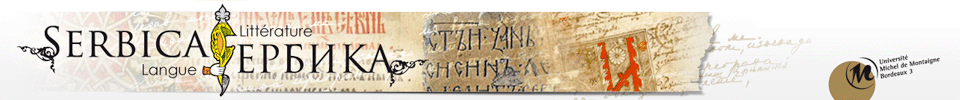|
> SOMMAIRE <

|
III
LES ANNÉES D’OUVERTURE
(1975-1991)
1. Le réveil de la critique
Après l’accueil prometteur réservé dans les années 50 et 60 d’abord aux œuvres d’Ivo Andrić et puis à celles de Miodrag Bulatović, la critique française a presque complètement détourné son regard des rares prosateurs traduits du « serbo-croate ». Heureusement, ce mur d’indifférence, apparemment solide et sans faille, ne persistera pas trop longtemps. Dans la deuxième moitié des années 70, les critiques français commencent à porter un nouveau regard sur les livres venus de l’ex-Yougoslavie. Leurs textes écrits parfois avec enthousiasme montrent en effet qu’ils étaient en train de redécouvrir une littérature qu’ils avaient déjà oubliée.
Quelles sont donc les raisons qui ont pu conditionner ce revirement dans l’attitude de la critique ? Disons-le d’emblée : sans être aidée par des facteurs extérieurs, c’est la littérature serbe elle-même qui a contribué le plus au changement de comportement de la critique française à son égard. Plus précisément, c’est grâce à ses qualités littéraires proprement dites, et à son nouvel esprit, plus ouvert et plus moderne qu’auparavant, qu’elle a réussi, malgré tous les inconvénients et avec un certain retard, à se faire remarquer en France. Citons, à ce propos, les noms de ceux qui ont le plus participé, à côté de Miodrag Bulatović, à l’apparition de ce nouvel esprit de la prose serbe : Meša Selimović, Dragoslav Mihailović, Danilo Kiš, Branimir Šćepanović, Borislav Pekić, Aleksandar Tisma, etc. Après avoir conquis la scène littéraire de leur propre pays, ces écrivains n’ont pas pu non plus rester à la longue inaperçus à l’étranger, y compris en France. Certes, leur sortie sur la scène française ne sera pas toujours une aventure heureuse et fertile. Mais au fur et à mesure, la situation évoluera en leur faveur et les meilleurs d’entre eux seront accueillis dans l’Hexagone, sinon avec l’intérêt qu’ils auraient mérité au moins avec respect et bienveillance.
Le livre auquel revient le mérite d’être le premier à avoir franchi le fameux mur d’indifférence est La Bouche pleine de terre de Branimir Šćepanović. La publication de ce roman en 1975 a réveillé la critique française de façon fulgurante et marqué en même temps un tournant dans son comportement à l’égard d’autres écrivains contemporains serbes. Impressionnés par la force de l’écriture de Šćepanović, les critiques se sont soudain rendu compte que cet écrivain ne surgissait pas ex nihilo et que la littérature où il évoluait, négligée en France, pouvait bien cacher d’autres « surprises ». Cette prise de conscience a été le premier pas important qui permit à un certain nombre de critiques de sortir de la passivité mais aussi d’encourager les traducteurs et les éditeurs à agir à leur tour.(1) Les interventions des critiques furent-elles entendues par ces derniers ? Pas immédiatement et pas suffisamment, pourrait-on dire. Notons, cependant, le cas exceptionnel de l’Age d’Homme dont le rôle dans la promotion de la littérature serbe a été et reste toujours très important. En se rendant compte que les éditeurs francophones n’étaient pas très intéressés par le domaine slave, cette maison d’édition s’est particulièrement consacrée, dès le début des années 70, à la publication d’auteurs slaves et notamment serbes. C’est à elle, d’ailleurs, que l’on doit en partie la découverte de nombreux écrivains de l’ex-Yougoslavie durant les huitième et neuvième décennies.
Quant à la critique, l’évolution de son attitude deviendra, dans les années qui ont suivi la découverte de La Bouche pleine de terre, de plus en plus évidente. D’ailleurs, à côté de Šćepanović, un autre écrivain a été découvert dans la même époque : l’excellent romancier Meša Selimović. A ce duo il faut ajouter, bien évidemment, Ivo Andrić, dont nous avons déjà parlé, et qui sera à nouveau présenté au public après douze ans de « pose ».
2. Deux grandes découvertes : Branimir Šćepanović et Meša Selimović
Il y a des livres qui, sans efforts particuliers de la part de leurs éditeurs et sans publicité quelconque, réussissent à s’imposer par leurs qualités littéraires et par leur force intérieure. C’est le cas justement de La Bouche pleine de terre qui fut accueilli en France, aussi bien qu'en Suisse et en Belgique, comme un véritable événement. Mal préparés à une telle nouveauté venant d'une littérature dont ils avaient une idée très vague et plutôt stéréotypée, les critiques n'ont pas caché leur étonnement, voire leur admiration. Au milieu de ce torrent de louanges, il y avait certainement des exagérations propres au discours journalistique. Mais, en somme, ce livre de Šćepanović, produit d'une imagination peu commune, a trouvé l’écho qu'il méritait. Voici quelques citations à titre d'exemple. C’est « un roman qui, par sa profondeur, la puissance de sa thématique et la beauté de son verbe, se hisse au niveau de la plus grande littérature », écrit le Magazine littéraire.(2) En Suisse et en Belgique, ce sont les mêmes commentaires élogieux. « Ce récit tendu comme un cri ne ressemble à rien de connu », constate le critique stupéfait du Journal de Genève(3), tandis que celui de Notre temps conclut avec des mots encore moins conventionnels : « Je vous le conseille : cherchez ce livre coûte que coûte, et lisez-le ! C'est mon Goncourt... »(4)
Ce roman court, mais riche en significations et en symboles qui lui donnent une allure énigmatique a, tout d'abord, provoqué la curiosité de ses commentateurs par son sujet inhabituel : la chasse à l'homme. Mais ce n'est pas seulement son histoire étrange qui a séduit les critiques mais aussi, et surtout, ses qualités littéraires proprement dites. Selon Georges Nivat, l’un des plus fidèles adeptes du « Camus serbe », ce roman de Šćepanović est « une fable métaphysique » qui, certes, fait penser à Albert Camus, mais qui, au fond, représente une œuvre authentique, « un chant singulier, isolé, unique peut-être dans les lettres d'aujourd'hui » !(5)
Après cette abondance de louanges adressées à La Bouche pleine de terre, il paraissait évident que le chemin pour la pleine affirmation de Šćepanović en France, était finalement ouvert. Pourtant, ce n'était pas le cas. Les ouvrages parus plus tard – L’autre temps (1977), La Mort de monsieur Golouja (1978), Le Rachat (1981) et L’été de la honte (1992) – ont été accueillis avec beaucoup moins d'enthousiasme. Après sa découverte fulgurante, Šćepanović a donc dû à l’instar de son grand compatriote, Ivo Andrić, subir les aléas de la mode littéraire et les caprices de la critique pour laquelle il était, et reste toujours, l'auteur d'un seul livre : La Bouche pleine de terre.
Deux ans après la découverte de Šćepanović, la critique française fut secouée par une nouvelle surprise de taille : Le Derviche et la Mort (1979) de Meša Selimović. Ce roman extraordinaire qui atteint la brillance et l'universalité d'un véritable chef-d’œuvre a d'abord attiré la curiosité des critiques par son décor historique à l’allure exotique : la Bosnie du XVIIIe siècle sous le joug oppressif et anachronique des ottomans. Mais ils se sont également rendu compte qu’au-delà de cette dimension pittoresque, Le Derviche et la Mort offrait beaucoup plus. Par l’intermédiaire de ce décor exotique, l'écrivain tisse avec virtuosité une histoire troublante tout en soulevant plusieurs questions éthiques, philosophiques et métaphysiques qui concernent les rapports délicats entre la foi et le devoir, les lois et la spiritualité, le pouvoir et l'amitié, la mort et le pouvoir, etc.
Évidemment, le thème central, qui domine tous les autres, est celui du pouvoir, thème qui a d’ailleurs suscité le plus d’intérêt des critiques. Ainsi, pour L.aurand Kovacs, le rapport entre l'homme et le pouvoir est conditionné par la réponse à la question cruciale du roman : comment se comporter à l'égard de soi-même ?(6) Car l’homme ne dépend pas de quelque chose d’extérieur ; il se définit lui-même, par son choix et sa volonté de réagir ou de ne pas réagir. Bien entendu, dans cette idée il est facile de reconnaître certains principes de la philosophie de l'action, chère en particulier à un Malraux ou un Hemingway auxquels Kovacs compare Selimović tout en précisant que la philosophie de ce dernier se révèle, au bout du compte, « plus altruiste et moins didactique » que celle dégagée par le Français ou l’Américain.
Les critiques ont également mis l'accent sur un certain élément oriental, présent dans le roman à travers les types spécifiques des héros et les nombreuses citations du Coran. La comparaison avec la littérature orientale s'est, en fait, imposée d'emblée. Mais, tout en sachant qu'il s'agit d'un écrivain européen, les critiques n'ont pas tiré de conclusions simplificatrices. Ils ont plutôt essayé d'interpréter ce livre en tenant compte de sa complexité intérieure qui provient justement de la double identité culturelle de son auteur. A cet égard, Auguste Rich fut assez explicite. Pour lui, Le Derviche et la Mort est une composition sophistiquée où s'entrecroisent, en parfaite harmonie, deux modèles, pourtant très différents : celui du conte oriental et celui du drame shakespearien.(7) Edgar Reichmann constate, lui aussi, que ce roman prend l’allure d’un conte oriental, mais, ajoute-t-il, cela ne l'empêche pas de susciter de «troublantes interrogations » d'une manière tout à fait moderne, par l'intermédiaire d’« une analyse psychologique raffinée » qui s'adapte parfaitement à une construction romanesque « sans défaut ».(8)
Le succès du Derviche et la Mort a certainement poussé Gallimard à présenter au public un autre livre du même auteur : La Forteresse (1981). Mais ce roman n'a malheureusement pas réussi à attirer l’attention de la critique française, ou bien, pour être plus précis, pas autant qu’il aurait mérité.
3. Le réveil des éditeurs
Après la découverte de Šćepanović et Selimović, qui a fait naître un espoir en un meilleur avenir pour leurs confrères d'ex-Yougoslavie, la décennie suivante a commencé par un événement qui aurait pu avoir un impact important sur la réception de la littérature serbe en France, comme il y en a eu un d’ailleurs sur son évolution interne. Rappelons-nous brièvement : en 1980 disparaît le maréchal Tito, fondateur et président à vie de la Deuxième Yougoslavie. Sa disparition marque en effet la fin d’une époque et le début d’une autre, beaucoup plus agitée, qui finira de façon dramatique par la guerre civile et l’effondrement du pays en 1991. Les intellectuels serbes et plus particulièrement les écrivains sont parmi les premiers à avoir senti que la disparition de Tito sonnerait tôt ou tard le glas d’un régime autoritaire longtemps dissimulé par la personnalité charismatique du Président. Conscients que le régime communiste ne pouvait plus fonctionner comme auparavant, ils ne sont pas restés longtemps les bras croisés. Sans craindre des représailles toujours possibles, ils ont d’abord lancé un défi au pouvoir en recourant à des thèmes considérés comme tabous, ce qui a déclenché un courant littéraire contestataire qui ne cessera de prendre de l’ampleur dans les années suivantes.
Comment donc cette évolution de la littérature serbe fut-elle perçue en France ? La disparition de Tito a suscité dans ce pays, avant tout, l’intérêt du milieu politique. Les éditeurs ont, eux aussi, immédiatement réagi en publiant quelques livres qui jetaient une lumière particulière sur la personnalité du président yougoslave. Mais bien que la disparition du maréchal ait sollicité l’intérêt des Français, on ne peut pourtant pas dire qu’elle ait influencé considérablement leur attitude à l’égard des écrivains d’ex-Yougoslavie, ou qu’elle ait créé un nouvel « horizon d’attente ». Cela dit, un léger regain d’intérêt pour les écrivains du « Pays de Tito » s’est fait tout de même sentir au début des années 80, mais il nous semble qu’il s’agit plutôt d’une suite logique à la période d’ouverture dans la seconde moitié des années 70.
En ce qui concerne le nouveau courant littéraire contestataire en Serbie, celui qui a fortement participé au processus de « détitisation » de la culture, il faut souligner que les Français l’ont simplement découvert avec retard, à la fin des années 80 et surtout après le déclenchement de la guerre civile. C’est à cette époque précisément que les éditeurs ont commencé à accorder plus d’attention aux romans à fort accent politique: il s’agit notamment du Livre de Miloutine (1989), Le Temps du mal (1990) et Le Couteau (1993). Mais s’il est vrai que les éditeurs ont réagi plutôt tardivement vis-à-vis de ce type de littérature, on ne peut pourtant pas affirmer qu’ils aient négligé les écrivains serbes en général. Au contraire, après une longue période d’hésitation, ils se sont réveillés à leur tour, en s’ouvrant de plus en plus aux auteurs venant de Serbie : à ceux déjà présentés au public français mais aussi aux nouveaux talents alors complètement inconnus en France. Pour faire valoir ce constat, il suffit de se référer aux données statistiques. Sans compter les rééditions de quelques ouvrages épuisés, 34 nouveaux titres ont vu le jour en France durant la période 1980-1990, ce qui fait un tiers de plus par rapport à la période 1970-1980.
Nous avons déjà remarqué que les éditeurs n’avaient pas suffisamment suivi la critique dans son ouverture sur la littérature serbe. Durant les années 80, ce rapport a considérablement changé : c’est la critique qui n’arrive pas à suivre les éditeurs emportés par leur élan. Non, cela ne signifie pas que la critique se soit à nouveau endormie après un réveil temporaire : elle s’est, en fait, concentrée en particulier sur le grand quatuor, si on peut le dire ainsi, composé des écrivains qui ont profondément marqué la littérature serbe contemporaine : Danilo Kiš, Aleksandar Tišma, Miloš Crnjanski et Milorad Pavić. Parmi ces quatre écrivains, Danilo Kiš est sans doute celui qui fut accueilli avec le plus de considération. Quant aux trois autres, on peut dire qu’ils se sont imposés à la critique à des degrés divers, Milorad Pavić ayant toutefois fait une entrée fracassante sur la scène littéraire française en provoquant un véritable coup médiatique.
4. L’une des « figures contemporaines » de la littérature européenne :
Danilo Kiš
Parmi les auteurs serbes publiés en français dans les années 80, Danilo Kiš occupe une place majeure. La preuve en est, non seulement le nombre important de ses livres traduits dans cette période, mais aussi l’accueil que leur a réservé la critique ; accueil qui confirme que l’œuvre de « Prince Danilo », pour employer l’expression de Raymond Jean, a été « sentie », lue et interprétée en France d’une façon plutôt convenable. Cela dit, il faut nuancer quelque peu cette constatation, car l’œuvre de cet écrivain – considéré aujourd’hui comme l’une des plus importantes « figures contemporaines » de la littérature européenne(9) – a mis un certain temps pour gagner la confiance de la critique, et pour obtenir, finalement, la place sur la scène littéraire que lui valent ses grandes qualités esthétiques.
La première présentation de l’écrivain au public français n’a d’ailleurs pas été très encourageante. La preuve en est le silence qui a, pendant de nombreuses années, entouré Jardin, cendre et son auteur ; silence qui ne sera brisé qu’avec les publications d’Un tombeau pour Boris Davidovitch, en 1979, et du Sablier, trois ans plus tard, qui ont finalement sorti Danilo Kiš de l’ombre de l’anonymat. Comme jadis en ex-Yougoslavie, Un tombeau pour Boris Davidovitch a suscité un vif intérêt de la critique française, très surprise par la « vérité monstrueuse » de son univers littéraire, par « son style de rapporteur d’assises »,(10) ainsi que par la « beauté froide » de son écriture. Les effets directs d’une telle écriture sont parfois insoutenables, note, par exemple, Laurand Kovacs en précisant pourtant que c’est justement « cette impitoyable vision » de l’auteur « qui en fait sa puissance »(11). Avec cet accueil élogieux, Un tombeau pour Boris Davidovitch n’a pas pu non plus passer inaperçu dans les milieux qui s’occupent des prix littéraires : quelques mois après la parution de ce livre, Danilo Kiš sera récompensé « pour l’ensemble de son œuvre » par le «Grand Aigle d’Or» de la ville de Nice.
Si Un tombeau pour Boris Davidovitch est, pour la critique française, une belle surprise, la révélation d’un talent, Sablier a été accueilli avec un enthousiasme et une confiance que l’on réserve seulement aux œuvres des écrivains déjà confirmés. En effet, saisis par l’authenticité de ce roman inclassable, par la force énigmatique qui s’en dégage, les critiques français ne lui ont pas ménagé leur intérêt. Ainsi, par exemple, Jean Vincent Richard écrit avec exaltation que Sablier est « plus qu’une date », « plus qu’un chef-d’œuvre », c’est à dire : « un chef-d’œuvre et demi » !(12) La particularité de ce roman, d’après Alain Bosquet(13), vient d’abord d’une innovation introduite dans la littérature universelle par Danilo Kiš. A savoir, la réconciliation, voire l’interpénétration de deux conceptions littéraires considérées longtemps comme incompatibles : « L’avant-garde qui redéfinit l’écriture et le témoignage sur les horreurs de notre temps ». La deuxième particularité de ce livre hors du commun c’est – toujours selon le même auteur – sa construction originale, basée sur la psychanalyse et le post-cubisme, et tournée « vers une architecture non euclidienne ». Bien sûr, poursuit Bosquet, cette construction novatrice et complexe rend difficile l’accès au roman. Mais, d’un autre côté, elle dégage « le pouvoir de la parole » qui peut « hypnotiser, séduire, jeter le lecteur dans un émoi supérieur » !
Après un accueil si chaleureux réservé aussi bien au Sablier qu’à Un tombeau pour Boris Davidovitch, une chose est devenue évidente : Danilo Kiš s’impose de plus en plus comme une référence incontournable dès qu’il s’agit des lettres slaves ou celles venues d’Europe centrale. Le prestige de l’écrivain sera d’ailleurs encore renforcé par le succès de l’Encyclopédie des morts, publiée en 1985. A titre d’exemple, citons l’opinion d’Yves Laplace qui traduit bien l’engouement suscité par ce recueil de nouvelles. « Dans le désordre des titres » qui ont marqué la production de cette année, ce critique voit ce livre, ni plus ni moins, comme « un minéral d’une autre planète », comme « une sorte de pierre philosophale » !(14) L’Encyclopédie des morts, fut malheureusement le dernier livre de Danilo Kiš publié en version originale de son vivant. La longue maladie de l’écrivain et le silence inquiétant qui suivirent la parution de son dernier ouvrage n’ont pas pour autant découragé la traductrice Pascale Delpech de sortir, en 1989, quelques mois seulement avant la mort de Kiš, la traduction de son premier roman – La Mansarde – qui rencontra, à son tour, un accueil favorable dans la presse.(15)
Les articles que nous avons évoqués jusqu’à présent sont, pour la plupart, les comptes rendus, les réactions immédiates sur les livres de Kiš à l’occasion de leur parution. Mais l’œuvre de cet écrivain a également inspiré un certain nombre de textes critiques, plus approfondis, qui s’attachent à analyser, d’une manière appropriée, ses différents aspects esthétiques(16). Ces textes sont orientés plutôt vers les problèmes internes de la poétique kišienne et leur analyse porte sur les personnages et leur fonctionnement, sur les questions de style, sur les techniques narratives, sur la vision du monde de l’écrivain, ou encore sur la question du contexte dans lequel se situe l’écrivain serbe(17).
Evoquons en particulier cette dernière question. Pour essayer de définir « la famille littéraire » de Danilo Kiš, les critiques l’ont mis en parallèle à une multitude d’écrivains appartenant à des concepts littéraires différents et à des sphères culturelles très diverses. Ainsi, par exemple, à son propos, on a évoqué Rabelais et Hasek, Breton et Broch, Koestler et Nabokov, Cocteau et Gombrowicz, Bataille et Kafka, Perec et Philip Roth et ainsi de suite. Bien sûr, le nom le plus cité – et pour cause – a été celui de Borges. Mais chose curieuse : on n’a pas forcement parlé de Kiš comme d’un simple disciple du grand maître mystificateur. Au contraire, consciente de la particularité de son écriture, la critique a présenté le romancier serbe comme une sorte de « guide » de la Bibliothèque de Babel ; mais, un guide pas du tout comme les autres, qui, en fait, montre « les zones d’ombre » de cet immense univers borgesien, pour l’éclairer avec sa propre oeuvre, pour lui apporter quelque chose de nouveau et d’authentique.
D’autre part, la critique a souvent évoqué une certaine parenté entre Kiš et le Nouveau Roman français. Certaines analyses plus approfondies, comme celle faite par Joël Roussie(18), démontrent, cependant, que cette « parenté » est plus complexe que cela pourrait paraître à première vue. Enfin, un certain nombre de critiques, à l’instar de Norbert Czarny(19), a insisté sur l’appartenance du romancier serbe à un type de littérature propre à l’Europe centrale, né avec Herman Broch et Robert Musil.
Après avoir fait ce rapide tour d’horizon, on peut conclure que définir « la famille littéraire » de Danilo Kiš n’est pas une entreprise facile. De toute façon, le contexte évoqué par la critique française, contexte qui suit un mouvement de l’Europe centrale au « pays de Borges », en passant par la France, serait encore plus complet et, certainement plus juste, si la critique avait eu l’idée d’examiner l’œuvre kišienne par rapport à son contexte le plus proche : celui de sa langue maternelle et des lettres serbes et « yougo-slaves ».
La réussite de Danilo Kiš en France, réussite qui apparaît clairement surtout par rapport à l’accueil modeste réservé à la plupart de ses confrères serbes, pourrait s’expliquer, sans doute en partie, par l’intérêt que suscitent en France les sujets traités dans ses livres. En d’autres termes, l’œuvre de Kiš – construite autour du destin de l’homme dans la tourmente historique provoquée par le nazisme et le stalinisme – a trouvé dans ce pays un « horizon d’attente » favorable. Mais, cela n’était pas en tous cas la raison principale. L’intérêt que la critique française a porté aux livres de Danilo Kiš – nommé déjà en 1986 en France « Chevalier des Arts et Lettres » – est avant tout l’expression d’une volonté qui consiste à mettre en valeur les qualités esthétiques d’une écriture singulière et d’une œuvre jugée importante au niveau européen.
5. Succès et infortune d’Aleksandar Tišma
Avec Ivo Andrić et Danilo Kiš, Aleksandar Tišma fait partie du trio littéraire serbe le plus traduit en France : dix de ses livres, romans et nouvelles, ont été publiés dans ce pays depuis 1981. Mais bien qu’il soit presque autant traduit que ses deux compatriotes, il ne peut pourtant pas rivaliser avec eux quant à l’accueil qu’on leur a fait en France. Certes, il faut le préciser : tous les livres de Tišma n’ont pas subi le même sort. Certains d’entre eux, il est vrai, sont passés sous un silence quasi total, alors que d’autres ont rencontré un intérêt modéré.
Quant à L’usage de l’homme (1985), le maître-livre de cet écrivain, il a été, en revanche, accueilli d’une façon tout à fait convenable : avec l’attention et l’enthousiasme qu’on réserve seulement aux chefs-d’œuvre. En fait, après avoir manqué le rendez-vous avec l’École d’impiété, traduit en 1981, les critiques se sont littéralement précipités pour saluer ce roman et pour rendre hommage à son auteur. Bouleversés par les images violentes d’un monde infernal mais ô combien réel, profondément émus par la force intérieure du livre – cette force que l’on ressent seulement au contact des vraies œuvres d’art – ils n’ont pas caché leur émotion. C’est un « livre douloureux, livre précieux. Horrible. » constate le critique de la NRF.(20) Tišma « ne raconte pas ; il ne décrit pas, il nous rend témoins – inutiles – de la violence publique ou du désespoir intime, jusqu’à une limite rarement atteinte dans la fiction », écrit, de son côté, le critique du Monde avant d’être emporté par une vague de fortes émotions : « C’est insoutenable ! Allez-y voir quand même. C’est un grand livre ! »(21) D’autres chroniqueurs, troublés eux aussi par la lecture de L’usage de l’homme, n’ont pas non plus respecté le langage stéréotypé du compte rendu. Celui qui va le plus loin, cependant, est le critique du Matin qui, enchanté, fait une proposition peu habituelle. « Si les Nobel cherchent un successeur à Ivo Andric », propose-t-il, « nous leur suggérons le nom de Tisma, ils ne seront pas déçus » !(22)
Avec cet accueil fort enthousiaste, on aurait pu croire que Tišma aurait désormais auprès de la critique française, sinon un statut privilégié, du moins un traitement à la hauteur de ses qualités littéraires. Cependant, cette prévision ne s’est pas réalisée. Même les romans sortis peu de temps après, Croyances et méfiances (1987) et le Kapo (1989), n’ont pas rencontré l’intérêt attendu. Certes, Le Livre de Blam, paru en 1986, a profité d’une certaine manière de l’atmosphère favorable, née autour du chef-d’œuvre de Tišma. Mais, bien qu’ils aient été encore sous la forte impression de la lecture de L’usage de l’homme, les critiques se sont, cette fois-ci, montrés plus modérés dans leurs commentaires. Bref, s’il fallait présenter l’accueil réservé aux livres d’Aleksandar Tišma d’une manière graphique, on pourrait utiliser l’image d’une ligne descendante, image en quelque sorte de déjà-vu. Car cette attitude de la critique à l’égard de cet écrivain n’est nullement une exception, au contraire : l’accueil réservé aux livres de Šćepanović et Selimović en est la preuve, aussi bien que le cas de Miloš Crnjanski qui mérite également d’être examiné attentivement.
6. Sous le signe du « hasard comédien » : Miloš Crnjanski
Bien qu’il soit considéré par les slavisants français comme l’auteur d’ « une grande œuvre romanesque », et « l’un des plus grands stylistes serbes contemporains », Miloš Crnjanski est resté presque inconnu en Hexagone de son vivant. Comme si le « hasard comédien », pour utiliser sa propre métaphore, avait aussi joué avec son œuvre : malgré la parution, en 1970, du Journal de Tcharnoïevitch, cet écrivain à la destinée littéraire unique n’a suscité qu’après sa mort un véritable intérêt en France. Heureusement, ce malentendu, pour ne pas dire cette injustice, a été en partie corrigé par le grand succès qui a accompagné ultérieurement son livre majeur, Migrations, traduit en 1986.
Quelles sont les raisons d’une telle attitude à l’égard de Crnjanski ? Parmi plusieurs suppositions, l’une d’elles s’impose comme la plus probable. Crnjanski, aujourd’hui adulé presque unanimement dans son pays, n’y a pas eu non plus, à l’époque, le traitement qu’il méritait. Alors qu’il était exilé à Londres (de 1940 à 1965), on s’empressait de l’oublier dans la Yougoslavie communiste et ceci joua aussi sur l’accueil qu’on lui fit à l’étranger. Mais, quelles qu’en soient les raisons, nous sommes forcés de constater l’ironie du sort, ironie du « hasard comédien » : le premier texte sérieux sur l’œuvre de Crnjanski à paraître dans un périodique français, sera justement publié à l’occasion de sa mort.(23) Ce texte d’une rare perspicacité fut cependant une voix solitaire et attardée dans le silence qui entoura la publication du Journal de Tcharnoïevitch.
Ce silence difficile à justifier ne sera, enfin, interrompu que quelques années plus tard par l’accueil particulièrement chaleureux réservé à Migrations. Les grands quotidiens nationaux, les hebdomadaires réputés et les revues littéraires de renom ont cette fois réagi presque immédiatement. La belle saga de Crnjanski, imprégnée d’une poésie nostalgique et d’un mystère métaphysique insaisissable, n’a laissé personne indifférent. En voici la preuve à travers ces expressions de sympathie sans réserve. C’est « l’un des trésors de la littérature de l’Europe centrale », écrit le Magazine littéraire(24) ; « un admirable, un superbe livre, d’une inactualité très actuelle », ajoute Le Figaro(25). Le Nouvel Observateur, de son côté, cite les mots élogieux du cinéaste serbe Aleksandar Popović qui voit dans ce roman non seulement « l’ouvrage le plus important de la littérature serbe », mais également « l’un des plus forts du siècle, de la taille du Maître et Marguerite de Boulgakov ».(26) Le chroniqueur de L’Express, enchanté, va encore plus loin. Pour lui, c’est « le plus beau roman du monde, un livre inoubliable de grandeur... » !(27) Ce succès auprès de la critique n’est pas resté, bien entendu, sans effets. Ainsi, en 1986, Migrations est récompensé par le Prix du meilleur livre étranger et sélectionné parmi les meilleurs livres de l’année dans la revue Lire.
Certaines des caractéristiques littéraires de Migrations, particulièrement sa large vision romanesque englobant les temps, les espaces et les peuples en mouvement, mais aussi sa dimension métaphysique marquée par une sensibilité spécifiquement slave, ont poussé les critiques à comparer ce livre aux grands romans russes. A propos de Migrations, on a notamment mis en parallèle son auteur et Léon Tolstoï. Evoquons à ce sujet l’opinion de Gilles Lapouge qui trouve le point commun entre ces deux auteurs – appartenant « à cette race d’écrivains qui ne donnent leur mesure que dans des romans sans mesure » – dans leur intention de marier « les destins individuels et les fureurs de l’histoire ».(28)
Suite à ce réel succès de Migrations, on aurait pu espérer que Crnjanski, – contrairement à ses héros égarés en Russie, contrairement aussi à ses confrères serbes ignorés en Hexagone – avait trouvé en France, pays des immigrés, sa Terre Promise. Ou, du moins, qu’il y avait rencontré une terre d’accueil qui allait ouvrir sa porte à ses autres livres. Mais, il s’est vite avéré qu’un tel espoir était sans lendemain. En fait, seul le Roman de Londres (1992), le dernier chef-d’œuvre de l’écrivain, a réussi à susciter un peu plus d’intérêt, mais pas autant qu’on aurait pu le souhaiter. Manque de sens de la part des critiques français ou simple « hasard comédien » ? Quoi qu’il en soit, le cas de Crnjanski confirme une fois de plus que la découverte d’un écrivain serbe en France, même si elle est accompagnée de manifestations enthousiastes, ne lui garantit pas forcément un meilleur avenir.
7. L’esprit cartésien face à un « maître de la voltige » byzantin :
Milorad Pavić
Nous avons déjà parlé de l’enthousiasme avec lequel la critique a accueilli plusieurs livres des écrivains serbes. Mais jamais une œuvre venant d’ex-Yougoslavie n’a rencontré en France un accueil qui aurait pu rivaliser avec celui qui a été fait au Dictionnaire khazar de Milorad Pavić. Nous sommes en 1988. Le Dictionnaire khazar vient juste de sortir et il provoque un véritable coup médiatique en France et dans les pays francophones. Peu de livres, y compris ceux venant des « grandes » littératures, peuvent se vanter d’un tel accueil. Non seulement les grands quotidiens et les prestigieuses revues littéraires mais aussi les nombreux journaux provinciaux lui ont immédiatement exprimé leur sympathie sans réserves, parfois sur un ton exalté qui frise la fascination. « Stupéfiant »,« époustouflant », « étrange », « inclassable », « fabuleux », « prodigieux » ... voici quelques-uns des adjectifs qui ont été les plus employés dans les articles accompagnant la parution de ce roman. Citons seulement quelques opinions typiques. C’est « le livre le plus étrange du monde », annonce L’Événement du jeudi(29) ; « le premier livre du XXIe siècle » et « le premier grand trou noir de la littérature à venir », souligne de son côté Paris Match(30). Enfin, pour le Magazine littéraire(31), Le Dictionnaire khazar est « un monstre magnifique », « un fabuleux recueil de contes et de rêves » qui « ne se propose rien de moins que de recréer le monde » !
D’où est venu cet intérêt inattendu pour un écrivain jusqu'alors complètement inconnu en France ? La principale raison du grand succès du Dictionnaire khazar réside, en fait, dans le livre lui-même. Son attraction provocatrice qui a largement séduit les critiques français est avant tout liée à la magie littéraire de ce roman et à sa force esthétique intérieure, nées toutes les deux d'une démarche originale et novatrice. Bien sûr, devant une telle nouveauté, devant « un continent de mots », comme le dit un critique, certains commentateurs se sont sentis littéralement démunis. C'est le cas, par exemple, de Jean Contrucci, qui a franchement reconnu sa frustration : « Il y a longtemps que je n'ai pas été étonné, séduit, bousculé, enlevé, fasciné par un livre comme je viens de l'être par Le Dictionnaire khazar… c'est un dictionnaire diabolique, qui vous piège et ne vous lâche plus, écrit par un diable d'auteur. »(32)
La plupart des critiques français se sont cependant montrés plus vigilants que leur confrère. Ne cachant pas non plus leur surprise, mais gardant une certaine méfiance, ils ont renoncé à s'engager dans une analyse piégeuse tout en recourant à une sorte de mystification. Ainsi, André Clavel met d'abord en garde ses lecteurs – « Attention, danger ! » – avant de décrire Le Dictionnaire khazar comme « un objet imprimé parfaitement non identifié », ressemblant aux « mirages qui naissent du néant ».(33) Cette tendance à la mystification est perceptible également dans les articles publiés dans Le Matin et dans L'Hebdo : le premier décrit le roman de Pavić comme « un livre aux pouvoirs étranges »(34) tandis que le second le compare à « une immense machine à fabriquer des rêves », soulignant surtout « sa dangereuse magie ».(35)
Après ce grand coup médiatique du Dictionnaire Khazar, une chose semble devenue évidente. A savoir qu’un avenir prometteur devait être réservé en France également aux autres livres de Milorad Pavić. De toute façon, c’était la conviction de son éditeur qui, dans les années suivantes, publia encore cinq livres du même auteur, dont deux romans et trois recueils de nouvelles. Un avenir prometteur ? Si l’on se réfère à l’accueil réservé en France aux deux derniers livres de Pavić – Le Rideau de fer (1994) et Les Chevaux de Saint-Marc (1995) – on pourrait plutôt dire que l’avenir ne lui a pas été si favorable, en tout cas pas autant qu’on aurait pu le supposer. Quant au Paysage peint avec du thé (1990), il a, lui, suscité un certain intérêt. Le fait que ce roman ait été présenté peu après le succès fulgurant du Dictionnaire khazar, a sans doute exercé une certaine influence sur sa réception. En sachant d’avance à quel genre de littérature il fallait s’attendre, les critiques se sont cette fois, semble-t-il, mieux préparés à affronter les jeux imprévisibles de cet écrivain-mystificateur. De même, tout en saluant ce nouvel exploit du romancier, ils ont modéré leur discours, quoiqu’on puisse toujours trouver dans leurs commentaires des réactions enchantées comme, celle du Monde(36) : c’est « un roman fou, fou, fou qui dynamite situation et personnages ».(37)
Contrairement au romancier, le Pavić-nouvelliste n’a pas eu en France, comme nous l’avons déjà remarqué, un grand succès. En fait, le seul Lévrier russe (1991) a réussi à se faire remarquer par la critique. A propos de Pavić-nouvelliste, notons juste quelques réflexions d’Alain Bosquet, infatigable lecteur du « maître de la voltige » byzantin. Dans son sixième texte écrit sur Pavić (!), Bosquet exprime une fois de plus son admiration pour cet écrivain qui trouve toujours de nouveaux moyens pour nous amener là où il n’y a plus de frontière entre « ce qui est et ce qui s’invente ». « Démystificateur et mystificateur à la fois », conclut-il avec délectation, « Milorad Pavic est un orfèvre hors pair ».(38)
Si ces réflexions de Bosquet sont justifiées, pourquoi alors les deux derniers recueils de nouvelles de l’écrivain – Rideau de fer et aux Chevaux de Saint-Marc – n’ont-ils pas plus attiré l’attention de la critique française ? Il y a, nous semble-t-il, au moins une raison à cette prise de distance. En fait, il est possible que la rumeur répandue par certains journalistes, selon laquelle Pavić serait tombé dans les pièges du nationalisme serbe, ait exercé une influence négative sur la critique, devenue très réceptive à ce genre de dérives.(39) Cette rumeur, bien qu’elle soit sujette à caution, a donc, sinon causé au moins renforcé la réticence de la critique vis-à-vis de l’écrivain. Et cela au point qu’Alain Bosquet s’est vu obligé de prendre sa défense.(40) Tout en fustigeant l’hypocrisie des faux humanistes qui se méfient de tout « ce qui vient de Serbie », il a souligné avec la conviction d’un complice qu’il s’agit de « l’un des quatre ou cinq écrivains d’Europe les plus marquants et les plus originaux » ; un écrivain qui a « choisi la littérature de l’imaginaire » plutôt « que l’engagement immédiat et à court terme ». De ce fait, conclut-il, Milorad Pavić mérite plutôt d’être célébré. (Voir aussi : la version élargie de cet article.)
----------------------------------
Notes
(1) Citons à ce propos Richard Garzarolli : « Le bruit court que la Yougoslavie engendre, depuis quelques années, une multitude d’écrivains géniaux », dit-il avant de constater : « mais les traducteurs sont rares, et le monde de l’édition française ne montre guère d’enthousiasme pour une région d’Europe vouée, semble-t-il, aux seuls touristes. C’est bien regrettable. » Tribune - Matin, 29 septembre 1975.
(2) Jean-Louis KUFFER : « Quatre-vingt pages fulgurantes », Magazine littéraire, novembre 1975, n° 106.
(3) Georges NIVAT : « La Bouche pleine de terre », Journal de Genève, 17 janvier 1976.
(4) Guy DENIS : « Mon Goncourt », Notre temps (Bruxelles), 27 novembre 1975.
(5) NIVAT : Op. cit.
(6) « Mesa Selimovic : Le Derviche et la Mort », La Nouvelle Revue Française, octobre 1978, n° 309, p. 142-145.
(7) Auguste RICH : « Le Derviche et la Mort par Mesa Selimovic », La Gazette du lecteur, janvier 1978.
(8) E. REICHMANN : « Le derviche et le commissaire » Le Monde, 14 octobre 1997.
(9) Voir : Anik Benoit-Dusausoy et Guy Fontaine / Lettres européennes. Histoire de la littérature européenne. Paris, Hachette, 1992, p. 995-996.
(10) Bruno DE LATOUR : « Un tombeau pour Boris Davidovitch par Danilo Kis », Le Journal, 20 mars 1980.
(11) Laurand KOVACS : « Danilo Kiš : Un tombeau pour Boris Davidovitch », La NRF, février 1980, p. 145-147.
(12) Jean Vincent RICHARD : « Un procès-verbal de l’holocauste », Les Nouvelles littéraires, 6 mai 1982, p. 51.
(13) Alain BOSQUET « Un art poétique de la persécution », Magazine littéraire, n° 183, avril 1982, p. 58.
(14) Yves LAPLACE : « Encyclopédie des morts », 24 heures de Lausanne, 30 octobre 1985.
(15) Danilo Kiš est décédé le 15 octobre 1989. Sa disparition précoce a suscité de nombreuses réactions en France qui ont également jeté un peu plus de lumière sur sa personnalité et sur l’identité de l’homme et de l’écrivain. Voir en particulier : « Pour Danilo Kiš », édition spéciale dédiée à la mémoire de Danilo Kiš, Est-Ouest international, n° 3, octobre 1992, p. 7-177.
(16) A ce propos il convient de noter que deux revues ont consacré à cet écrivain les larges blocs thématiques : Sud (1986) et Atelier du roman (1996) Une importante contribution à l’analyse de l’œuvre kišienne représentent également les actes du colloque organisé à l’Université de Bordeaux III et publiés sous le titre Temps de l’histoire (2003). Voir la rubrique Bibliographie : « Danilo Kiš ».
(17) Parmi ces textes citons en particulier les suivants : « Les morts impossibles » de G. Mouillaud-Fraisse, « Danilo Kis », d’Edmund White, et « Introduction à Danilo Kiš » de Guy Scarpetta. Voir la rubrique Bibliographie : le chapitre indiqué plus haut.
(18) « Jardin, cendre : approche détournée », Sud, p. 71-77.
(19) Les Nouveaux Cahiers, n° 5, 1983-1984, p. 56-80.
(20) Laurand KOVACS : « Alexandre Tisma : L’usage de l’homme », La NRF, n° 396, janvier 1986, p. 110.
(21) Nicole ZAND : « Le hurlement silencieux d’Alexandre Tisma », Le Monde, 18 octobre 1985, p. 19.
(22) Antoine SPIRE : « Tisma maître du réalisme », Le Matin, 1er octobre 1985, p. 25.
(23) Il s’agit de l’essai de Laurand Kovacs : « In memoriam / Miloš Crnjanski », La NRF, mai 1978, p. 154-157.
(24) Sophie FOLTZ : « Le hasard comédien », Magazine littéraire, n° 236, décembre 1988, p. 58.
(25) Bruno DE CESSOLE : « La symphonie pathétique de Tsernianski », Le Figaro, 24 novembre 1986.
(26) Frédéric VITOUX : « L’impossible Serbie », Le Nouvel Observateur, 5 décembre 1986.
(27) Anne PONS : « Les enfants de la mère Serbie », L’Express, du 7 au 13 novembre 1986.
(28) Gilles. LAPOUGE : « Destins individuels et fureurs de l’Histoire », La Quinzaine littéraire, 1er janvier 1987.
(29) A(ndré) C(LAVEL) : « Pavic l'illusionniste », L'Evénement du jeudi, 5 au 11 mars 1992.
(30) Philippe TRETIACK : « Enfin un roman qu'on peut lire dans tous les sens ! », Paris Match, 17 mars 1988.
(31) Evelyne PIEILLER : « Bizarres Khazars », Magazine littéraire, avril 1988.
(32) Jean CONTRUCCI : « Milorad Pavic : les Khazars, quel bazar ! », Le Provençal, 27 mars 1988.
(33) André CLAVEL : « Le livre à bricoler soi-même », Journal de Genève, 26 mars 1988.
(34) Christophe GALLAZ : « La beauté séculaire du Khazar », Le Matin (Lausanne), 18 mars 1988.
(35) Isabelle RÜF : « Les Khazars, sel de la terre », L'Hebdo, 30 mars 1988.
(36) Nicole ZAND : « Des remords pour l’été », Le Monde, 27 juillet 1990.
(37) A propos de ce « roman fou », il est intéressant de noter aussi l’opinion d’André Clavel qui se distingue de toutes les autres par son jugement très sévère. Dépassé par la construction de Paysage, médusé par son canevas qui, selon lui, va « au-delà du tolérable », Clavel a ouvertement manifesté son désarroi. Soulignant que « la littérature doit être un jeu » et non « un casse-tête », il a qualifié ce roman de « particulièrement chinois » et d’« assommant ». Voir : « Quésaquo ?», L’Événement du jeudi, 1er février 1990.
(38) Alain BOSQUET : « La transfusion des souvenirs », Le Figaro, 23 novembre 1995.
(39) Citons à ce sujet deux articles : celui de Jean-Baptiste Harang qui avoue avoir été «surpris», lors de sa rencontre avec l’écrivain, « par son nationalisme serbe exacerbé » (Libération) ; et celui de Daniel Martin qui informa les lecteurs de La Montagne que Pavić « milite auprès des nationalistes ».
(40) A. BOSQUET : « Milorad Pavic, de Serbie et de partout », Le Quotidien de Paris, 16 juin 1994.
M. S.
>Les années de contestation et d'affirmation (1991-2000)
|