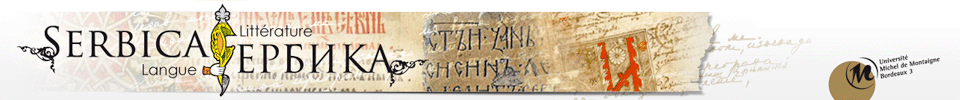– Premier article –
J’ai récemment étudié ici même l'évolution générale de la nation serbe depuis son origine jusqu'à sa renaissance politique[1]. Cette renaissance politique coïncide avec une renaissance intellectuelle. Les deux principaux personnages de cette restauration ont été l'archimandrite historien Raïtch et le moine polygraphe Dosithée Obradovitch, dont la Serbie a fêté récemment le centenaire. Je voudrais, en me fondant sur les intéressantes recherches de M. Jovan Skerlitch[2], mettre en lumière les figures absolument inconnues chez nous de ces deux précurseurs.
I. Jean Raïtch

Jovan Rajić (1726-1801)
Jovan (autrement dit Jean) Raïtch était né en 1726 dans la ville de Karlovtsi[3], qui a joué un certain rôle dans l'histoire des Slaves méridionaux. Elle est encore aujourd'hui le séjour du patriarche orthodoxe des Serbes d'Autriche. Sous son nom allemand de Karlowitz elle est connue de nos historiens par un traité de paix conclu en 1699 entre l'Empereur et la Porte. Elle a été en 1848 le foyer le plus actif de la résistance de la nation serbe contre les Magyars.
Le père du futur historien était un simple marchand de bestiaux. Il envoya son fils fort jeune à l'école. L'enfant fit de si rapides progrès que lorsqu'il fut arrivé à sa onzième année, son maître le prit comme adjoint. Tout en aidant à instruire ses jeunes camarades, Jovan fréquentait l'école latine slave, où l'enseignement se donnait soit en latin, soit d'après des manuels russes dont la langue, très voisine du slavon d'église[4], était aisément comprise des jeunes Serbes. A l'âge de dix-huit ans, Raïtch quitta Karlovtsi pour aller se perfectionner d'abord chez les Jésuites de Komorn, où il passa quatre années, ensuite à l'école protestante de Soprony (Pressbourg). Mais la Russie l'attirait. Faute de ressources pour payer les frais d'un long voyage, il fit le trajet à pied. En 1753 il arriva à Kiev, il y resta trois ans occupé à étudier la théologie orthodoxe, poussa jusqu'à Moscou et à Smolensk. Rentré dans sa ville natale, où il rapportait une foule de manuscrits, il sollicita une place au séminaire. Mais sa candidature fut écartée par des moines jaloux de son savoir. Il retourna à Kiev, d'où il gagna la Moldavie, Constantinople et la péninsule du Mont Athos, où il résida deux mois au monastère serbe de Khilandar. En voyageant ainsi, ce clericas vagans n'a pas seulement pour objet de voir du pays ; il se propose surtout de réunir des documents historiques pour ses travaux futurs. A Khilandar il trouva des coffres pleins de vieux manuscrits. Mais les moines, aussi bornés qu'ignorants, ne lui permirent pas de les examiner et il ne put que copier en cachette quelques documents. Dans ce monastère célèbre il se rencontra avec Paisii[5], qui devait être le père de l'historiographie bulgare, de même que Raïtch est le père de l'historiographie serbe.
Il quitta le Mont Athos en octobre 1758, traversa la péninsule Balkanique, par Seres, Nich, Belgrade, revint à Karlovtsi ; son voyage avait duré dix-sept mois. En 1759 il fut nommé directeur de l'école de l'Intercession (nom du monastère auquel elle appartenait) et chargé d'enseigner la géographie et la rhétorique. Tout en professant, il mettait en ordre les matériaux qu'il avait recueillis pour son histoire des Slaves méridionaux.
En 1762 il quitta Karlovtsi pour aller vivre à Temesvar, puis à Novi Sad[6], le centre des Serbes de Hongrie, où il professa la théologie. En 1772 il se fit moine au monastère de Kovil et devint en très peu de temps hégoumène et archimandrite.
Désormais sa carrière errante est finie. Il peut se livrer tout entier à ses travaux historiques. Le synode de l'église orthodoxe lui confie le soin de rédiger un nouveau catéchisme, qui est resté en usage jusqu'en 1870, pour remplacer celui qui avait été envoyé de Vienne et qui était suspect de tendances catholiques. Il traduit un recueil de sermons russes. On lui offre à diverses reprises un évêché qu'il refuse ; les honneurs viennent à lui de tous les côtés. Lors du concile de Temesvar, l'Empereur lui envoie une croix précieuse, et quelque temps après Catherine II un médaillon d'or avec son portrait.
Il mourut le 11 décembre 1801 et sa mort fut pleurée comme celle d'un génie national.
Au cours de sa vie agitée il avait beaucoup écrit ; mais, comme il n'y avait pas d'imprimerie dans les pays serbes, il avait dû éditer ses volumes à Venise, à Vienne, à Pressbourg, à Bude. Outre les seize ouvrages qui ont été imprimés de son vivant, il en a laissé de nombreux en manuscrit. Nous n'avons pas à nous occuper ici de ses œuvres théologiques ; elles sont écrites dans cette langue slavonne-russe que les Serbes avaient adoptée comme langue littéraire, et qui au fond était pour les Slaves orthodoxes ce que le latin était pour les peuples catholiques.
Raïtch n'est pas seulement théologien et historien, il se fait poète à l'occasion. Sous ce titre : Lutte du dragon contre les aigles, il chante les guerres des Autrichiens et des Russes contre les Turcs ; il les chante dans la langue populaire avec un fâcheux abus d'allusions mythologiques. Evidemment son poème ne s'adressait pas au même public que les chants des gouslars[7].
Malgré l'inexpérience de l'écrivain et la lourdeur du style, ce poème, publié pour la première fois en 1791 à Vienne, a été réimprimé deux fois pendant le XIXe siècle, en 1839 à Belgrade et en 1883 à Pantchevo. On peut citer parmi les œuvres poétiques de Raïtch un drame sur la mort du tsar serbe Ouroch V. C'est une tragédie de collège sur laquelle il n'y a pas lieu d'insister.
Ce qu'il y a de plus intéressant parmi les écrits de Raïtch, ce sont ses travaux historiques, et le plus important c'est l'ouvrage intitulé : Histoire des divers peuples slaves, notamment des Bulgares, des Croates et des Serbes. La première édition en quatre volumes parut à Vienne en 1794. L'année suivante le premier volume fut réimprimé à Saint-Pétersbourg. Mais la censure impériale, très facile à effaroucher, interdit la publication des suivants. Une seconde édition de l'ouvrage intégral a été donnée à Bude en 1823. La langue de l'ouvrage est un mélange, qui nous paraît aujourd'hui fort désagréable, de slavon, de russe et de serbe. Ce macaronisme lui assurait des lecteurs tout à la fois chez les Slaves riverains du Danube et chez les Slaves des bords de la Neva.
Dès l'année 1768 Raïtch avait achevé cet ouvrage à Karlovtsi, et le manuscrit primitif portait sur le titre que l'auteur avait arraché à l'oubli l'histoire de ces nations et qu'il l'avait rédigée en sa langue maternelle (singulière illusion !).
La publication de 1793 fut bien accueillie du public. Le premier volume eut 611 souscripteurs, ce qui était pour l'époque un chiffre considérable. L'auteur met à profit des textes jusqu'alors fort peu connus. C'est d'abord la Chronique de Georges Brankovitch[8]. Raïtch reproduit littéralement de nombreux extraits de cette chronique qu'il avait trouvée dans la bibliothèque du patriarche de Karlovtsi. Il se sert aussi des textes qu'il a recueillis avec tant de peine durant son séjour au Mont Athos. Il connaît les vies des rois serbes rédigées au quatorzième siècle par l'archevêque Daniel, mais il ignore la plupart des textes qui sont aujourd'hui classiques, les vies d'Etienne dit le Premier Couronné, de saint Sava, de Domentian, de Constantin le Philosophe, de Tsamblak, et l'ouvrage du moine bulgare Paisii dont je parlais tout à l'heure.
Il ne connaît qu'une rédaction incomplète du code de Douchan. Il cite un certain nombre de chroniques byzantines et d'érudits étrangers, notamment le Ragusain Banduri, l'auteur de l’Imperiam orientale[9], Mavro Orbini, Charles Dufresne, des historiens hongrois et russes. Mais il a des distractions et des ignorances singulières. Il dédouble Mavro Orbini en deux personnages, Orbini et Mavro Orbini[10] ; il ne le connaît évidemment que par la traduction russe et ne sait en quelle langue est écrit l'original.
Il cite Du Cange sous le nom de Dufresne et le prend pour un historien dalmate. Evidemment dans sa vie errante il n'avait pas eu le temps de prendre des notes avec beaucoup de soin et la bibliothèque qu'il avait sous la main à Karlovtsi n'offrait pas toutes les ressources désirables ; d'autre part, il écrivait dans un pays et à une époque où la censure était fort ombrageuse. On rencontre plus d'une fois sous sa plume des formules telles que celle-ci : « Ce n'est pas notre affaire d'approfondir la question et il n'est pas à propos de faire trop de recherches à ce sujet et de vouloir pénétrer des secrets d'Etat. »
Raïtch est un moine très croyant ; il raconte gravement comment saint Sava ressuscita le tsar de Serbie Etienne, dit le Premier Couronné ; il donne sérieusement le nombre de Serbes qui émigrèrent en Hongrie sous la conduite du patriarche Arsène IV conformément au chiffre que le patriarche avait vu en rêve.
En revanche, il a une haute idée de son rôle d'historien. Le grand malheur de ses compatriotes, c'est que leur histoire a été jusqu'ici écrite par leurs ennemis, qui n'ont eu qu'une idée, celle de décrier et d'humilier la nation serbe. Il veut relever cette nation à ses propres yeux, l'aider à reprendre la place qu'elle occupait naguère dans l'Orient de l'Europe. Il atteignit ce résultat. En dehors de la seconde édition (de 1823) à laquelle j'ai fait tout à l'heure allusion, l'ouvrage servit de base à un certain nombre de manuels publiés en 1801 à Bude, en 1845 à Bucarest, en 1835 et en 1847 à Belgrade. Jusque vers 1860 il resta la lecture préférée de tous ceux qui voulaient connaître les anciennes annales de la nation serbe. A dater de cette époque une école plus critique est apparue, et nous avons donné ici même les résultats de ses recherches[11].
* * *
– Deuxième article –
II. Dosithée Obradovitch

Dositej Obradović (1739-1811)
En donnant une histoire au peuple serbe, Raïtch avait en quelque sorte renoué la tradition nationale. Mais cette histoire était encore écrite dans une langue exotique, artificielle, qui n'était pas l'idiome serbe. Ce fut Dosithée Obradovitch qui éleva le serbe à la dignité d'idiome littéraire.
Lui aussi il était moine, lui aussi il fut un clericus vagans et il mena une vie des plus aventureuses. Il était né en 1742 ou 1743 à Tchakovo, une bourgade moitié serbe moitié roumaine du Banat de Temesvar, dans le royaume de Hongrie.
Orphelin à l'âge de dix ans, il se trouva absolument isolé dans sa ville natale, et, comme il nous le dit lui-même dans ses Mémoires, il eut le sentiment qu'il était désormais étranger dans son propre pays.
Il avait de bonne heure fréquenté l'école et, comme il montrait de remarquables dispositions, on décida qu'il embrasserait la carrière ecclésiastique. Il dévorait les vies des saints, rêvait, comme jadis notre Bernardin de Saint -Pierre, de devenir ermite dans quelque solitude. Vers l'âge de treize ou quatorze ans il fit la rencontre d'un moine mendiant et imagina de s'attacher à lui pour s'en aller en Turquie. Ces fantaisies n'étaient pas du goût d'un sévère tuteur qui, pour changer les idées de son neveu et l'arracher à ses lectures, s'empressa de l'envoyer à Temesvar en qualité d'apprenti tapissier. Mais la vocation persistait. Un jour le jeune tapissier reçut la visite d'un compagnon qui lui raconta les merveilles et les beautés des monastères de la Frouchka Gora. Dosithée ne put se contenir ; il s'enfuit de chez son patron, et un beau jour, le 31 juillet 1757, il alla frapper à la porte du monastère de Khopovo dans la Sainte Montagne.
Nous devons dire ici quelques mots de cette Frouchka Gora qui joue un rôle si considérable dans la vie intellectuelle et religieuse de la nation serbe. Son nom est fait pour nous intéresser particulièrement. Il veut dire la Montagne des Francs. Cette région fut en effet occupée au neuvième siècle par des tribus franques.
La Montagne des Francs s'allonge de l'ouest à l'est au sud de la Drave, en Slavonie, sur une longueur de plus de cent kilomètres entre les villes de Vukovar et de Slan Kamen. Le sommet le plus élevé atteint la hauteur de 537 mètres. C'est sur les lianes de cette montagne que mûrissent les vignes de Syrmie, orgueil du vignoble croate. A dater du quinzième siècle elle a vu s'ériger à l'ombre de ses forets treize monastères serbes qui ont servi de refuge aux religieux du rite orthodoxe fuyant la patrie serbe envahie par les Musulmans ; les bibliothèques et les sacristies de ces couvents abritent de riches trésors de livres, de manuscrits et d'objets d'art religieux. Celui de Vrdnik conserve les restes du tsar Lazare supplicié par les Turcs après le désastre de Kosovo en 1389.
Le jeune Dosithée fut bien accueilli au monastère de Khopovo. L'hégoumène mit à sa disposition la bibliothèque. Il tomba sur les Vies des saints du mois de mai. « Lire des Vies des saints ! De si grands livres tels qu'il n'y en a nulle part dans le monde ! Avec quelle ardeur je lisais tout cela ! »[12]
L'hégoumène fut si content de son pupille qu'il le chargea de faire la lecture au réfectoire. Le jeune néophyte remplissait auprès de lui le rôle de famulus et, comme le ménage de la cellule était bientôt fait, il pouvait se donner tout entier à sa passion pour les livres.
A force de méditer les vies des saints, il résolut de les imiter, et à l'âge de seize ans il reçut la tonsure. Il prit le nom de Dosithée en l'honneur d'un saint de la primitive Eglise, qui avait fui sa famille et avait embrassé la vie monastique. Cette vie, le jeune moine la menait avec une ferveur d'ascétisme qui épouvantait le sage hégoumène. Il jeûnait des trois jours de suite et il rêvait d'entreprendre un jeûne de quarante jours à l'exemple de Moïse, d'Elie et de Notre-Seigneur. Son hégoumène le rappela à des sentiments de sagesse et d'humilité en lui faisant remarquer qu'il n'était capable ni de marcher sur l'eau, ni de ressusciter les morts, et le menaça de le renvoyer. Peu de temps après, l’hégoumène mena son jeune néophyte à Karlovtsi, où il reçut le diaconat des mains de l'évêque Nenadovitch : « Souviens-toi de ma prédiction, dit l'évêque au prélat. Ce jeune homme aime trop la lecture : il ne restera pas longtemps à Khopovo. »
Rentré au monastère, le nouveau diacre se plongea de nouveau dans la lecture et dans les exercices ascétiques. Il passait pour un saint ; des malades venaient implorer de lui leur guérison : « Je croyais tout ce que je lisais, dit-il dans ses Mémoires, comme les Turcs croient les derviches. » L'hégoumène l'observait avec une sollicitude qui n'était pas exempte de quelque scepticisme : « Je crains bien, disait-il, que cette sainteté ne dure pas longtemps. »
II disait vrai. Un beau jour le diacre s'aperçut qu'il existait des livres laïques, des livres d'histoire en langue russe. Un jeune prêtre lui parla de la langue latine. Ce fut toute une révélation. Quis ? quid ? quomodo ? ubi ? ubivis ? ubicumque ? Ces mots magiques résonnaient sans cesse dans l'oreille de Dosithée et hantaient son cerveau. C'était pour lui « la musique des sirènes ».
Mais personne ne savait le latin à Khopovo. Du jour où le néophyte eut fait cette lamentable découverte, le monastère perdit tout son charme. Pouvait-on vivre dans un endroit où il n'y avait point de latin ? Son hégoumène rêvait de l'envoyer au fameux monastère de Kiev, mais les ressources lui manquaient.
Cet excellent homme mourut au printemps de l'année 1760. Sa mort rompit le dernier lien qui attachait le jeune homme au monastère de Khopovo. Les moines, jaloux de la supériorité de leur jeune confrère, lui rendaient la vie intolérable. Le 2 novembre 1760, Dosilhée quitta cette maison qui lui avait été si chère, et en compagnie d'un diacre de ses amis il se rendit à Agram.
D'un milieu serbe et orthodoxe il était brusquement transporté dans un milieu croate et catholique. La langue populaire était presque la même, mais l'alphabet latin, combiné avec une orthographe très compliquée, se substituait à l'alphabet cyrillique ou gréco-slave. D'autre part les Serbes que Dosithée eut l'occasion de rencontrer n'étaient plus catholiques mais uniates, et s'efforcèrent – inutilement d'ailleurs – d'attirer le pèlerin dans leur Eglise.
A ce moment-là l'Autriche était en guerre avec la Prusse et Dosithée songea à s'engager comme aumônier militaire. Mais il ne réalisa pas cette idée ; il apprit un peu de latin à Agram et se rendit dans un monastère serbe de la Dalmatie auquel était annexée une école. Il y enseigna pendant trois ans, rétribué le plus souvent en nature (froment, huile, fromage). Il apprit un peu d'italien, réalisa quelques économies qui lui permirent d'entreprendre de nouveaux voyages. Il était en route pour le Mont-Athos quand il fut retenu par la maladie dans un monastère du Monténégro, non loin de Cattaro. Il y fut ordonné prêtre le 11 avril 1764. Au cours de l'année suivante nous le trouvons à Kosovo, non loin de Knin. C'est là qu'il commença à écrire dans sa langue maternelle, le serbe vulgaire. Il traduisit pour la fille d'un de ses confrères quelques sermons de saint Jean Chrysostome.
C'était la première fois qu'on avait l'occasion de lire les textes sacrés dans la langue populaire. L'innovation eut un grand succès et de nombreuses copies du manuscrit circulèrent dans les régions environnantes. Etonné et charmé de ce résultat qu'il n'avait pas prévu, Dosithée se résolut à écrire désormais dans cette langue populaire jusqu'alors si négligée. Il passa trois années fort heureuses en Dalmatie. Plus tard, lorsqu'il lut Télémaque et qu'il y trouva la description des félicités de la vie rustique, il se plaisait à l'appliquer au souvenir de son séjour dans cette province.
Il poussa aussi en Bosnie, où il eut occasion d'exercer parmi les Serbes orthodoxes les fonctions de son ministère et de recevoir notamment les fidèles en confession. Il fait un éloge enthousiaste de ses pénitents :
On ne peut voir nulle part des gens aussi bons. Ils n'avaient aucun péché à me raconter, sauf qu'ils avaient parfois, le mercredi et le vendredi, – jours de maigre, – mangé une écrevisse ou des haricots à l'huile, ou qu'ils avaient juré après des chèvres égarées. Parmi ces saints pécheurs, je passai le carême et célébrai la Pâque. Ensuite je gagnai Trogir (Trau), puis Spalato et je m'embarquai pour Corfou.
Sur la tartane qui l'emporte, le voyageur n'a pour compagnons de route que des Grecs, et il ne peut communiquer avec eux que grâce au peu d'italien qu'il a appris en Dalmalie. Il s'étonne de la rapidité avec laquelle ils parlent entre eux : « Jamais je ne pourrais apprendre une pareille langue ; c'est menu, menu au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ... Je me demandais comment ils se comprenaient entre eux. »
II devait pourtant l'apprendre, cette langue mystérieuse, ainsi que nous verrons plus loin. Il prit ses premières leçons dès son arrivée à Corfou.
Il gagne Nauplie et de Nauplie le Mont-Athos, où il passe l'automne et l'hiver de l'année 1760. Il ne rencontre point dans ce sanctuaire la vie idéale qu'il avait rêvée. Les moines serbes et bulgares passent leur temps à se disputer le monastère. Du Mont-Athos il se rend à Smyrne où il trouve une généreuse hospitalité dans un couvent hellénique et en une année il fait de tels progrès en langue grecque qu'il est en état de lire les classiques. Il se loue en termes enthousiastes de l'hospitalité smyrniote et porte aux nues la science de son maître, le prêtre Hiérothée , « un homme divin , un nouveau Socrate ».
Il résida trois ans à Smyrne et en conserva un excellent souvenir. Il l'appelle « sa chère ville dorée, une ville où il a cueilli des fleurs qui ont parfumé sa vie et son cœur, où il a sucé le lait de l'éloquence attique et savouré le miel de la poésie homérique ». Dans ce temps-là Slaves et Grecs n'étaient pas encore arrivés à la vie politique, à la création d'Etats, à la constitution de nationalités indépendantes et il n'existait pas entre eux ces conflits qui les ont fréquemment divisés dans ces dernières années. A propos de ce séjour à Smyrne, Dosithée a écrit dans ses Mémoires des pages qui mériteraient d'être connues de tous ceux qu'intéresse la renaissance hellénique au dix-huitième siècle.
Dosithée était possédé par la passion de l'étude. Il profita d'un séjour de quelques mois en Epire pour apprendre l'albanais. Au commencement de l'année 1769 il s'embarqua à Corfou et se rendit à Venise, d'où il passa en Dalmatie. Il vécut dans cette province en donnant des leçons et en remplissant pour les orthodoxes ses fonctions ecclésiastiques : il eut l'occasion d'étudier les mœurs et la langue de ses compatriotes dalmates et commença à composer de petits livres pour la jeunesse. Sa véritable vocation littéraire date de ce séjour en Dalmatie.
Il resta à Zara jusqu'en 1771. Son séjour dans cette province exerça une très heureuse influence sur le reste de sa carrière. Il entra en contact intime avec le peuple serbo-croate et se fit également estimer par les orthodoxes et par les catholiques. Il rapporte lui-même avec une joie naïve combien ses auditeurs serbes étaient fiers d'entendre louer ses sermons par les prêtres catholiques.
Ainsi, dans ses voyages, Dosithée avait appris le grec et l'albanais. L'albanais ne devait pas lui servir à grand-chose, mais la connaissance du grec lui fut d'un grand secours. De Zara il se rendit à Vienne pour apprendre l'allemand. Il y passa six années qui, dit-il, lui parurent six journées. Grâce à sa connaissance parfaite du grec, il obtint une situation de précepteur dans la famille d'un riche marchand et organisa des cours privés qui comptèrent jusqu'à douze élèves. L'argent que lui rapportaient ses leçons, il l'employait à payer des maîtres qui lui enseignaient le latin et le français. Le professeur de latin lui apprenait en outre, dans cette langue, la logique et la métaphysique.
Obradovitch nous fait de la vie viennoise une peinture idyllique. L'Augarten, le Prater, Schönbrunn l'enchantent tour à tour et il exalte le charme de la promenade à pied avec un enthousiasme qui ravirait nos modernes amateurs de footing. Sobre et réservé dans ses plaisirs, il ne se croit pas tenu par son caractère ecclésiastique de renoncer à la vie mondaine, aux redoutes, à l'opéra italien, à l'académie, aux concerts. Il se mêle si bien à la vie viennoise, il apprend si bien l'allemand qu'il devient capable de donner des leçons en cette langue.
Pendant la septième année de son séjour à Vienne, il reçoit la visite d'un prélat serbe qui l'emmène à Modra (c'est un bourg slovaque du comitat de Presbourg) pour faire l'éducation de ses deux neveux. Tout en leur enseignant l'allemand, le français et l'italien, il étudie la philosophie de Baumeister, qui était alors fort à la mode. Il profite de son séjour en Hongrie pour aller saluer son pays natal qu'il n'avait pas revu depuis vingt années, « saluer la tombe de ses parents et baiser cette terre sacrée où reposent leurs restes ».
Ce clericus vagans de mœurs très chastes est d'ailleurs le tempérament le moins ecclésiastique qu'on puisse imaginer. Dans la langue serbe qu'il bégaye le premier, il introduit la terminologie philosophique du dix-huitième siècle. Il abuse, comme tous ses contemporains, des mots sensible, sensibilité, et, comme la langue serbe ne les lui fournissait pas, il les emprunte sans hésiter à la langue russe. Il rencontre dans son pays natal une compatriote victime d'une banale mésaventure. Elle s'est mariée, elle a eu deux enfants, puis un beau jour son mari a disparu et l'a abandonnée. Elle ne peut se remarier, l'Eglise ne le permet pas. Et Obradovitch s'indigne et il s'écrie dans un style que Voltaire ou Rousseau n'eût point désavoué :
О hommes, que faites-vous dans ce monde ? Jusques à quand des ermites et des moines feront-ils la loi pour l'Eglise ? J'ai vu à Constantinople et à Smyrne, j'ai vu de mes yeux comment l'Eglise et le patriarche, pour un prétexte beaucoup moins grave, permettent aux femmes d'épouser un second mari. N'est-ce pas agir contre la volonté de Dieu, par conséquent contre toute loi sensée, que d'empêcher des êtres de se reproduire en louant Dieu ? Mais, dira-t-on, si le premier mari revient ? S'il revient, il y a un remède bien simple : qu'il prenne une autre femme et qu'il la garde mieux que la première. Mais s'il ne revient pas, quel remède pouvez-vous trouver ?
L'Eglise orthodoxe n'admet pas les quatrièmes noces ; l'esprit philosophique d'Obradovitch s'emporte contre cette interdiction tyrannique :
Voilà une femme de trente ans, jeune et belle à merveille ; son troisième mari est mort et elle ne peut plus se remarier. Est-ce sa faute si elle a perdu trois maris ? Et ce mari ! est-ce sa faute si ses trois femmes ne sont plus en vie ? Sont-ils les maîtres de la vie et de la mort ? Mais, dira-t-on, les Saints Pères ont établi cette loi. Les Saints Pères qui l'ont établie étaient des moines, des ermites, ennemis jurés du mariage et de la procréation ; s'ils ne s'étaient pas mêlés des affaires qui ne les regardent pas, ils auraient beaucoup mieux fait. Le mariage, c'est l'affaire des laïques, des chefs civils qui, eux, sont non seulement en paroles, mais en réalité, les Saints Pères. Qui est pour moi le père le plus saint, sinon celui qui m'a engendré et nourri ? S'il ne s'était point marié, s'il ne m'avait point procréé avec ma chère mère, je ne serais pas de ce monde, et des millions de Saints Pères ne me serviraient de rien. Ce ne sont ni les jeûnes ni les prières qui font naître les enfants, mais le saint mariage, voulu de Dieu. . .
J'ai entretenu de cette question notre défunt métropolitain Vincent. Voici ce qu'il m'a répondu : « Je sais bien ce qui en est. Mais la responsabilité remonte à ceux qui ont fait ces lois. Nous devons les suivre aveuglément. » Mais à quoi bon suivre une loi quand on sent qu'elle est absurde ? Malheur à une société qui n'est capable d’aucune amélioration.
Voilà un langage qui sent quelque peu le fagot.
Le moine philosophe s'était imaginé que l'archevêque l'enverrait en Allemagne avec ses élèves ; mais ses espérances ne se réalisèrent pas. A l'automne de l'année 1779, il se rendit à Trieste, où il rencontra de riches négociants serbes qui lui confièrent l'éducation de leurs enfants. Dans cette ville, il rencontra aussi un archimandrite russe qui l'emmena avec lui en Italie. Puis il gagna Chios et Constantinople, et ensuite Galatz et Iassy. Partout il trouva le moyen de vivre comme maître de langues. En trois ans, il avait économisé trois cents ducats. Il s'adjoignit à des marchands qui allaient en Allemagne, traversa la Galicie, une partie de la Silésie et, par Leipzig, arriva à Halle. « Là, dit-il, je dépouillai l'habit ecclésiastique et je revêtis les habits pécheurs des laïques. » Et il se mit à étudier la philosophie, l'esthétique et la théologie naturelle chez le plus illustre philosophe de l'Allemagne, Eberhard. Il s'enthousiasme au souvenir du temps passé « dans ce sanctuaire de la science et des Muses ». Il reporte sa pensée « vers cette barbare Albanie », vers ces régions qui lui sont si chères : la Serbie, la Bosnie et l'Herzégovine :
Je soupirais et je versais souvent des larmes en me disant : Quand, dans ces beaux pays, aurons-nous autant d'écoles ? Quand notre jeunesse pourra-t-elle s'enivrer de pareilles sciences ? Nous sommes des millions ! Les Turcs ne sont instruits que par des derviches et les chrétiens par des moines. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre ? Ils ne savent que cette formule : « Fais l'aumône ! Donne tout ce que tu as ! Et meurs de faim ! Déteste et maudis tous les hommes qui ne sont pas de ta religion. » En voyant tous les livres que chaque jour on publie dans ce pays, j'étais pénétré de chagrin quand je pensais comme chez nous on crie : Apporte-nous des livres de Russie. Et alors, je me rappelais qu'en Dalmatie j'avais eu l'idée d'écrire des livres pour mon peuple.
Sous l'influence de ces idées, il se rend à Leipzig, où il y avait une Université comme à Halle et, ce qui était le plus important, une imprimerie pourvue de caractères slaves. Tout en suivant des cours de physique, il imprime un petit volume intitulé : Vie et aventures de Dmitri Obradovitch, appelé dans la vie monastique Dosithée, écrit et publié par lui-même (Leipzig, 1783).
En publiant ce livre, dit-il, je poursuivais un double but. Je voulais d'abord faire voir l'inutilité des monastères dans la société ; en second lieu, démontrer la grande utilité de la science, qui est le seul moyen d'arracher les hommes à la superstition et de les amener à la véritable religion, à la vertu consciente.
L'année suivante, il fit paraître un petit ouvrage de morale pratique intitulé : Conseils de la saine raison, ouvrage qui fut réimprimé à Pest en 1866, et une traduction d'un sermon allemand du prédicateur Zollikofer.
Après trois années passées dans les deux villes universitaires, il se résolut à visiter la France et l'Angleterre. Il n'avait, pour entreprendre ce voyage, qu'une réserve de quatre-vingt-cinq ducats ; « mais, dit-il, je n'avais été ni le premier ni le dernier à parcourir ces pays à pied ». Il gagne Paris par Strasbourg et Nancy, et avoue ingénument qu'en traversant la Champagne, il n'a bu que le vin du pays. Il reste trois semaines à Paris, qui l'enchante. Pour le décrire, il lui faudrait, dit-il, au moins dix feuilles d'impression. Il y renonce et recommande simplement à son lecteur d'apprendre le français et d'acheter un livre intitulé : Description de Paris et de Versailles, où il trouvera la relation de tout ce que ses yeux ont vu. Ce qu'il a surtout admiré, c'est la merveilleuse beauté de Marie-Antoinette, c'est le Louvre, qui peut passer pour une des sept merveilles du monde.
La moitié de ce palais est assignée à une bibliothèque et à l'Académie. Quel pays que celui où les rois livrent leur palais aux livres, à la sagesse, aux sciences, et considèrent comme un grand honneur d'habiter avec les Muses !
De Paris il se rend à Calais, en passant par Cambrai où il va saluer le tombeau de Fénelon. Le 1er décembre 1784, il débarque à Douvres. L'Angleterre l'enthousiasme. Ce qu'il admire particulièrement, c'est la beauté des femmes ; mais il est très offusqué de ne pas comprendre un seul mot d'anglais et il s'indigne contre les malencontreux constructeurs de la Tour de Babel. Grâce à la souplesse de son tempérament, à la sympathie qu'il inspire, il réussit bientôt à se faire des amis parmi les Anglais et parmi les représentants de la colonie grecque, où il rencontre une Chypriote appartenant à la famille historique des Lusignan. Il trouve à donner des leçons et à vivoter. Il quitte Londres le 2 y mai, après avoir lié de cordiales relations avec un certain nombre de familles anglaises, et se rend à Hambourg, d'où il regagne Vienne ; il vit de nouveau dans cette capitale en donnant des leçons d'italien et de français.
Pendant un séjour à Leipzig, il reçoit un message inattendu de son compatriote le Serbe Zoritch, l'un des amants de Catherine II[13], qu'elle avait élevé au titre de comte et au rang de général. Après le premier partage de la Pologne, elle lui avait donné un domaine considérable, celui de Schklov, dans le gouvernement actuel de Mogilev (ou Mohilev). Dans ce domaine, Zoritch menait une vie princière, entouré d'une cour nombreuse. Il entretenait un théâtre où l'on jouait l'opéra français et le ballet italien. Il avait fondé une école militaire, où deux cents jeunes gens étaient élevés à ses frais. Il avait déjà appelé auprès de lui un autre Serbe, Emmanuel Iankovitch.
Pour fixer auprès de lui Obradovitch, le général lui promettait de fonder à Schklov une imprimerie serbe, où il pourrait imprimer ses ouvrages. A la fin de l'année 1787, le moine errant se rendit à l'appel de son compatriote. Mais Zoritch – auquel l'argent faisait souvent défaut – ne tint pas sa promesse, et il le quitta pour se rendre en Allemagne, par Königsberg et Berlin. Au courant de l'année 1788, nous le retrouvons à Leipzig, où il fait imprimer un recueil de fables, traduites de diverses langues, et une ode sur la prise de Belgrade, enlevée par Loudon aux Turcs (1789)[14].
Le dernier chapitre des Mémoires d'Obradovitch est daté de Leipzig, 1er janvier 1789. Mais il devait survivre encore de longues années et nous pouvons restituer aisément le reste de sa carrière. Nous savons qu'il vécut à Vienne, comme professeur libre, de 1789 à 1802. L'argent qu'il gagnait à donner des leçons, il le gaspillait à imprimer des livres qui ne se vendaient guère : Recueil de choses édifiantes (Vienne, 1793), Interprétation des Évangiles des Dimanches (Venise, 1803).
En 1802, il se transporta à Trieste. Dans cette ville existait une colonie de riches négociants serbes qui s'offraient à lui constituer une pension à condition d'écrire des livres pour l'éducation du peuple serbe.
En 1804 éclata, chez les Serbes de Turquie, l'insurrection dont Karageorges était le chef. Obradovitch n'y prit pas une part directe. Sa robe et son âge ne lui permettaient pas de porter les armes. Mais il se mit tout entier au service de ses compatriotes, rassembla des souscriptions en leur faveur et fit imprimer à Venise une Ode sur l'insurrection des Serbiens (Serbianom), dédiée à leur chef, Georges Petrovitch : « Lève-toi, Serbie, notre mère chérie ; redeviens ce que tu étais naguère ; tu as longtemps dormi… Réveille-toi. »
Ses vœux s'adressaient à tout l'ensemble des pays serbes, à la Bosnie, sœur de la Serbie, dit le poète, à l'Herzégovine, au Monténégro, aux îles de l'Adriatique.
Dosithée Obradoviich était né sujet autrichien et, en plusieurs endroits de ses Mémoires, il fait preuve d'un loyalisme incontestable ; mais il se sent encore plus Serbe qu'Autrichien. – « Le sang n'est pas de l'eau, » dit un proverbe de sa nation. – Il rêve de mettre au service de la nouvelle patrie serbe tout ce qu'il se sent encore d'énergie. Au commencement de l'année 1800, il entre en relation avec le vladika ou prince-évêque du Monténégro, et il lui propose d'aller s'établir dans la principauté pour respirer l'air salubre de la liberté. Il rêve aussi de fonder une école et une petite imprimerie. Le vladika ne répondit point à ses avances.
Dans le courant de juin 1806, il quitte définitivement Trieste pour aller vivre en Serbie. Il descend la Save, le Danube, et gagne Smederevo (Semendria) où, pour la première fois de sa vie, il met le pied sur le sol de la Serbie délivrée ; il entre au service du gouvernement de Karageorges, qui le charge de missions à Bucarest et à Semlin. A dater de la fin de l'année 1807, il s'établit définitivement à Belgrade. Il fonde dans cette ville la Haute Ecole, d'où est sortie l'Université de Belgrade, et il compte parmi ses premiers élèves Vouk Karadjitch et un fils de Karageorges. Il organisa également un séminaire pour les théologiens. Au début de l'année 1811, Karageorges le nomme membre du Conseil d'Etat et directeur de l'Instruction publique. Il rêvait de fonder une imprimerie dont la première publication eût été un volume de ses œuvres. Quelques jours avant sa mort il écrivait : « Mon corps s'affaiblit, mais mon âme voudrait toujours du nouveau. » Mais ses jours étaient comptés. Il s'éteignit le 28 mai 1811. Sur sa modeste fortune il laissait une somme de deux cents ducats à son bourg natal de Tchakovo, pour l'entretien d'une école. Sa bibliothèque a formé le premier noyau de la Bibliothèque de Belgrade.
Dosithée Obradovitch ne fut assurément pas un homme de génie ; mais la postérité lui doit le respect et la reconnaissance qui sont dus aux initiateurs. Ses Mémoires présentent la partie la plus curieuse de ses œuvres ; ils se lisent encore aujourd'hui avec un vif intérêt ; la langue en est quelquefois embarrassée de russismes, mais elle est, en somme, vive, pittoresque et naturelle. Il ne prétendait pas écrire des œuvres originales ; dans son imitation des fables d'Esope, dans ses œuvres morales ou théologiques, traduites ou imitées de modèles étrangers, il voulut avant tout être utile à son peuple et il y a réussi. Il voulut être, et fut vraiment, le premier éducateur de la nation serbe, et la postérité ne séparera pas son nom de celui de ce Karageorges, qui en fut le premier libérateur.
NOTES :
[1] Journal des Savants, cahier de février 1909.
[2] Srpska Knijevnost u XVIII veku (La littérature serbe au dix-huitième siècle), Belgrade, Imprimerie royale, 1909.
[3] Karlovtsi, aujourd'hui située dans la Syrmie, ne doit pas être confondue avec la ville croate de Karlovac (Karlstadt), qui appartient à la Croatie.
[4] Le slavon d'église russe a subi une forte influence de la langue russe vulgaire, qui diffère beaucoup du serbe proprement dit.
[5] J'ai donné quelques détails sur Paisii dans La Bulgarie (pages 52-59).
[6] Novi Sad, en allemand Neu-Satz, en magyar Ujvidek. Le mot veut dire « la nouvelle résidence ».
[7] Rapsodes populaires qui chantent en s'accompagnant de la gousla ou guzla.
[8] Despote serbe qui vivait au XVIIe siècle et mourut en 1711, prisonnier de l'Autriche, à Eger en Bohême.
[9] Banduri vécut longtemps à Paris, fut bibliothécaire du duc d'Orléans et membre de l'Académie des Inscriptions.
[10] Orbini (Mavro ou Mauro), écrivain dalmate, auteur d'un livre intitulé : II regno degli Slavi (Pesaro, 1600).
[11] Voir Journal des Savants, février 1909.
[12] Dosithée, Mémoires.
[13] Voir sur Zoritch le volume de M. Waliszewski, Autour d'un trône : Catherine II, ses collaborateurs, ses amis, ses favoris (Librairie Pion).
[14] Belgrade devait être reprise par les Turcs deux ans après.
|