|
Mihajlo Pantić * : Zemun se situe sur la rive droite du Danube à quelques kilomètres en amont du Kalemegdan et de la confluence d’avec la Save ; vieille de centaines d’années, cette ville fut construite sur une colline dans les entrailles forestières de laquelle les pêcheurs du Danube creusèrent leurs premières habitations, les zemunice (habitations souterraines, d’où le toponyme). Après la signature de la paix de Belgrade en 1739, la frontière entre les empires ottoman et austro-hongrois fut définitivement fixée sur le Danube ; Zemun, en tant que milieu multiethnique où habitaient des Serbes, des Allemands, des Croates, des Juifs, devint une place frontalière de premier plan qui abritait le siège de certaines administrations de l’État (quarantaine, douane, capitainerie portuaire). Dans la seconde moitié du XXe siècle, et avec l’essor de Belgrade, Zemun perdit de son importance stratégique et devint l’une des communes composant la capitale. Avant qu’il parte s’établir au Canada au début des années 1990, grandit et vécut des dizaines d’années à Zemun David Albahari, l’un des prosateurs parmi les plus importants de la littérature serbe contemporaine, mon ami écrivain, traducteur, essayiste et directeur de collection. L’interrogeant sur l’influence que l’espace où il a grandi a exercée sur son art, je lui demande s’il garde le souvenir des premiers instants où il a senti l’espace réel de sa ville passer dans ses textes…
David Albahari : Je suis arrivé à Zemun de Ćuprije en 1954. Je venais d’entrer à l’école élémentaire, nous avions déménagé vers le milieu de l’automne. Ćuprija est restée pour moi l’endroit paradisiaque où s’est déroulée ma petite enfance ; mon premier amour, mon premier chien, mes premiers cauchemars nocturnes, ma première lecture d’un livre – tout cela est survenu là-bas. Par rapport à Ćuprija, Zemun m’a fait l’effet d’une grande ville féérique même si elle était nettement plus petite que Belgrade. (Zemun était alors une ville en soi et non la banlieue de Belgrade.) Les autobus, les trolleybus, le magnifique bâtiment du Foyer de l’armée de l’air, le Danube gonflé de ses eaux, grandiose, face auquel la Morava avait des airs domestiques. Du paradis, j’ai fait mes premiers pas dans le monde…

Zemun
J’ai grandi dans une maison où le livre occupait la place d’honneur. Mon père et ma mère nourrissait mon amour pour la lecture. Les cadeaux d’anniversaire se faisaient toujours sous forme de livres et rien d’autre. Mon père nous achetait, à ma sœur et à moi, chaque nouvelle parution des collections pour la jeunesse comme « Lastavica » de Sarajevo ; et notre maison regorgeait des éditions d’avant-guerre publiées par « Zlatna knjiga » et « Kadok ». Nous étions abonnés au magazine pour enfants Zmaj, et j’envoyais régulièrement mes « premiers travaux » aux concours qui étaient organisés. Aujourd’hui encore j’ai quelque part des diplômes encadrés ainsi que les livres de Branko Ćopić et de Mira Alečković qui m’ont alors été remis. J’en suis particulièrement fier car ces livres sont dédicacés. Mais je me suis vraiment engagé sur la voie de l’écriture quand j’étais au lycée, quand mes horizons littéraires ont commencé à s’élargir. C’est alors qu’a débuté mon obsession pour William Faulkner qui a perduré de longues années (elle se perçoit surtout dans les nouvelles de Nepažljivom proroku [Le Prophète inattentif, la seconde partie de Porodično vreme – Le Temps familial]. Par ailleurs, je voulais après le lycée faire des études de biologie, mais je n’ai pas été retenu ; et je me suis inscrit après coup en section Anglais et littérature à l’École normale supérieure, un hasard qui aura scellé mon destin. Je me suis alors mis à l’écriture sérieusement, mais moins de nouvelles que de poèmes. J’avais les cheveux longs et je me sentais rebelle. Les années 1960 touchaient à leur fin. Je ne savais rien du fonctionnement du monde littéraire, mais il s’est trouvé que mon père connaissait quelqu’un d’un peu au courant, et je me suis un jour présenté à la rédaction du magazine Mladost avec un paquet de nouvelles et de poèmes. La période suivante, sans doute cruciale pour moi, est celle où je fréquente assidument Raša Livada – Raša que je connaissais depuis l’enfance car nous habitions le même quartier – qui était alors très apprécié et tenu pour l’étoile montante dans le firmament poétique serbe.

Branko Ćopić
►Te souviens-tu du moment où tu as écrit ton premier travail littéraire ? Quand, et comment, t’es-tu réellement mis à l’écriture ? Peux-tu définir aujourd’hui, et par degré d’importance, les circonstances de ton existence, les éléments, qui ont pesé pour que tu deviennes écrivain et, qui plus est, l’écrivain que tu es ? Tu es le chantre le plus tenace de la concision poétique de la littérature serbe. Malgré ton passage au roman, tu continues de te considérer d’abord comme nouvelliste. Pourquoi, aujourd’hui, la concision, et pourquoi la nouvelle ?
♦ Si on inclut mes premières velléités enfantines, j’ai écrit mon premier poème en première ou en deuxième classe de l’école élémentaire. Un poème sur Bambi que… hélas… je n’ai pas conservé. Vu que, dès l’enfance, je dévorais les livres, je me suis sans cesse essayé à l’écriture : poèmes, petites histoires, romans d’aventures… Pendant mes études, je me voyais en poète (amoureux transi, éternel incompris, etc.) et vers la fin des années 1960, j’ai publié mes premiers poèmes et textes « sérieux ». Sans avoir autant lu, probablement que je n’aurais jamais rien écrit. C’est, à tout le moins, l’impression que j’ai aujourd’hui. Je désirais simplement faire ce que faisaient mes écrivains préférés, créer un monde composé de mots tout aussi réel que celui qui nous entoure et peut-être, qui sait, plus réel encore.
Pour ce qui est des éléments déterminants, je l’ai dit, la lecture aura constitué l’influence majeure, celle qui persiste aujourd’hui encore. Même de nos jours, la lecture d’un livre qui me transporte m’insuffle aussitôt l’envie d’écrire. Je répète que je vivais dans une famille où on vouait un immense respect au livre, où « C’est dit là ou là » coupait court à toute discussion. Le livre faisait autorité, et mes parents le maximum pour que nous soyons entourés de livres. Je devrais ajouter la sensation d’être seul ou à l’écart, une sensation que je ne peux ni ne veux interpréter, mais qui s’est en vérité avérée mon principal moteur et m’a conduit vers la solitude de l’écriture. Par la suite sont venues des décisions conscientes, et le choix d’écrire une prose qui, j’en suis pleinement convaincu, correspondait le mieux à l’époque où je vivais.
La concision est pour moi l’une des manières peu nombreuses de préserver la langue de l’usure, et la nouvelle réellement le signe de notre temps. Depuis toujours je maintiens que tout peut s’écrire dans une histoire courte et que si un sujet ne peut s’y inscrire, il ne faut pas non plus s’y consacrer dans un roman. Ou, pour m’exprimer différemment, je dirais qu’un roman se lit pour avoir la confirmation de notre compréhension de la structure du monde, et une nouvelle pour découvrir ne serait-ce que les contours de cette structure. La nouvelle éclaire, le roman éduque. En un mot, je chante la concision mais pas dans le but d’attaquer la prolixité. L’une et l’autre sont indispensables. Par conséquent, d’abord un éclair pour entrevoir, puis une lumière uniforme de longue tentative de compréhension.
► Quand j’étais adolescent, ce qui correspond à la fin des années 1960 et au début des années 1970, le temps de ta maturité, je me souviens que dans le cadre d’une grande et longue enquête, le célèbre journaliste de Politika Zira Adamović avait posé une question, une seule, aux écrivains et autres artistes : Qu’est-ce qui vous a marqué de manière décisive, et pourquoi ? Que répondrais-tu, toi ?
♦ Quatre événements du début des années 1970 m’apparaissent aujourd’hui décisifs. Le premier, l’amitié qui m’unissait à Raša Livada, l’une de ces amitiés qui voient le monde – littéraire et, plus généralement, la réalité – se déconstruire sans cesse. Ensemble nous traduisions, échangions sur ce que nous avions composé, passions des heures et des heures en conversations prenantes sur la littérature et sur l’art, mais le plus important était que lors de ces discussions tous deux étions dévoués à la forme, ce qui, à mon sens, est demeuré la caractéristique principale de la poésie de Livada et de ma prose. Autre élément déterminant, la rencontre de Petar Vujičić, l’entrée dans son petit appartement magique rue Laza Paču où, comme dans l’Alef de Borges, se déversait le cosmos littéraire tout entier. Piotr, comme tout le monde l’appelait, m’a donné un véritable conseil après lecture de mes premières nouvelles (j’avais à ma manière tenté d’imaginer des gens et des événements insolites au possible) : écrire sur ce que je connaissais vraiment, ma famille et l’existence qui était celle des miens. À cette époque, c’est d’un œil très différent que je voyais ma famille, que je me voyais moi, que je voyais la ville où j’habitais, et j’ai alors compris comment, à partir de la réalité du monde se bâtissait la Yoknapatawpha de Faulkner. Zemun est alors devenue le théâtre de mes récits, mais pas tant une scène de théâtre qu’un nouveau membre de la famille, un participant égal en droits dans le jeu littéraire. Un jeu dont le sérieux, me concernant, s’est fait ces années-là toujours plus grand, surtout après qu’Aleksandar Tišma eut fait paraître ma première nouvelle dans Letopis Matice srpske. Ma collaboration avec Tišma – qui a débouché sur la publication de mon premier recueil de nouvelles puis, quelques années plus tard, celle de mon premier roman fragmentaire – représente mon troisième point d’appui à cette époque. Ses incitations mesurées et ses suggestions critiques furent un soutien précieux, indispensable, pour un jeune écrivain qui cherchait à donner forme à la première phase de création de son expression en prose. De ce point de vue, et c’est la quatrième influence décisive qui s’est exercée sur le façonnement de mon regard littéraire sur le monde, mon activité dans le domaine du cinéma aura joué un rôle non moins déterminant.
|
Raša Livada
|
Aleksandar Tišma
|
Un concours de circonstances a voulu qu’à cette période, je passe presque deux ans dans l’équipe du cinéaste Puriša Đorđević (qui filmait alors pour la télévision la série Od svakog sam volela [De chacun de ceux que j’aimais] avec, pour charge, différentes tâches administratives et cinématographiques. Observer à proximité immédiate le processus de la naissance d’un film et, en particulier, son montage m’ont conforté dans l’opinion que le monde de la prose est composé de fragments et qu’au final, l’effet produit naît du jeu auquel ils se livrent. Travailler dans l’équipe de Puriša m’a montré qu’une œuvre artistique voit le jour dans un processus de déconstruction, qu’une œuvre artistique ne réside pas dans la simple reproduction de la réalité, mais que la réalité doit d’abord être décomposée en plusieurs éléments ou fragments, ceux-ci étant ensuite réagencés d’une manière totalement nouvelle (donc après une opération de montage afin de créer une œuvre qui ne se prétend pas la réalité mais juste un petit jeu avec les éléments de cette même réalité. Cette expérience m’a appris qu’une œuvre n’est pas dans son auteur mais dans son lecteur ou son spectateur ; ou, plutôt, que cette œuvre une fois créée prend une infinité de formes, chacune d’elles étant de valeur égale. Ce qui signifie, par contre, que « mon » œuvre ne peut être celle de personne, que je suis donc le seul à pouvoir lire ce que j’ai écrit de la façon dont je souhaitais l’écrire. Tout lecteur aura sa lecture d’un texte qui – quoique le mien – est sans rapport aucun avec moi. Nous ne lisons pas ce qu’un autre souhaite que nous lisions, mais ce que nous-mêmes souhaitons lire. C’est ainsi que j’ai commencé à écrire, et que je continue de le faire.
► Tu n’es pas un écrivain qui reproduit le monde à la lettre. Quand j’ai découvert tes textes, et c’était au milieu des années 1970, au temps où dominait « la prose de la réalité », ils détonnaient dans le courant stylistique principal de la littérature, sans doute parce qu’ils étaient écrits de la perspective d’une expérience de la ville maîtrisée là où les écrivains de « la prose de la réalité » adoptaient le point de vue du « conquérant » qui débarque en ville afin d’y parfaire sa propre identité, d’y affirmer son importance ou de s’y voir reconnu socialement ; ils racontaient les expériences liées à cette venue et peignaient surtout la banlieue et les marginaux. Dans tes premiers livres tu traites au demeurant de thèmes fort différents, liés à la famille, de manière pas franchement autobiographique ni à travers une possible reconstruction de personnages existants et d’histoires véridiques, mais on peut voir dans l’assise de cette phase de ton œuvre une transposition particulière de thèmes familiaux. Le destin qu’ont connu tes parents est digne de nouvelles et de romans…
♦ À écrire sur une famille modelée sur des éléments qui relèvent de la mienne, j’ai en réalité découvert l’histoire véritable de ma propre famille et de mes ancêtres. Je garde le souvenir, dans mon enfance, de certains vides familiaux, de quasi-secrets dans l’ombre desquels j’ai grandi. En tout premier lieu, l’absence totale ou presque de famille du côté de mon père. Tout le monde avait des grands-pères et des grands-mères, des oncles et des tantes, des parents proches ou plus éloignés. Moi, je n’avais personne. La poignée de ceux toujours en vie étaient quelque part loin, en Israël ou de l’autre côté de l’océan. Puis il y a eu l’album de famille de ma mère rempli de photos de parents et d’enfants, mais qui n’étaient jamais ni ma sœur ni moi. Et l’homme le plus présent sur ces photos n’était pas mon père. Ces secrets de famille, à dire vrai, n’en étaient pas car mon père et ma mère vivaient dans un total et mutuel respect de leurs souvenirs et de leurs existences d’avant la Seconde Guerre mondiale. Mon père, juif sépharade, était né à Smederevo, avait vécu à Dorćol, étudié la médecine à Zagreb, puis exercé comme docteur à Niš où la guerre l’avait trouvé. Emprisonné comme médecin militaire, il avait été déporté dans un camp où il avait passé quatre ans. À Niš étaient restés sa femme et ses deux enfants ; ils furent tués, ainsi que la presque totalité de sa famille en 1941-1942 lors de l’épuration des juifs pratiquée par les Allemands en Serbie. Pendant ce temps, ma mère née en Bosnie, qui avait vécu avant la guerre à Zagreb, qui était l’épouse d’un juif ashkénaze, se cachait dans les villages serbes. À Belgrade où ils avaient fui, les oustachis et les nazis, les Allemands fusillèrent son mari. Elle parvint à survivre avec ses deux fils mais, après la libération, alors qu’elle se rendait en train à Belgrade, ceux-ci trouvèrent la mort dans un accident de chemin de fer. Ensuite, elle devait rencontrer mon père à Belgrade (qui n’était pas encore mon père), et ils décidèrent de refaire leur vie ensemble, de surmonter la tragédie et les souvenirs, mais dans le plein respect de cette tragédie et de ces souvenirs. Avec le temps, ce monde – ces mondes parallèles et ces personnages ombreux – s’est ouvert, présenté à moi en tant qu’histoire, mais il m’a absorbé en lui pour être partie de cette histoire. J’écrivais de l’intérieur en m’efforçant de m’en extraire mais, chaque fois que j’y parvenais, de nouveau je m’y précipitais car – dans la sécurité de l’histoire – tout m’apportait réconfort et apaisement.
► Ta génération d’écrivains (ceux nés entre 1945 et 1950) est entrée dans le monde de la littérature sitôt après 1968, quand la pression du contexte idéologique s’est mise à faiblir (sans pour autant s’éteindre). À la différence de tes congénères, tu ignores sans ambiguïté les questions relatives à la politique, considérant que l’engagement politique d’un écrivain (qui redevient alors pensée philosophique européenne avec, par exemple, Sartre et Adorno) contredit fondamentalement la dimension esthétique de l’écriture d’une prose fictionnelle. Pendant quelque vingt ans, tu te seras focalisé exclusivement sur l’écriture et la traduction, les événements politiques de 1968 semblant être restés en marge…
♦ Il est difficile aujourd’hui, à mon âge, de dire ce qui incite un jeune homme à se passionner pour la politique ou à s’y opposer. Je présume que m’aura marqué, d’un côté, l’atmosphère qui régnait dans ma famille – mes parents n’étaient pas membres du Parti, mais jamais chez nous on ne parlait ouvertement, on ne s’emportait contre le système. Les tragédies familiales qu’ils avaient vécues n’avaient rien à voir avec le système, elles étaient la résultante de la folie du national-socialisme allemand et non du communisme yougoslave, si bien qu’on ne pouvait trouver chez eux de motifs d’insatisfaction. On entendait bien de temps à autre : « C’était quand même mieux avant la guerre », mais cela n’avait alors aucune signification pour moi. Plus tard, après notre guerre, j’ai compris que c’était là le genre de phrases que l’on prononce après toute guerre : ce qui n’est plus apparaît toujours plus beau que ce qui est. D’un autre côté, quand j’ai commencé à sentir monter en moi une certaine rébellion, surtout sous l’influence de la culture rock des années 1960, celle-ci ne s’est pas muée en une aspiration à changer le monde, mais en une volonté de me changer moi, de changer de conscience. Sous l’influence de la lecture des livres de la tradition orientale, surtout du bouddhisme zen, cette volonté a écrasé tout le reste. Je crois aujourd’hui que seuls les gens de bonté sont à même de créer un monde à leur image, ce qui explique en partie pourquoi le monde continue de n’être pas bon. Les gens de bonté y sont en nombre trop restreint, surtout parmi ceux qui s’affichent en leaders. Néanmoins, il m’arrive souvent de penser que les choses auraient pris un tout autre tour pour moi si je n’avais pas eu les cheveux longs. L’un des meilleurs étudiants de la section Anglais et littérature à l’École normale supérieure, on m’a sollicité pour adhérer au Parti. J’ai été invité à une réunion, j’ai docilement accédé à cette requête, mais à mon arrivée – comme de juste, et si ma mémoire ne m’abuse pas, la rencontre devait avoir lieu dans une classe du rez-de-chaussée ̶ dans un couloir à la lumière louche, ce qui donnait à toute l’affaire une dimension quelque peu mystérieuse et conspiratrice, un jeune costaud m’a arrêté et demandé : « Où on va comme ça, camarade? ». Quand j’ai dit « On m’a retenu pour entrer au Parti », il m’a répondu : « Tu passes d’abord chez le coiffeur, et ensuite tu reviens ». J’ai tourné les talons, et je ne suis jamais revenu. Sûrement que le parti s’en fichait, mais mes mèches de cheveux qui me tombaient alors sur les épaules m’étaient trop chères pour que je les sacrifie à qui ou à quoi que ce soit. Et c’est ainsi, alors que j’étais étudiant, que 1968 est passé pour moi totalement inaperçu. Je devais comprendre certaines choses par la suite, mais il était déjà trop tard.
► L’(auto)biographie est fréquemment le point de départ de tes livres. Comme si le monde de l’imagination se construisait sur quelque chose de concret afin, plus tard, avec la langue, de s’en éloigner le plus possible et de se diriger vers une signification plus profonde, encore à découvrir, encore à exprimer. Les éléments biographiques se reconnaissent dans nombre de tes livres (Le Temps familial, Le Zinc, Description de la mort, L’Appât) – bref, si nous essayons de généraliser autant que cela se peut pour sonder leur base poétique, dans ta prose se perçoit une tension constante, parfois franchement ouverte, parfois simplement latente, je dirais même un écartèlement productif et créatif entre la vie et la littérature pour paraphraser Danilo Kiš. Je m’interroge sur un point qui se rattache vraiment à ton histoire familiale, mais avec des implications culturelles plus profondes. Les écrivains juifs, je veux dire les écrivains d’origine juive qui écrivaient en langue serbe – leur langue de base, la première et, très souvent, la seule – ont contribué grandement à la littérature serbe, introduisant dans la culture serbe l’esprit d’une tradition particulière et amalgamant cette tradition à d’autres types de traditions que cette culture, en tant que culture des croisements permanents, connaît fort bien. Comment vois-tu ta judéité, comme une différence et, si j’ose m’exprimer ainsi, comme une marque fatale, imprimée par ton origine ? Tu sembles être venu à la judéité, la judéité en tant qu’identité, par paliers, d’une individualisation imparfaite pendant ton enfance et ton adolescence, puis par ta prise en compte de cette question qui est devenue l’un de tes thèmes littéraires majeurs, jusqu’à, finalement, ta participation dans certaines entreprises officielles, publiques, telle, disons, la présidence depuis quelques années de l’Union des communautés juives de Yougoslavie…
♦ C’est vrai, quand je me retourne sur mon passé je vois qu’il existe une certaine progression par paliers dans mon acceptation et ma compréhension de la judéité. Dans une première phase (appelons-là ainsi), les années de ma petite enfance, j’ai grandi en lien étroit avec la communauté juive – nos parents nous conduisaient aux différentes manifestations, l’été je partais dans les centres de vacances juifs sur l’Adriatique, je participais aux commémorations traditionnelles de nombreuses fêtes juives. Le point culminant de cette première phase aura été notre voyage familial en Israël au cours de l’été 1961. Un voyage mystique pour moi ! Qui a débuté le soir où ma mère a cousu quelques dizaines de dollars dans la poignée de son fourre-tout, la seule façon sans doute d’emmener un peu plus d’argent avec nous. Nous avons d’abord pris le train pour Athènes, où nous sommes restés trois jours et où j’ai pu découvrir l’Acropole, puis nous avons fait trois jours de bateau avec escale à Rhodes et à Chypre. Nous avons passé deux mois en Israël, parcouru tout le pays et visité Jérusalem qui était alors scindée en deux. Aujourd’hui les gens sont rassasiés de voyages mais c’était alors un voyage qui valait, au sens littéral du terme, d’être narré comme une histoire. Je me souviens, à la demande d’une enseignante, de l’avoir raconté en détail et plusieurs heures durant aux autres élèves de ma classe. En ce temps-là, à la fin de l’adolescence, cet intérêt était très marqué, du fait bien sûr (et je le comprends aujourd’hui) de mon obsession à vouloir construire d’autres identités, à m’intéresser aux questions du corps et de la sexualité, aux premiers dilemmes en matière de création, aux doutes quant à l’éducation.

Jérusalem (vue du mont des Oliviers)
source : freestockphotos.com
Au début des années 1970, alors que je me voyais déjà en écrivain et traducteur, j’ai à nouveau souhaité m’engager dans le travail de la communauté juive et, au cours de la vingtaine d’années suivante, elle est devenue mon second foyer. Je suppose que je sentais alors mon identité définitivement déterminée, ce qui pour quelqu’un issu d’une famille mixte n’est jamais facile. Difficulté supplémentaire, l’indulgence de mes parents qui soulignaient notre judéité à ma sœur et à moi mais sans jamais nier l’existence de l’autre face de notre héritage, la ligne serbe apportée par ma mère. À ce point, quelques éclaircissements un peu « techniques » ne sont peut-être pas superflus : ma mère s’étant convertie au judaïsme, ma sœur et moi, du point de vue formel, sommes juifs au dire des préceptes religieux ; par ailleurs, génétiquement et biologiquement parlant, nous sommes mélangés. J’ai grandi avec les histoires de la tradition juive, mais tout en écoutant la poésie populaire serbe qui chantait Miloš Obilić et Tanasko Rajić qui, par les exploits, étaient très proches des héros de l’histoire juive. Nous dirons qu’au début des années 1970, je me suis finalement décidé, sachant qui j’étais et que je me sentais prêt à assumer ma judéité sans me soucier des conséquences.
Somme toute, mon travail dans la communauté juive – d’abord dans le domaine culturel, puis dans de nombreux autres champs d’activité – m’a conduit à un engagement toujours plus marqué qui a culminé dans mon acceptation du poste de président de l’Union des communautés juives de Yougoslavie. Ce qui ne devait être qu’une présidence d’honneur – cette nomination est intervenue au début des années 1990 – s’est transformée en une préoccupation de chaque instant pour les réfugiés juifs et en un soutien aux autres membres de la communauté qui, comme tous, étaient tombés la tête la première dans la misère et le dénuement. Je ne doute pas aujourd’hui que j’ai été incité à adhérer à la judéité par l’écriture, autrement dit qu’en suivant le conseil de Piotr d’écrire sur ma famille, j’ai rapidement compris que pour ce faire, il fallait plonger bien plus profondément en soi et dans sa famille que je ne l’avais fait jusqu’alors ; il me fallait pour de bon intégrer l’histoire de ma famille afin de pouvoir écrire sur cette histoire. L’écriture a façonné mon identité, et cette identité retrouvé a, en retour, façonné mon écriture.
► La judéité a manifestement développé en toi un sentiment de particularité et une certaine différence (je dirais plus invisible que visible) par rapport au milieu auquel tu appartenais pour tout le reste ; je pense d’abord à l’existence et à l’activité de l’archétype juif qui se manifeste parfois dans tes nouvelles et romans. Il ne s’agit donc pas uniquement de la pratique de certaines coutumes qui affirment la particularité et la différence, mais d’une perception spécifique, profonde du monde, d’une vision propre du monde qui t’entoure. En ce sens, que représente pour toi la judéité d’un point de vue substantiel, voire même indépendamment de son existence, par certain signes extérieurs, ou de son inexistence dans la vie de tous les jours ?
♦ Je ne suis pas certain de pouvoir répondre précisément à cette question, surtout parce que je veux croire que la vie – la mienne, du moins – reste malgré tout une sorte de continuité ininterrompue. Disons que je ne tiens pas l’identité (si c’est d’elle dont nous parlons) comme donnée mais comme relevant d’une possibilité de choix même si l’histoire me rappelle qu’aux moments cruciaux, ce n’est pas nous qui définissons notre identité, mais d’autres. Le juif est le banni par excellence ; et banni, l’artiste l’est par nature ; c’est peut-être ce trait qu’ils partagent qui m’attire et vers l’un et vers l’autre.
► Vus en dehors du contexte politique, et dans la mesure où cela se peut effectivement, les représentants de la génération qui a fait son entrée dans la vie littéraire en 1968 et après (en prenant fait et cause pour ou contre l’idée d’engagement politique et en se conformant à la nature de sa vison fondamentale d’acceptation ou de rejet de ce type d’action publique) ont commencé à s’intéresser et à prôner un modèle institutionnel ou antiinstitutionnel de comportement culturel. L’art, ce qui inclut aussi la littérature, s’est mis à absorber les fortes influences de la pensée alternative, pensée non officielle et non établie institutionnellement… Tu es l’un des premiers écrivains serbes à avoir fait tiennes ces expériences qui sont apparues sous une forme transposée dans ta prose.
♦ Je crois m’être alors résolu à sonder certaines expériences alternatives afin d’éviter tout engagement politique ouvert. Dans la vie réelle, les décisions ne se prennent évidemment pas de la sorte, plonger dans quelque chose sans intention préalable ni laisser percer de signes avant-coureurs est possible. Quoi qu’il en soit, je suis entré dans le monde du rock’n’roll, de l’idéologie hippie, des enseignements orientaux et des états d’esprit alternatifs de la conscience avec curiosité et détermination à changer. Disons que j’y suis entré dans un esprit de quête, à vrai dire pour exprimer une opposition déterminée à l’establishment familial et social, au dit système de valeurs socialiste. Cela a débuté par un intérêt pour le rock’n’roll au début des années 1960, alors qu’émergeait la nouvelle British beat (Beatles, Stones, Animals, et autres), puis, au cours de cette même décennie, par l’adoption du « pouvoir des fleurs » (Flower power) hippie, avant une orientation vers l’écriture et l’entrée dans les cercles de jeunes écrivains belgradois qui, inspirés par les mêmes influences, créaient dans différents médias. Être alternatif signifiait en réalité rompre avec la tradition, donner forme à une nouvelle tradition par l’amalgame des traditions les plus diverses, jeter des ponts entre des cultures de prime abord irréconciliables. Peut-être que ce n’est pas tout à fait exact, mais telle était ma vision des choses et c’est là, quelque part dans ce mélange, que j’ai construit ma poétique d’écrivain.
À y repenser aujourd’hui, je suis surpris de voir qu’entre le moment où je me suis laissé pousser les cheveux en 1966 (quand tout le monde dans la rue se sentait obligé de m’apostropher : « Ceux comme toi, on les tuait pendant la guerre ! ») et, disons, les nouvelles qui m’occupe actuellement, on peut tirer un fil, un fil qui, pourtant, existe. Le jeune gars alors aux cheveux longs, grâce à ces quolibets, a appris à respecter la différence, à persister dans ses convictions, à ne pas faire montre d’incrédulité face au neuf, à chercher d’abord en lui-même, puis chez les autres, les réponses aux questions qui l’assaillaient.
► Tu as débuté en tant que poète. Tu as ensuite incorporé certaines de tes compositions dans la magnifique nouvelle Izabrane pesme Eugena Rajnera [Poèmes choisis d’Eugen Rajner] mais, de ton propre aveu, tu as laissé tomber la poésie relativement vite. Peut-être serait-il bon que tu essaies d’expliquer pourquoi. Le genre littéraire dans lequel tu t’es avant tout réalisé est celui de l’histoire courte, celle d’un genre très particulier, atypique dansla tradition littéraire serbe qui le réduit souvent à l’anecdote.Comment en es-tu arrivé là ? Pour ceux qui n’ont pas le souvenir de cette époque, je dirai qu’au début des années 1980, grâce à ton travail de rédacteur à Književna reč, le périodique littéraire alors le plus important, et de loin, en Serbie et en Yougoslavie, est arrivée sur le devant de la scène une génération entière de jeunes écrivains – dite alors « la jeune prose serbe », puis « les postmodernes serbes » – qui s’est dès le départ beaucoup consacrée à la forme courte. Le prix Ivo Andrić qui t’a été décerné en 1982 est venu confirmer la valeur de ton travail que l’on avait considéré dans un premier temps – comme toujours s’agissant de nouveautés en littérature – avec un mépris mâtiné d’indifférence.
♦ C’est exact, j’ai commencé par composer des poèmes, comme la plupart de ceux qui veulent se consacrer de plus près aux mots et à la langue. À cette époque, je l’ai dit, je m’étais mis à fréquenter assidument Raša Livada, et je me suis aperçu que si je persistais dans l’écriture de poèmes, je deviendrais au mieux son imitateur. Je me suis alors tourné lentement vers la nouvelle et le récit, même s’il m’arrive aujourd’hui souvent de penser (ce que, si je ne me trompe, tu m’as dit toi-même à plusieurs reprises) que derrière l’apparence de ma prose se dissimule une réelle et pure passion pour la poésie. Mais qu’importe, une fois lancé dans les thèmes familiaux, je me suis voué à la forme et à l’écriture d’une langue qui soit la plus concrète possible. Je ne pourrais aujourd’hui reproduire ce processus dans son intégralité, car il a subi l’influence de l’art de la narration de beaucoup d’écrivains, mais au nombre de ceux-ci (de leurs poétiques) m’ont d’abord influencé Faulkner, Updike et Schultz. Puis j’ai « découvert » la génération des auteurs américains, représentants de « la métafiction » (John Barth, Robert Coover entre autres), et mon monde narratif ne pouvait plus rester ce qu’il était. Les fragments, montages, jeux, autodérision, parodie des styles – tout cela a intégré mon regard sur la forme courte. Il y a eu différents moments de découverte et de compréhension, mais je me souviens tout particulièrement du moment où lisant Abattoir 5 de Kurt Vonnegut, j’en suis arrivé à la description d’une scène où des prisonniers souffrent en masse de diarrhée après avoir dévoré quelque chose – ça ressemblait à ça, mais en cet instant l’exactitude parfaite n’est pas importante. Ce qui l’est par contre, c’est l’endroit où l’écrivain dit (je paraphrase) : « Et ce soldat qui se sentait vraiment expulser de lui-même son propre cerveau, c’était moi, l’auteur de ce texte ». J’en avais été choqué, cette phrase de Vonnegut, ce persiflage avec son propre statut d’écrivain, me paraissait presque blasphématoire dans notre atmosphère littéraire où l’écrivain était tout le temps présenté comme quelqu’un de supérieur, comme un juge suprême pour les questions intellectuelles et morales de notre temps.
Après cette phrase, tout a changé de fond en comble, et quand je me suis mis à travailler la forme courte, plus rien n’a été en mesure de m’arrêter. Dans le même temps, mon intérêt pour les formes concises de narration est allé grandissant et, en l’occurrence, m’a fortement influencé un poète américain, William Stanley Marvin (dont j’ai traduit des poèmes avec Raša Livada) qui écrivait aussi des nouvelles resserrées. Ces années-là, je me suis lié avec Kolja Mićević, et notre relation a atteint son point culminant au milieu des années 1970 quand je suis parti effectuer mon service militaire dans sa ville, Banja Luka. Et je tiens sa passion pour la poésie, son obsession pour la perfection de la langue (et de la traduction) pour la dernière tesselle de ce qui devait au final constituer l’assise de ma poétique en matière de prose.

Kolja Mićević
► Peut-être faut-il chercher de ce côté les racines de l’incompréhension qui s’est manifestée de manière sporadique à l’égard de ta prose, avec bien plus de force les premiers temps qu’aujourd’hui, quand les écrivains des années 1980-90 ont commencé à absorber très naturellement ce que leur apportait la lecture des écrivains étrangers contemporains. Jusqu’alors dans la littérature serbe, il était légitime de reconnaître l’influence ou les modèles de la tradition plus ancienne, serbe ou étrangère, mais pointer des analogies poétiques avec la scène artistique mondiale contemporaine, qu’elle soit littéraire ou relevant de la sous-culture alternative, était vu d’un mauvais œil (je pense surtout à l’apparition du postmoderne dans la culture serbe), c’est-à-dire considéré comme une mode sans point de contact avec notre tradition serbe. Par la suite, ce fut l’inverse. Nous avons souvent échangé sur la littérature serbe, et il me semble que jamais tu n’as sorti un écrivain serbe de la tradition comme étant un éventuel précurseur poétique ou parent en quoi que ce soit. Néanmoins, pour ce qui est des contemporains, tu qualifies dans un texte Danilo Kiš de maître…
♦ La situation de la littérature serbe à la fin des années 1960 et au début des années 1970 était bel et bien celle que tu décris, mais j’aimerais souligner – en dépit de toutes les différences – que jamais je n’ai eu de problèmes pour être publié. Du reste, ni ladite « prose de la réalité » (ni les postmodernes par la suite) ne formaient une école monolithique, et même si on la voyait comme une déferlante emportant tout devant elle. Cette prose-là aussi comportait des traditionnalistes et des innovateurs (au premier plan desquels Miroslav Jošić Višnjić), ce que leur évolution a ensuite démontré. Par ailleurs, me gênait dans leur prose leur recours à une langue strictement locale, leur focalisation sur la campagne ou la petite bourgade, des milieux qui m’étaient éloignés. Kiš était alors déjà à cent lieues de cela, et il est parfaitement naturel que ses livres publiés à cette époque – je veux parler de Jardin, cendre, de Chagrins précoces, de Sablier – aient exercé une influence sur moi tant par leur diversité formelle et stylistique que par leurs références ouvertes à des modèles et à des prédécesseurs littéraires (Jardin, cendre conduisait bien sûr à Schultz, et Sablier s’orientait vers les écrivains de ladite Nouvelle Vague française). Mais au sujet des écrivains serbes plus anciens, il est exact que je ne me sentais aucune parenté avec quiconque, ce dont on peut incriminer, soit dit en passant, le système scolaire et les lectures obligatoires qui m’ont de fait éloigné de nombre d’écrivains. De surcroît, dans leur majorité ils basaient leur œuvre sur des recherches obstinées dans l’Histoire lointaine, et l’Histoire était alors un thème qui ne m’intéressait pas le moins du monde.
|
Danilo Kiš
|
M. Josić-Višnjić
|
► La forme courte que tu écris, et, avec toi, d’autres écrivains contemporains tant en Serbie que dans le monde, est un genre relativement jeune qui, il faut l’admettre, plonge ses racines au plus profond de la tradition littéraire. Selon toi, quelles influences se sont exercées pour que la forme courte connaisse une totale métamorphose et soit ce qu’elle est aujourd’hui ? J’ai parfois la sensation que la forme courte répond plus au goût des écrivains eux-mêmes qu’à celui du public des lecteurs au sens large. Pourquoi ? Et j’ajouterai que dans tes livres se trouvent très souvent des réflexions et commentaires sur le processus même de l’écriture et, surtout, sur l’outil de base de l’écrivain, la langue. La langue qui est réellement ton thème de base. Mais depuis ton départ au Canada, s’est adjoint à elle le thème de l’Histoire, comme dans L’Appât, par exemple.
♦ Dans la première partie du XXe siècle, la forme courte jouait un grand rôle, rôle qu’elle a commencé à perdre quand le modernisme a fait une fixation sur la forme romanesque. Dans les années 1960, elle a connu une nouvelle floraison car elle a su réagir le plus rapidement aux exigences des temps nouveaux : l’émergence des mass médias, l’influence de la culture rock, l’apparition des vidéoclips musicaux, la recherche de nouvelles formes narratives. Plus tard le roman a su trouver les moyens de tout absorber, de se renouveler, et il a de nouveau marginalisé la forme courte. Dans un certain sens, cette dernière est un polygone d’essai pour la forme de prose plus longue, ce qui me donne à penser que le début du XXIe siècle sera marqué par une nouvelle percée de la forme courte, concise.
Ton assertion sur sa popularité plus grande chez les écrivains eux-mêmes que chez les lecteurs n’est sans doute pas tout à fait exacte. Car le public des lecteurs sait parfaitement qui sont les prosateurs de qualité, et on ne peut pas dire qu’il ne lit pas leurs livres. Néanmoins, je ne suis toujours pas parvenu à comprendre totalement la promptitude des éditeurs à investir nettement plus dans les romans que dans les nouvelles. Cela se sent principalement sur les grands marchés littéraires où on impose les best-sellers et leurs auteurs comme étant la vraie littérature. Je reste malgré tout persuadé que n’importe quel recueil de nouvelles pourrait devenir un best-seller si on consacrait à sa promotion des moyens identiques à ceux mis en œuvre pour promouvoir les romans de John Grisham ou Steven King. Et n’oublions pas le point de vue qui prévaut dans beaucoup de littératures : l’écriture de nouvelles prépare à la rédaction de romans, ce qui tendrait à dire que les nouvellistes sont des écrivains en attente de maturité (tels, il faut le croire, Tchékhov ou Borges), et que les romanciers, tous autant qu’ils sont, allient intelligence et plénitude. Je crains que de tels points de vue ne se modifient pas de sitôt mais, en tant que nouvelliste, cela ne me dérange nullement. Mieux vaut être populaire par la subversion que par le populisme.
Pour répondre à l’autre question, j’assieds mes nouvelles sur le doute que j’éprouve quant à la possibilité de narrer les choses. Ou, mieux encore, sur la mise en question de la capacité de la langue à exprimer notre vraie réalité, à dire la seule vérité. Mais un pas de plus dans cette direction, et je suis en plein l’absurde : j’utilise la langue pour exprimer les doutes dont l’utilisation de la langue me remplit. D’autre moyen, il n’en est évidemment pas. La langue est une convention à laquelle tous sommes astreints mais aussi tenus d’accepter quelle que soit l’insatisfaction qu’elle nous procure. Mon nouvel espace de vie renforce plus encore la suspicion dans laquelle je tiens la langue mais, tout aussi paradoxalement, ma foi en elle parce que la langue dans laquelle j’écris est maintenant entourée d’une autre langue, foncièrement différente. D’un autre côté, l’éloignement de l’espace ex-yougoslave m’a forcé à m’approcher de lui dans le domaine que j’aime le moins, celui de l’Histoire. Ce séjour dans mon nouvel espace de vie, par contre, m’a poussé à réfléchir le plus souvent sur les possibilités et impossibilités de passer d’une culture à une autre culture, d’une langue à une autre langue, d’un sentiment d’appartenance à un sentiment de bannissement.
L’Appât est né de la réflexion sur les thèmes évoqués dans la réponse précédente. Et aussi de mon désir, après mon roman Le Zinc où j’évoquais mon père, d’écrire un livre sur ma mère. L’Appât doit donc, entre autres, se lire comme le reflet du Zinc dans le miroir de la narration. Je ne suis pas certain de pouvoir le lire comme lecteur, il me faudrait pour cela plus de distance dans le temps, oublier nécessairement la majeure partie du texte et des efforts de création qu’il m’a fallu fournir pour que naisse ce roman ; alors seulement je saurais pour de bon quel genre de livres j’ai écrit.
► Mais si l’Histoire est absente, reste la préoccupation pour la langue. En réalité, tu en débats dans presque tous tes livres, le plus souvent en proposant des variations sur l’impossibilité de transmettre avec des mots ce que tu souhaitais précisément dire, sur le fait que par la langue tu construits une vision remplie à ras bord d’existence. Tu répètes sans cesse que tu ne crois plus aux mots (le point de vie défendu par le postmodernisme des débuts), que la langue est morte, frappée d’impuissance, mais, par ailleurs, tu te voues totalement à elle, elle est l’un de tes thèmes principaux. Comment te sors-tu de ce paradoxe ?
♦ C’est un paradoxe avec lequel on vit, c’est-à-dire avec lequel on parle et on écrit, un paradoxe qui peut être comparé à celui d’un ’habitant d’un pays totalitaire qui affirme : « Il n’y a pas de vie possible sous le totalitarisme » mais qui ne se donne pas la mort pour autant et continue à vivre. Se taire est bien sûr possible, mais se cantonner dans le silence – du moins à ce niveau de la communication humaine – peut dans une mesure plus grande encore se prêter à une interprétation erronée ; d’où mon choix du moindre mal : la parole et l’écriture. Le postmodernisme, comme tu dis, des débuts en a fait l’un de ses principes de base en prenant comme point de départ l’endroit où le modernisme tardif s’était arrêté. En fait, rien n’est plus facile de constater que la littérature est de tous les arts le moins développé, l’unique branche où une œuvre est estimée de qualité comme si elle avait été écrite, disons, deux siècles plus tôt.
Aujourd’hui encore, l’un des poncifs de la critique littéraire est d’affirmer au sujet de quelqu’un que l’on souhaite tout particulièrement louanger qu’il écrit comme Tolstoï ! C’est ainsi, par exemple, dans une recension parue dans le New Yorker que John Updike a récemment jugé le nouveau roman de l’écrivain canadien d’origine indienne Rohinton Mistry. Mais c’est là un cul-de-sac car la langue ne peut pas changer, et si le vocabulaire peut s’élargir la grammaire de base est inaltérable. C’est peut-être là qu’est le problème : la langue a ses limites alors que le monde n’en a pas, la littérature utilise la langue, mais en ayant le désir de montrer le monde. Autrement dit, il faut avoir conscience au début de toute écriture que son résultat final est d’avance voué à être un échec. Ce qui en fait une tâche à la Sisyphe, qu’on y ait pensé ou non. L’écriture reste toujours et uniquement une tentative pour atteindre à l’indicible. Il est évidemment des écrivains qui ont cherché une issue, Joyce, par exemple, mais en pareil cas le résultat est au bout du compte la création d’une langue à soi (celle dans laquelle est décrite La Veillée de Finnegan), ce qui veut dire qu’exception faite de l’auteur, personne ne peut lire ce qui est écrit. Pour ma part, je me suis toujours résolu, au besoin, de me lamenter sur le caractère limité de la langue mais sans jamais franchir la frontière de la compréhension, sans trop donner dans « l’expérimentation » qui rendrait ma prose difficilement lisible. C’est là, certes, un compromis, mais qui n’est en rien pire que nombre d’autres sur lesquels reposent nos existences.
► Oui, nous en arrivons maintenant aux changements importants. Pendant de longues années, disons de tes débuts littéraires jusqu’au roman Le Zinc, tu as prôné la devise minimaliste : le moins est le plus, et tu as nié avec un bel esprit de suite la présence dans ce que tu écrivais de ces grands thèmes que sont la politique et l’Histoire. Puis est venu un revirement, non pas radical mais progressif : les grands thèmes auxquels s’attache toute littérature des temps modernes ont commencé, de manière insensible d’abord, plus visible ensuite, à apparaître dans tes nouvelles (et par la suite dans tes romans). Il me semble qu’il y ait à cela plusieurs raisons : l’influence des événements marquants de ta biographie, la disparition des parents qui nous transforme et nous rappelle que nous sommes les prochains sur la liste, puis la crise politique et la guerre dans les espaces de l’ex-Yougoslavie, la volte-face de la société serbe dans les années 1990, et, enfin, ton installation au Canada.
♦ La mutation dont tu parles s’est produite progressivement, mais je ne trouve en moi que deux « coupables » : l’effondrement de la Yougoslavie et l’éloignement de mon pays natal, c’est-à-dire mon départ au Canada. La disparition de mes parents, en soi, ne m’a pas fait me tourner vers l’Histoire. Dans Le Zinc, appelle-toi, je regrettais que mon père ait vécu dans l’Histoire alors que moi, je n’en avais aucune perception. Ce qui, bien sûr, peut être maintenant vu comme l’indication de ma naïveté en matière d’Histoire et de politique. J’ai écrit Le Zinc dans la seconde partie des années 1980 quand, déjà, tout conduisait à la mise à mort de la Yougoslavie et au renouveau de l’Histoire sans que, semble-t-il, je m’en aperçoive. L’Appât était conçu tel un roman-miroir, le reflet du Zinc, et si je l’avais écrit à un autre moment, à un autre endroit, il aurait sans doute eu une forme fragmentaire similaire. La mort de mon père a constitué pour moi l’achèvement de l’histoire familiale, celle réelle et celle passée dans ma prose. En fait, je pense aujourd’hui que Le Zinc est né très paradoxalement d’une double sensation, de libération et d’incarcération plus profonde encore : plus l’absence du père se fait sentir, plus on se sent irrémédiablement lui appartenir. Ce sentiment a refait surface après le décès de ma mère mais alors, dans un certain sens, j’y étais préparé même si on ne peut jamais se préparer totalement à la mort de ses parents. J’ai écrit L’Appât dans d’autres conditions de vie, alors que j’avais déjà reculé devant l’avancée de l’Histoire ; tout dans ce roman est donc soumis aux caprices historiques. Dans Le Zinc je réussissais probablement encore à faire front à l’Histoire, d’où le côté fragmentaire et le procédé tendant à relier de petites entités, ce qui n’est pas le cas dans L’Appât. L’Histoire y est un bouillonnement, un paragraphe ininterrompu dont, pour qui y pénètre, il n’est pas de sortie.
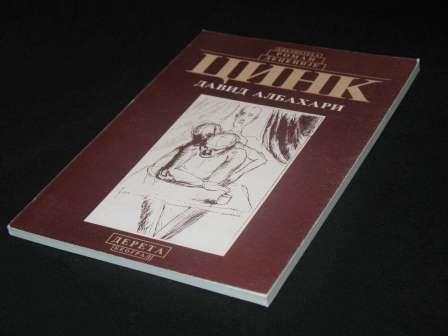
Cink / Le Zinc
► Puis sont venues les années de démence, l’effondrement du pays où nous avions grandi et dont nous considérions nôtre la culture sans nous préoccuper de sa détermination en fonction de critères nationaux. Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Miroslav Krleža et Meša Selimović, Vitomil Zupan, par exemple, ou, encore, Ranko Marinković, Quand les courges étaient en fleurs de Dragoslav Mihailović et Un Tombeau pour Boris Davidovitch de Danilo Kiš, les comédies grotesques de Kovačević et Šijan Qui chante là-bas et Les Marathoniens font leur tour d'honneur, les films d’Abdulah Sidran et d’Emir Kusturica, les tableaux de Voja Stanić, Safet Zec et Vladimir Veličković, les groupes musicaux Korni et YU-grupa, Indexi, Bjelo dugme, Buldožer, Leb i sol, la nouvelle vague belgradoise et zagreboise – je ne cite que ce qui me revient immédiatement à l’esprit – n’étaient plus les plus précieuses valeurs d’une culture certes complexe mais formant un tout. Sont venues les années de crise, la guerre, et un État européen qui faisait sens s’est vu tout bonnement démanteler de manière morbide laissant derrière lui, en nous – ces mots ne sont pas une lamentation ! – les conséquences durables, traumatiques de cet effondrement. Quelle est ta vision de tout cela ?
♦ L’effondrement du pays ? C’est de l’histoire ancienne, j’ignore si cela vaut d’y revenir, surtout qu’à la différence de celles que nous écrivons, il n’y a là plus rien qu’on puisse changer. Elle s’est achevée pour moi sur un sentiment de perte, avant toute chose parce qu’elle s’est soldée par la déroute d’une possible identité supranationale qui, pour moi, du fait de mon origine et aussi de ma compréhension du monde, allait bien au-delà de la simple réunion de diverses composantes nationales. Par la destruction de cette identité et, donc, le retour à des identités nationales distinctes, on a fait un pas en arrière, en dehors du cours de l’Histoire, et, dès lors, toute cette région a pris du retard sur le monde. Un retard qu’elle comblera un jour, cela ne fait aucun doute, mais uniquement quand elle se sera affranchie de la domination strictement nationale, ce qui constitue un véritable paradoxe, mais tels sont les caprices de l’Histoire et on n’y peut rien.
Tu parles d’années de crise, mais je ne suis pas bien certain de savoir ce que cela signifie encore. Car ladite crise n’est-elle pas toujours en cours ? Si tu penses aux années 1990, au début des années 1990, quand j’étais toujours à Belgrade, elles se sont tout bonnement déroulées dans une lutte pour la survie. Une fois parti, quand j’ai contemplé les choses de cette terrible distance, ce n’était plus moi que la crise affectait, mais quelqu’un d’autre. Étant en sécurité et sans rien à craindre (avoir le cœur brisé ne se prend toutefois jamais en compte), que j’en parle à ceux qui continuaient à en souffrir était malvenu. Mais comme chez quantité d’autres, une fracture s’est alors produite ces années-là, et est venu pour moi un moment après lequel plus rien n’a été pareil. Au printemps 1992, à la veille de la guerre en Bosnie, nous organisions le départ des Juifs de Sarajevo ; et parmi les nouveaux arrivants à Belgrade il s’est trouvé un réfugié que je connaissais, un philosophe. Nous nous sommes salués, et il m’a dit : « Je suis venu accompagner ma mère, je repars tout de suite. Tu sais, tous mes livres sont encore là-bas. » Il n’est évidemment pas rentré en Bosnie et, quelques mois après, il est parti quelque part en Europe où il est sans doute aujourd’hui encore. Mais ce soir-là, chez moi, je suis allé dans mon bureau, j’ai regardé les étagères, les armoires qui geignaient sous le poids des livres, et j’ai ressenti l’absurdité de toute possession. Ensuite, quand l’occasion s’est présentée, m’en aller a été plus facile. Et je suis parti.
► Il n’est pas d’intellectuel serbe porté à la critique qui ne se soit interrogé au début et au cours des années 1990 : partir ou rester ? Beaucoup sont partis, beaucoup sont restés. Et s’est ainsi développé un climat particulier de clivages : ceux qui étaient partis ont commencé à expliquer les raisons qui les avaient décidés à partir, et ceux qui étaient restés celles pour lesquelles ils étaient restés. De nouvelles perspectives se sont croisées, de nouveaux stéréotypes, de nouvelles généralisations bien imprudentes se sont fait jour, un rejet des autres points de vue qui cédait parfois la place à l’intolérance ne faisait qu’alourdir encore la situation catastrophique de la société serbe, et une frange importante de l’élite intellectuelle serbe, ne comprenant pas ce qui lui arrivait, a accepté la corruption, la manipulation, la mise au service du pouvoir. Ceux qui étaient partis, à l’inverse, consentaient fréquemment à se voir étiqueter du stéréotype de dissidents postcommunistes. Pour ta part, tu es parti au Canada en te gardant bien de toute proclamation politique de quelque ordre que ce soit.
♦ Ce départ a été le fruit du hasard, même si on peut dès lors se demander ce qui ne relève pas du hasard. Enfin, quand je suis parti à l’automne 1994, je ne croyais absolument pas demeurer au Canada plus d’un an. Les choses se sont passées autrement, d’abord parce que j’ai obtenu une bourse d’écrivain en résidence, ensuite parce que mon épouse a trouvé du travail ; notre retour a été différé, les billets d’avion jetés, les enfants sont allés à l’école, et subitement, quoique tout se soit passé par étapes, nous avons réalisé que nous étions maintenant ici. Par comparaison avec beaucoup d’expatriés serbes, ce type de culture ne nous était pas étranger, de sorte que nous ne nous sommes pas révoltés intérieurement contre notre nouvel environnement.
Nul doute que laisser derrière soi son existence antérieure est difficile, mais quand cela s’accompagne d’un sentiment de libération des pressions de toutes sortes qu’il nous avait fallu endurer, des rôles à jouer, on se débarrasse plus facilement de souvenirs aussi. Si le choix m’avait été donné, peut-être que j’aurais souhaité être ailleurs (quelque part en Europe), mais je me suis entre-temps pris de passion pour cette contrée et les magnifiques montagnes Rocheuses qui comblent mon horizon vers l’ouest, si bien que je n’envisage pas de nouveau changement. Je ne suis bien sûr pas un banni au sens premier du terme ; je n’entends pas non plus m’intégrer à la littérature d’ici ; je suis simplement à une grande distance de mon pays natal et de sa langue, j’écoute cette langue et j’écris des livres. Pour qui pense qu’un écrivain doit n’être qu’un écrivain et non doublée d’une personne publique, ce que je vis tient du rêve réalisé. Aucun rêve réalisé ne l’est bien sûr dans sa plénitude, mais c’est là déjà une autre histoire.

Rocheuses
► Les relations très vivantes de ta prose avec les écrivains et les œuvres de la littérature mondiale constituent une partie importante, pour ne pas dire une partie essentielle de ton œuvre, le fruit de ton expérience de traducteur. Tu as traduit des livres de Vladimir Nabokov, Saul Bellow, John Updike, Thomas Pinchon, I. B. Singer, Sam Sheppard, Robert Coover, Michael Walding, Sherman Alexis, Margaret Atwood… Je suis brusquement enclin à affirmer l’existence d’une certaine harmonie entre ta poétique d’écrivain et celle de traducteur, dans ta manière de traiter la langue et pour l’intérêt que tu portes à la littérature qui ne décalque pas mais crée un monde nouveau. Je dirais qu’en te préparant pour la traduction, qu’en menant cette préparation à son terme, tu as réalisé ta propre vocation d’écrivain. Comment vois-tu ce lien ? Et dis-moi aussi quelques mots sur ta technique d’écriture (préparations, arrivée au thème, travail sur le texte, éventuelles versions).
♦ La traduction est probablement la meilleure école d’écriture possible. D’abord, elle comprend l’exigence de pénétrer aussi profondément que possible l’acte d’un écrivain autre que soi, ensuite elle incite sans cesse à renouveler et à parfaire son propre style et sa langue. C’est une quasi-certitude, mon travail sur les nouvelles, par exemple, des auteurs américains de la métafiction ou sur les nouvellistes australiens (au cours des années 1970-80), le travail effectué également sur la poésie de Mark Strand, Russel Edmund, et d’autres ont fortement influencé ma poétique d’écrivain. Du reste, mon intérêt de traducteur était d’abord orienté vers ces ouvrages et ces auteurs qui, pour diverses raisons, étaient inaccessibles à nos lecteurs en Serbie. D’où l’idée que je me fais de moi-même en « traducteur informatif » plutôt qu’en « traducteur du fond » à l’image de Kolja Mićević et de Branimir Živojinović qui, tout en étant parfois « informatifs », travaillaient principalement sur la traduction des œuvres classiques clés pour la langue serbe. Une telle attention à la traduction sous-entend un échange constant d’idées avec les traductions sur lesquelles je travaille, une sorte de dialogue où un auteur étranger s’exprime par son œuvre et où je réponds, après traduction, par une nouvelle histoire à moi. Au final, quand il est à l’œuvre, le traducteur fait exactement comme l’auteur quand il écrit, il devient quelqu’un d’autre et prend une autre voix pour raconter une histoire.
La différence, du moins de mon point de vue, se situe dans certains aspects techniques : je me libère avec plus d’aisance d’une traduction terminée (après un premier jet vient la mise en forme définitive du texte) que d’une nouvelle que j’ai écrite. Couchée sur le papier, une nouvelle doit mûrir, et moi lui revenir, lui ôter tout ce qui me paraît superflu ; parfois procéder à sa réécriture, à un total changement de sa structure ̶ce que je n’ai clairement pas le droit de faire s’agissant d’une traduction. Il arrive qu’il n’en reste plus rien, mais une fois que je la proclame parfaite, je ne la modifie plus. Par ailleurs, afin d’écrire une histoire, il m’est nécessaire que quelque part en moi – où se trouve ce « quelque part », je ne le sais toujours pas – sa première phrase prenne forme, et peu importe si, à cet instant, j’ai ou non idée de ce que cette nouvelle doit être. Après cette première phrase, tout coule naturellement, le plus souvent je ne suis qu’un scribe sous la dictée mais qui ne craint pas non plus, quand besoin est, et quand besoin n’est pas, de noter son commentaire.
► Comment es-tu parti ?
♦ Il me semble aujourd’hui que le fait de m’en aller – en octobre 1994 – ne m’a rien inspiré du tout ; simplement, je l’ai dit, parce que je ne pensais pas que ce pouvait être pour longtemps. Je croyais que nous serions de retour un an plus tard, au terme de la résidence d’écrivain (writer-in-residence) que m’avait offerte l’université de Calgary, et cela me rassurait. Ensuite, cette année passée, quand nous avons décidé finalement de rester, il était trop tard pour éprouver quoi que ce soit – un bien, car cela aurait débouché sur la nostalgie, la pire douleur qui puisse affliger quelqu’un loin de chez lui. Mais il y avait autre chose : au cours des années 1990, jusqu’à mon départ, j’avais fait de fréquents voyages à l’étranger, surtout dans le cadre de mes activités à l’Union des communautés juives de Yougoslavie dont j’étais alors le président. La plupart de ces déplacements, à cause des célèbres « sanctions injustes » se faisaient via l’aéroport de Budapest, et chaque passage de la frontière, chaque confrontation à la froideur, à la malveillance que l’on me témoignait m’attristait profondément. Il était difficile, quasiment impossible, de ne pas se sentir un homme de seconde zone, une sorte de déchet humain, une pestilence ambulante. Naguère, me disais-je, les juifs étaient stigmatisés par le port d’une étoile jaune, et aujourd’hui les Yougoslaves le sont par leur passeport rouge. De même qu’un bref coup d’œil à l’étoile jaune suffisait au curieux pour comprendre qu’il avait affaire à un vil juif, un seul et même coup d’œil au passeport rouge indiquait au douanier (ou au policier des frontières, au réceptionniste à l’hôtel, à un employé de banque…) qu’il était en présence d’un lépreux indigne de tout respect. En d’autres termes, quand s’est présenté à moi l’occasion de m’éloigner quelque temps (ce que j’imaginais d’abord) de cette région pestiférée, je l’ai accueillie à bras ouverts. Je ne voulais pas fuir ce malheureux pays qui se noyait dans son propre poison mais juste m’en éloigner, prendre du repos et recouvrer ma dignité, le droit qui était le mien de regarder librement n’importe qui dans les yeux.
► Et qu’as-tu trouvé à ton arrivée ?
♦ Le monde de la culture nord-américaine ne m’était pas étranger, je l’ai dit. J’étais venu plusieurs fois déjà en Amérique auparavant, et pendant l’automne 1986 j’avais passé quatre mois dans l’Iowa et participé aux Rencontres internationales des écrivains. En 1994, je n’ai donc souffert d’aucun stress culturel ou social comme, souvent, les nouveaux arrivants. Le choc le plus important que j’ai reçu n’était aucunement lié à aucun aspect de ce nouveau monde, mais à celui que j’avais laissé derrière moi. Je me suis subitement retrouvé dans un océan de calme et de paix. Mes journées qui, à Belgrade, n’étaient que courses effrénées aux provisions, sonneries incessantes du téléphone, respect des délais impartis pour les livres et traductions à remettre, subitement, et du jour au lendemain, devinrent à Calgary des journées paisibles dont j’étais le seul maître, au cours desquelles je pouvais commodément disposer de mon temps libre. Je me sentais, d’un côté et simultanément, dans la peau de quelqu’un qui a pour de bon réalisé son rêve le plus cher, et de l’autre côté un toxicomane privé de sa dose régulière de narcotique. Je tremblais dans l’attente d’un coup de téléphone (le téléphone qui, chez nous, est resté muet pendant des jours), d’une lettre (le facteur ne déposait dans notre boîte que des publicités et des factures), je guettais un coup de sonnette (seuls les Témoins de Jéhovah nous rendaient visite). Je dirais simplement qu’il m’a fallu du temps pour me mettre en tête que j’avais désormais tout loisir pour me consacrer à tout ce que je voulais faire ; une fois cela compris, j’ai commencé à considérer différemment mon absence du monde dans lequel je vivais auparavant. Je me suis affranchi de ma dépendance, j’étais « clean », je pouvais m’asseoir et me remettre à écrire. Et c’est ce que j’ai fait : je me suis assis et remis à écrire.

Centre-ville de Calgary
► Ton départ au Canada aura eu un effet intéressant sur la réception de tes livres par les lecteurs serbes. D’un auteur qui, dans la première phase (yougoslave) de son travail, passait quand même pour un écrivain d’un genre très précisément défini, qui était lu par des gens aux intérêts similaires – pour la plupart, d’autres écrivains –, un écrivain, donc, à la poétique nettement différenciée, reconnue surtout par la jeune critique (à laquelle j’appartenais moi aussi) et par un public relativement restreint, tu es devenu, avec tes livres écrits au Canada, quelqu’un qu’on lit beaucoup dans toutes les couches des lecteurs et indépendamment des affinités que ceux-ci affichent. L’attribution du prix NIN pour l’Appât (1996) y a certes contribué. Ce revirement dans l’intérêt du public demeure jusqu’à un certain point une énigme pour moi. Un écrivain élitiste, exclusif, peu audible, sans conjoncture thématique, étranger à quelque affaire que ce soit, éloigné du battage médiatique (je sais ton aversion pour la télévision), publie brusquement ses œuvres complètes et se voit décerner le prix du livre le plus lu de l’année par la Bibliothèque nationale de Serbie. Comment vois-tu ce changement dans la réception de tes livres ?
♦ Je ne peux expliquer cette volte-face dans l’intérêt que le lectorat au sens large porte à mes livres, mais j’ai la certitude que jamais cela ne se serait produit sans l’obtention du prix NIN. Que cela nous plaise ou non en tant qu’écrivains, les prix littéraires ont ce pouvoir, ce qui s’est vérifié une multitude de fois tant au plan national qu’international. Porté par la publicité et la promotion qui a été faite (car c’est bien là, n’est-ce pas, le but ultime d’une récompense ?), et cela vaut aussi pour n’importe quelle production, le public s’est décidé à tenter le coup et à acheter le livre que l’on vantait. Voilà comment « se découvrent » les écrivains qui, comme tu le disais, jouissent d’un certain renom parmi les autres écrivains et chez les critiques, mais sans être lus plus que ça. J’ignore s’il existe une autre explication mais je suis persuadé de n’avoir pas changé le moins du monde en tant qu’écrivain, et donc que L’Appât ne sort absolument pas du cadre de ma poétique. Néanmoins, il m’a fallu modifier autre chose : ma manière d’aborder le public. La première fois où j’ai fait face à un nouveau cercle de lecteurs (lors d’une série de rencontres promotionnelles en Serbie et au Monténégro au printemps 1997), je me suis laissé emporter par l’enthousiasme et je leur ai dit qu’ils avaient en fait lu un livre non écrit sur ma mère. (Ce qui, au fond, était mon dessein dans L’Appât.) Et j’ai vu quantité de visages stupéfaits qui tous disaient : « Mais qu’est-ce qu’il raconte, on a bien vu que c’était un livre sur sa mère ! ». Expliquer ne servait à rien, expliquer était inutile, il me fallait, je l’ai compris, cesser de parler du postmodernisme ; ce que j’ai fait, du moins devant mes lecteurs. À vrai dire, je suis encore et toujours un postmoderne endurci, mais je le dissimule comme je le ferais de quelque secret maçonnique. Un autre facteur a joué un rôle, et il me semble que nous l’avons déjà mentionné : la tendance des lecteurs à prendre entre les mains un roman de préférence à un recueil de nouvelles, y compris quand il s’agit d’un roman court, écrit en vérité comme une nouvelle. Que d’autres éléments aient également joué un rôle est fort possible, mais d’autres le verront mieux que moi. J’ai trouvé tout ce tapage autour de L’Appât quelque peu choquant, et il m’a même quelque temps contraint à tourner le dos à mon refus obstiné de paraître à la télévision. J’ai repris aujourd’hui mon attitude « d’hostilité » à son encontre, je ne nie pas sa force de persuasion mais me révulse sa conviction aveugle que le monde existe grâce à elle, et non elle grâce au monde.
► Sûrement parce que nous ne nous rencontrons plus plusieurs fois dans la semaine comme au début des années 1990 mais une fois tous les deux trois ans, que nous ne pouvons le vérifier au cours d’une conversation et qu’il y a toujours quelque chose de plus pressant à dire dans un échange de correspondance, mais je continue de penser que ton départ au Canada et que ton existence dans ce pays a eu de profondes répercussions sur ce que tu écris. Tu as révélé ton intérêt pour la forme longue qui, avec le temps, qu’on le veuille ou non, est reconnue comme étant le roman ; or, dans ces romans, alors qu’elle était déjà fortement présente auparavant, et conformément à tes nouvelles conditions de vie, s’est de nouveau posée la question de l’identité. Brusquement tu t’es lancé dans des interrogations sur des sujets qui ne t’intéressaient nullement dans les phases précédentes de ton œuvre, je veux parler avant tout de la politique et de l’Histoire. Nous avons déjà abordé ces questions mais je me demande, et je te le demande à toi aussi, si ces sujetslittéraires dits forts (quoique tu les relativises)exigent une forme littéraire plus longue. Parle-moi de cette forme, du méga-paragraphe long, inarrêtable, de la syntaxe qui coule ininterrompue jusqu’à l’épuisement de son énergie intérieure, ce qui est le contrepoint à ton intérêt pour la concision absolue dont tu as quand même fait l’une de tes constantes durables de ton travail d’écrivain.
♦ Arriver au Canada aura contribué, chez moi, à une certaine libération du rôle que l’écrivain doit, bon gré, mal gré, jouer dans le contexte de sa littérature. D’où, je présume, ma liberté de me consacrer plus amplement à la forme longue, même si je m’y étais déjà essayé avant mon départ dans Le Livre court [Kratka knjiga]. Je me rends compte aujourd’hui que Le Livre court et L’Homme de neige, mon premier roman « canadien », ne sont pas définis dans le temps et dans l’espace, ce que j’interprète comme l’incapacité du narrateur à s’orienter dans le temps et dans l’espace, comme une réaction au chaos dont mon (notre) monde jusqu’alors ordonné était la proie. Dans les livres ultérieurs, les choses et les événements sont définis avec plus de précision, mais c’est là tout simplement ce qu’exige l’Histoire. Je ne pense cependant pas que mon intérêt pour l’Histoire soit totalement insolite ; au premier plan m’intéresse l’instant, le segment de la vie qui fait partie du quotidien. Une fois l’Histoire vécue devenue partie du quotidien, écrire sur elle signifie en réalité écrire ainsi qu’on le faisait jusque-là : décrire ce qui se passe. Ce n’est pas moi qui ai changé (du moins, je le pense), mais la réalité qui m’entoure. Quant au long paragraphe, j’ai choisi cette forme avant toute chose parce qu’elle autorise la longueur et une ampleur plus grande dans la narration. Dans un certain sens, le long paragraphe continue d’être le fragment d’un ensemble imaginaire plus grand, d’une histoire totale, ce qui laisse intacte ma conviction que je n’ai pas trahi ma poétique antérieure de fragmentation du texte en prose. (En outre, et quoique je ne l’aie jamais fait, il permet un joli gag lors d’une soirée littéraire : tu te lèves et tu annonces que tu vas lire un paragraphe de ton livre… puis tu lis tout le livre !) Le long paragraphe est donc ce qui se rapproche le plus de la forme véritable du discours humain qui ne connaît aucun partage entre paragraphes et dialogues, et qui dure tout le temps qu’il lui est possible de durer. Il est une sorte de piège pour le lecteur car s’il est relativement facile d’y entrer, en sortir est très difficile ; d’où la possibilité de le tenir pour un labyrinthe en ligne droite. (Beaucoup de lecteurs m’ont dit la difficulté qu’ils avaient éprouvée pour marquer une pause en lisant l’un de mes livres constitués d’un seul paragraphe car le texte sans interruption les incitait justement à poursuivre leur lecture.) L’idée d’écrire en de tels paragraphes longs, condensés, n’est naturellement pas de moi ; on en trouve chez Bernhard, Kafka, Faulkner, Marques, Saramago, et beaucoup d’autres. Ce genre de textes de prose est comme un rouleau compresseur : une fois lancé, rien ne peut plus l’arrêter.
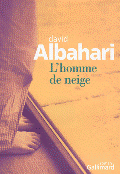
► Enfin, si fin il y a, quel regard portes-tu en cet instant sur ton œuvre littéraire ? L’imaginais-tu ainsi à tes débuts ? Quelle en est la partie essentielle selon toi ? Quels livres en marquent à ton avis les tournants ? Qu’est-ce qui dans ton esprit caractérise tes premiers recueils et romans, et quelle place ces livres occupent-ils dans ta vie ? Parle-moi de cette évolution et essaie de me dire où tu te situes à ce moment dans l’écriture.
♦ Quand je regarde en arrière, je ne parviens pas à situer l’instant où je me suis dit : « Je serai écrivain ». Peut-être qu’il ne s’est jamais produit. Quoi qu’il en soit, jamais il n’y a eu de moment où j’ai vu ma vie d’écrivain et mon œuvre devant moi, où j’ai bâti des plans pour les faire advenir, des plans auxquels je me suis ensuite totalement voué. Pour parler simplement, une chose a entraîné la suivante, mais je dois à l’honnêteté de dire qu’aujourd’hui, je ne sais toujours pas pourquoi tout cela s’est fait ainsi. Si, d’un œil « dépassionné », j’essaie de me regarder moi et tout ce que j’ai fait, je vois quelqu’un qui, tout en étant déjà pris dans le tourbillon de la vie littéraire, a consacré la majeure de son énergie à son travail (d’auteur, de traducteur, de rédacteur) et à l’amélioration du rapport chez nous, en Serbie, à la forme courte. En ce sens Description de la mort [Opis smrti] est à mes yeux mon premier livre d’importance, un livre qui, grâce au prix Ivo Andrić, a certes suscité l’intérêt des lecteurs mais conclut la première phase de mes intérêts en tant qu’écrivain. Une nouvelle phase a débuté avec Fras u šupi [Terreur au hangar] : fragmentation plus radicale encore et mise à nu du texte, liaison plus étroite avec les éléments de la « culture de masse », métatexte encore plus voyant. Cette phase s’est achevée pour moi avec le recueil Pelerina [La Pèlerine], et la suivante, toujours en cours, s’est ouverte avec mon premier roman Kratka knjiga [Le Livre court]. C’est une phase de textes plus longs, relativement plus apaisée dans son traitement de la forme et de la langue ; et, bien sûr, une phase d’intérêt pour des thèmes jusqu’alors absents de mes livres et dont nous avons bien suffisamment parlé. J’ignore si une nouvelle phase est à venir et, en toute sincérité, je m’en fiche. Quand l’envie d’écrire me prend, j’écris ; sinon, je n’écris pas. C’est là toute entière la « philosophie » de ma création. Jamais je n’ai cru qu’un écrivain avait un rôle à jouer, quel qu’il soit, sinon celui d’emboiter le pas à l’inspiration quand elle vient, si elle vient, ou de se taire si aucune ne se présente à l’horizon. Mes livres parlent de mes souffrances et de mes joies, de mes efforts pour comprendre le monde, pour sortir du labyrinthe de la conscience, pour mettre au jour la structure de la langue, pour être un instant un autre ou véritablement celui que je suis, et – vu de cette perspective – ils me rendent plus heureux. Ce qui, en ce qui me concerne, est amplement suffisant.
* Mihajlo Pantić est nouvelliste et critique littéraire. L’un de ses recueils de nouvelles est disponible en traduction française : Si c'est bien de l'amour [Ako je to ljubav], traduit par Alain Cappon, Gaïa éditions, 2007.
Traduit du serbe par Alain Cappon
Date de publication : décembre 2015
|

