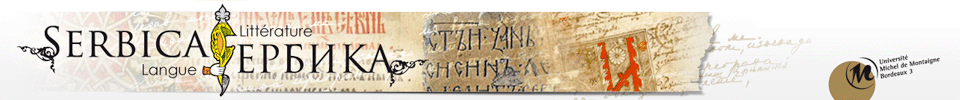|
Alain Cappon[1]
Vernantes, France
Édition et traduction
« Je t’aime, moi non plus »
Regard d’un traducteur free-lance

Allain Cappon
Résumé : En s’appuyant sur son expérience personnelle de traducteur du serbe vers le français, l’auteur tente d’analyser la relation qui existe nécessairement entre l’éditeur de littérature étrangère et un traducteur, relation qui oscille souvent entre interdépendance et intérêts… pas toujours convergents. Par ailleurs, tout en essayant de cerner les motivations qui poussent le traducteur free-lance à se lancer dans cette activité parfois bien ingrate puisqu’elle ne peut en aucune façon et d’emblée lui garantir le succès, l’auteur se penche sur les difficultés actuelles de l’édition pour laquelle la rentabilité d’une publication l’emporte fréquemment sur les considérations d’ordre esthétique.
Mots-clés : Relations éditeur-traducteur, littérature serbe, traduction et critères esthétiques, free-lance, récession, ventes, littérature et profit.
L’édition dont il sera ici question est, naturellement, celle qui a pour domaine la littérature étrangère, en l’occurrence serbe, et qui suppose le recours à la traduction afin qu’un texte écrit et publié dans cette langue soit accessible aux lecteurs qui ne la parlent ni ne la lisent. D’autres considérations viendront qui s’efforceront de donner une image de la relation qu’entretiennent éditeur et traducteur, de brosser un tableau plus global, plus affiné peut-être de ce bien curieux couple au sein duquel règne nécessairement une étroite collaboration mais où les intérêts s’avèrent parfois divergents.
L’éditeur n’est rien sans le traducteur et, oserais-je dire, vice versa. L’un et l’autre poursuivent un même objectif : donner accès au fruit de leurs découvertes à un public le plus large possible : la beauté d’un roman ou d’un recueil de nouvelles, la qualité d’un auteur et de son écriture, voire la force et le poids d’écrits, politiques ou autres, qui ne relèvent pas forcément de la littérature pure.
L’éditeur et le traducteur empruntent des chemins différents. Dans la majorité des cas, et s’agissant surtout des langues dites « petites » tels le serbe, le croate, le bulgare, etc., l’éditeur ne parle pas la langue source. Mais comment peut-il alors découvrir un livre ? De deux manières. La première, par le biais d’une traduction déjà publiée dans une autre langue européenne, très fréquemment, l’anglais ou l’allemand, l’italien ou le russe. Sa lecture ou celle de ses collaborateurs ouvrant sur une opinion favorable, et une fois la question des droits d’auteur réglée, il se tournera vers un traducteur, cette fois, de langue française, ou parfaitement bilingue, et souvent déjà reconnu sur le plan professionnel. Nous noterons au passage qu’il est tout aussi fréquent que certains livres soient « signalés » à l’attention de l’éditeur par des personnes avisées que l’on désigne par le terme anglais de scouts, des « éclaireurs » au sens quasiment propre du terme, qui vivent dans le pays d’origine et peuvent ainsi juger quels ouvrages nouvellement parus mériteraient – de leur point de vue – sinon une traduction, à tout le moins un examen plus détaillé et approfondi. D’où l’appel qui sera fait à un autre lecteur, une personne de confiance qui, très souvent, sera l’éventuel traducteur. L’autre manière de découvrir un livre est aussi, pour l’éditeur, de se le voir recommander mais cette fois par un traducteur. Nous y reviendrons.
Pour le traducteur, la situation est différente. Elle dépend de son statut, à supposer que « statut », il y ait. Car il existe deux sortes de traducteurs : celui qui, sans être l’employé au sens propre d’une maison d’éditions, est celui que nous dirons attitré pour une langue et à qui, connaissant ses qualités, l’éditeur fera immanquablement appel si besoin est. L’autre traducteur est ledit free-lance, le traducteur indépendant : c’est lui qui se met en quête d’un éditeur suite à une découverte intéressante. L’éditeur voudra, il va de soi, « juger sur pièce » et ne pas se contenter d’une appréciation flatteuse, sinon élogieuse, mais basée sur un simple avis personnel. Il faudra dès lors au lecteur-traducteur lui soumettre une note de lecture et, pour étayer son jugement, un extrait de traduction plus ou moins long.[2] Dès lors, trois issues sont possibles. La première, favorable : le projet proposé par le traducteur est accepté sans guère d’explications (au demeurant inutiles) quant aux raisons qui auront motivé cette acceptation. La deuxième, défavorable : le projet est refusé sans guère plus d’explications si ce n’est, dans le meilleur des cas, l’envoi d’une lettre stéréotypée, préimprimée où il ne reste à la personne chargée de cette tâche qu’à remplir les blancs. Je cite de mémoire : En dépit des qualités évidentes (sic) de [titre du livre] de [nom de l’écrivain], nous ne pouvons l’inclure dans nos publications. Trois issues, disais-je ? Oui, trois. Car il en est une troisième, la plus pénible, la plus blessante peut-être pour un traducteur : le silence complet. L’attente d’une réponse qui tarde, qui se fait désespérément attendre… et qui ne viendra jamais. Le traducteur aura beau relancer l’éditeur, le manuscrit restera ad aeternam en lecture ! Je le sais par expérience… Je citerai à ce propos Les Vagabonds des étoiles [Zvezdane lutalice] de Grozdana Olujić, Le Cercle amoureux [Ljubavni krug] de Vidosav Stevanović, et Cinéma dans une boîte d’allumettes [Bioskop u kutiji šibica] de Vladimir Stojšin.
Pourquoi alors être free-lance, ce qui est mon cas ? Parce que le free-lance est un passionné, et je ne cherche pas là à me couvrir de fleurs. Parce que j’ai toujours estimé que je ne saurais traduire de manière satisfaisante ce que je n’ai pas personnellement apprécié. « Il ne traduit que ce qu’il aime » a un jour déclaré – en ma présence – une éditrice avec qui j’ai beaucoup travaillé. Était-ce un reproche ou un compliment qu’elle me faisait, je ne saurais le dire. Mais aujourd’hui encore, après trente ans et plus, je ne me vois toujours pas m’atteler à la traduction d’un texte à mes yeux dépourvu d’intérêt. Traduire pour traduire, traduire avec pour toute perspective la perception de droits de traduction, au final, quelle satisfaction ?
Les refus essuyés par le free-lance sont des plus divers et ouvrent un éventail où les motivations les plus sincères : le livre proposé ne plaît pas à l’éditeur pour telle ou telle raison, le disputent aux prétextes les plus… farfelus et ridicules ! “Mais je ne peux pas publier un auteur… inconnu !” me suis-je entendu opposer au salon du Livre de Paris, ce à quoi j’ai répliqué : « Comment un auteur pourrait-il être connu si on ne le publie pas ? » « Je ne peux pas publier un auteur… décédé », m’a-t-on rétorqué à une autre occasion et en toute bonne foi alors que je proposais L’Île de Meša Selimović qui n’était certes plus de ce monde mais pourtant bien connu chez nous pour ses chefs d’œuvre Le Derviche et la mort et La Forteresse.[3] Mais le pire souvenir reste pour moi celui associé à Lagum, le magnifique roman de Svetlana Velmar-Janković. J’avais réussi à convaincre une maison d’éditions du sud-est de la France (qui n’est pas Actes Sud mais dont je n’ai nulle envie, ici, de mentionner le nom), le projet avait été accepté, les contrats (auteur, traducteur) signés, je m’étais attelé à la traduction, et j’ai appris… par l’auteur, Svetlana Velmar-Janković donc, que l’éditeur avait renoncé… sans même m’en aviser ! Qu’un éditeur finalement renonce, soit. Mais pas pour les motifs qui furent invoqués : nous étions en 1990, et au vu de la situation explosive dans l’ex-Yougoslavie d’alors, cet éditeur ne voulait pas publier… un Serbe. (Une Serbe en l’occurrence, mais inutile de chipoter.) Sans vouloir, comme on le dit dans le nord de la France, « me faire plus beau que je le suis », j’ai toujours fonctionné sur le mode confiance réciproque, respect de la parole donnée et, j’avouerai avoir éprouvé une sorte de jouissance fortement teintée de malignité quand Lagum, devenu Dans le noir[4] par son titre français, s’est classé deuxième du prix Femina étranger, avec une voix seulement de retard sur le lauréat aujourd’hui tombé dans l’oubli. Serves you right… disent les Anglais. Bien fait pour vous…
Il arrive néanmoins que le free-lance soit contacté par un éditeur. Pourquoi celui-ci plutôt que tel autre, seul l’éditeur peut répondre à cette question. Sur la quarantaine de mes traductions publiées à ce jour, quatre seulement étaient des commandes dont la dernière, Étranger dans le mariage [Sto jada] d’Emir Kusturica.[5] La première, si j’ai bonne mémoire, était Le journal de Zlata (Filipović) [6]. Il m’a fallu à l’époque travailler dans l’urgence, un délai de quinze jours m’était accordé, moyennant de coquets honoraires… avec la possibilité de les voir augmentés en conséquence si je pouvais faire le travail en une semaine, ce qui relevait de l’impossible… Le journal de Zlata est un témoignage prenant, bouleversant, sur le siège de Sarajevo, mais ce fut aussi une belle opération commerciale réalisée par l’éditeur avec, avant même la parution du livre, publicité dans les journaux et magazines, et, surtout, une interview de Zlata à la télévision française, un direct de Sarajevo dans l’émission alors fort prisée Sacrée soirée présentée par Jean-Pierre Foucault. Pendant quelques semaines le livre s’est classé parmi les meilleures ventes.
Ce qui nous amène à l’autre aspect de la relation éditeur-traducteur : le volet, disons, commercial, financier.
Si l’éditeur et le traducteur poursuivent, répétons-le, un même but : révéler un livre ou un auteur, leurs chemins divergent à un certain point. Le traducteur est rémunéré pour son travail, ce qui paraît la moindre des choses. Néanmoins, si je n’ai jamais craché sur le chèque que je recevais, je ne crois pas que l’argent soit la motivation première du traducteur. On m’a un jour commandé la traduction de l’anglais d’un livre pour enfants ; j’ai noté scrupuleusement, jour après jour, le temps (heures et minutes) consacré à cette tâche, j’ai additionné puis divisé la somme reçue par le nombre d’heures. Étant alors professeur d’anglais, il aurait été plus lucratif pour moi de donner des cours particuliers… Combien y a-t-il de traducteurs professionnels ? Combien de traducteurs vivent exclusivement de leur travail ? En ce qui me concerne, la traduction est moins une source de revenus complémentaires qu’une passion à laquelle je m’adonne sans jamais – je le répète, sans jamais – avoir la sensation de travailler. À Belgrade, un ami écrivain m’a confié avoir beaucoup écrit, selon son expression, pour son tiroir [za fioku]. Il faisait allusion aux refus que lui opposaient les maisons d’éditions pour des motifs politiques. Pour ma part, et sans que la politique entre ici en ligne de compte, j’avouerai avoir beaucoup traduit « pour mon tiroir » faute d’avoir pu convaincre des éditeurs entre autres pour Transparents [Prozraci] de Svetlana Velmar-Janković, Le [XXe] Siècle [Vek], d’Aleksandar Gatalica, Du troisième royaume [Iz trećeg kraljevsta] de Borivoje Adašević, et Baltimore [Baltimor] de Jelena Lengold pourtant récompensée par l’Union européenne. Je ne regrette rien. Sans doute mon point de vue ne sera-t-il pas unanimement partagé, mais je maintiens que la plus grande satisfaction reste pour moi de tenir entre mes mains, non pas le chèque, mais un exemplaire du livre que j’ai réussi à faire publier et qui concrétise le temps, et parfois la peine, que j’ai consacré à un auteur et à son œuvre.
Pour l’éditeur, il en va différemment. Si la part prise par le traducteur s’achève avec la remise de la traduction, commence pour l’éditeur le plus difficile. La mise en place d’un livre dans les librairies doit s’accompagner de la nécessaire publicité qui doit être faite dans les médias faute de quoi le lectorat ne sera pas informé, faute de quoi également l’espoir sera bien ténu que le livre « rencontre son public » selon l’expression. « Je continue à faire ce que je peux pour la presse qui est encore un peu paresseuse, m’écrivait la responsable de la communication d’une maison d’édition. Néanmoins, j’ai réussi à faire lire La Maison des souvenirs et de l’oubli [Kuća sećanja i zaborava] de Filip David[7] à de très nombreux libraires qui sont très enthousiastes. Le livre fait l’objet de très nombreux coups de cœur. » Le désir de faire découvrir est certes honorable mais suppose un engagement financier, une prise de risques. L’éditeur n’est pas un mécène. Les ventes doivent suivre. Sans même parler des problèmes liés au coût de l’impression, n’oublions pas que le succès même relatif d’un livre est vital pour l’éditeur. Combien de petites maisons d’éditions peinent à joindre les deux bouts, ne serait-ce, ici encore selon l’expression, à rentrer dans leurs frais ? L’an dernier, dans les semaines qui précédèrent le salon du Livre de Paris, j’avais proposé un excellent recueil de nouvelles de Saša Ilić, La Pêche aux oursins [Lov na ježeve], avec la traduction de deux d’entre elles et un résumé des autres. La lectrice de la maison d’éditions avait donné un avis favorable. « Encore des nouvelles ! » s’est écrié l’éditrice sans même avoir lu ne serait-ce qu’un mot. Pourquoi une telle réaction ? Parce qu’en France, dit-on peut-être ou sans doute à juste raison, les nouvelles ne se vendent pas, contrairement à la Serbie où, m’a assuré un autre écrivain, elles sont une sorte de « sport national ».
Dans l’édition aussi l’argent est le nerf de la guerre. À l’éventuel coup de cœur pour un livre succède une nécessaire évaluation des chances de succès auprès du public, et donc des ventes. Pour bon soit-il, un livre dont les ventes seront à l’avance jugées confidentielles ne sera pas retenu ni, par voie de conséquence, publié. J’en veux pour preuve un ouvrage concocté par Dejan Mihailović dans lequel sont réunis des textes courts, voire très courts, d’Ivo Andrić.[8] « Qui achètera ce livre ? » m’a-t-on demandé. Qu’Ivo Andrić se soit vu décerner le prix Nobel de littérature est à l’évidence un facteur très secondaire, pour ne pas dire négligeable…
Mais élargissons encore le tableau et intéressons-nous à la littérature et à l’édition au sens large.
Dans une enquête publiée récemment sur le site Serbica.fr qu’abrite l’Université Bordeaux Montaigne, une question portait sur la situation actuelle du livre et de la littérature en Serbie. Les mots et notions les plus récurrents dans les réponses appartiennent au registre de l’économie. Le livre est devenu « une marchandise », nous vivons une époque, nous dit Mihailo Pantić, « où la divinité suprême s’appelle le capital et où le moteur principal et le correcteur de toute chose existante se nomme le profit. » Stojan Đorđić nous livre cette réflexion d’une plus grande noirceur encore : « Les éditeurs qui pratiquent ‘la liberté du marché’ ont transformé l’édition en production industrielle de livres brochés [et imposé] un seul critère, un seul principe : le profit. Mais il semble que cela, déjà, ne suffise plus et qu’ils s’attachent maintenant à l’indice de rotation du capital. Nous en sommes arrivés à ce que la durée de vente d’un livre se limite à trois mois, et les livres qui demanderaient une durée supérieure sont tout bonnement exclus des réseaux de vente. »
Les ventes, le profit – tels sont les mots-clés. Non seulement en Serbie mais aussi en France et partout ailleurs dans le monde. Mais faut-il pour autant tenir tous les éditeurs pour d’odieux et insensibles capitalistes ? Je ne le crois pas. N’oublions pas leur motivation première : la volonté de faire découvrir d’autres littératures. Il n’en reste pas moins que, d’un point de vue plus général, le marché du livre (encore une expression qui relève du lexique de l’économie !) connait en France une grave récession. « Les hommes écrivent, et les femmes lisent » – me disait l’an dernier l’écrivain monténégrin Ognjen Spahić. La formule est certes plaisante mais le fait est que, partout, on lit de moins en moins. Niko knjige ovde ne kupuje. U Srbiji se više ne čita ! – Plus personne ici n’achète de livres. En Serbie, on ne lit plus, regrettait Žarko Rošulj, l’époux de la grande femme de lettres qu’était Svetlana Velmar-Janković. Très récemment, je patientais à Charles-de-Gaulle avec une trentaine de personnes dans l’attente de l’annonce de l’embarquement pour le vol Paris-Belgrade. Combien lisaient plutôt qu’avoir dans les mains un smartphone ou autre ? Une seule. Moi…[9] En France, on a annoncé pour le premier semestre 2017 une baisse des ventes de livres de pas moins de 7%. Certains livres ne sont pas mis en place ou, s’ils le sont, de manière si peu visible que le nombre des invendus ne cesse de croître et, partant, celui des retours – évidemment – facturés à l’éditeur, ce qui plombe d’autant sa trésorerie. La situation des petites maisons d’éditions est critique, certaines en sont au mieux à vivoter. Deux de mes récentes traductions, l’une du croate, l’autre du serbe[10], ont connu des ventes catastrophiques : 140 pour la première, 160 pour la seconde… à des années-lumière des 600 espérées qui auraient assuré un fragile équilibre en couvrant plus ou moins les frais engagés… Autre exemple, le récent licenciement de quatre salariés sur huit chez un autre de « mes » éditeurs. Pire encore, l’annonce dans Le Monde daté du 30 juin 2017 du placement en liquidation judiciaire des pourtant renommées Éditions de la Différence qui pouvaient se targuer d’un « catalogue de 2000 titres en littérature, essais, philosophie » et, aussi, de présenter au public cette belle collection de poésie bilingue ‘Orphée’. « Nous avons connu, dit la directrice littéraire dans son interview, deux années compliquées, en 2016 et 2017, [et] l’année électorale s’est avérée particulièrement catastrophique en librairie. » La situation n’est guère plus brillante en Belgique : un éditeur bruxellois qui avait accepté mon projet, le recueil de nouvelles Du Troisième Royaume [Iz trećeg kraljevstva] de BorivojeAdašević, déjà mentionné ci-dessus, s’est vu contraint de renoncer au vu des ventes de l’un de ses derniers livres traduit du bosniaque. « L’ex-Yougoslavie n’est plus à la mode… », m’a-t-il dit sincèrement attristé.
Édition et traduction :
« Je t’aime, moi non plus »
Pourquoi ce sous-titre emprunté à Serge Gainsbourg ? Parce qu’il illustre bien, me semble-t-il, cette étrange relation qui unit éditeur et traducteur. Quelquefois en désaccord sur l’opportunité de publier tel livre ou tel auteur, tous deux nourrissent un projet commun, sont embarqués sur le même bateau et voguent, aujourd’hui, par gros temps. Sans éditeur, il n’y a pas de traducteur, sans traducteur, il n’y a pas d’éditeur de littérature étrangère. Mais les intérêts de l’un épousent-ils les intérêts de l’autre ? Pas obligatoirement, et pas entièrement, comme j’ai tenté de le montrer. Sont-ils contradictoires ? Nullement. Plutôt interdépendants. La qualité d’une traduction permettra à l’éditeur d’envisager un éventuel succès de librairie qui, en retour, assoira la notoriété du traducteur dont d’autres éditeurs voudront, peut-être, s’assurer les services. « Éventuel », « peut-être »… Beaucoup d’incertitudes… Soit, mais n’est-ce pas là le lot de toute œuvre artistique, de toute nouveauté lancée… sur le marché ? Et revoilà notre dualité, littérature et financement, production littéraire et ventes, traduction et édition. Un autre sous-titre, sans doute plus adéquat car plus proche de la réalité, pourrait être emprunté à Aragon que chantait Jean Ferrat :
Que serais-je sans toi ?
Алан Капон
ИЗДАВАШТВО И ПРЕВОЂЕЊЕ
Поглед једног free-lance преводиоца
Сажетак : Ослањајући се на властито искуство преводиоца са српског на француски језик, аутор настоји да анализира однос који се успоставља између издавача дела из страних књижевности и преводиоца, однос који често осцилира између међузависности и интереса… који се увек не поклапају. Покушавајући да утврди разлоге који терају free-lance преводиоца да се упусти у такву једну, понекад врло незахвалну активност, која му не може одмах и ни на који начин гарантовати успех, аутор посвећује пажњу, између осталог, и актуелним потешкоћама издавача који често више држе до рентабилности једног дела него до његових естетских квалитета.
Кључне речи : Односи издавач - преводилац, српска књижевност, превођење и естетски критеријуми, free-lance, рецесија, продаја, књижевност и профит.
NOTES
[1] Passionné par la littérature serbe contemporaine dont il est l’un des « ambassadeurs » les plus assidus en France, Alain Cappon a traduit jusqu’à présent plus de quarante œuvres des écrivains serbes. Parmi les romanciers et nouvellistes qu’il a présentés au public francophone, citons en particulier Svetlana Velmar Janković, Ivo Andrić, Meša Selimović, Miroslav Popović, Grozdana Olujić, Radoslav Petković, Svetislav Basara, Dragan Velikić, Ljiljana Habjanović-Đurović, Saša Ilić, Andrija Matić. [Note du rédacteur.]
[2] Aujourd’hui certains éditeurs exigent de lire la traduction intégrale avant de donner leur avis.
[3] L’Île [Ostrvo] a fort heureusement été publiée aux Éditions Phébus en 2013.
[4] Éditions Phébus, 1997.
[5] Éditions Jean-Claude Lattès, 2014.
[6] Fixot et éditions Robert Laffont, 1993.
[7] Viviane Hamy, 2017. Ce roman a par ailleurs obtenu le Prix littéraire des jeunes Européens pour l’année 2019.
[8] Susret [Rencontre], Laguna, 2012.
[9] J’avoue ne pas avoir de portable et ne pas en vouloir ! Ce qui me vaut, de la part d’un ami serbe, le surnom de Posljednji Mohikanac, le dernier des Mohicans…
[10] Respectivement Le Cimetière englouti [Potonulo groblje] de Goran Tribuson, et La Robe de madame Kilibarda [Haljina gospođe Kilibarda] de Tiodor Rosić. (Tous deux, Serge Safran éditeur, 2015 et 2016.)
Date de publication : octobre 2019
Date de publication : juillet 2014
> DOSSIER SPÉCIAL : la Grande Guerre
- See more at: http://serbica.u-bordeaux3.fr/index.php/revue/sous-la-loupe/164-revue/articles--critiques--essais/764-boris-lazic-les-ecrivains-de-la-grande-guerre#sthash.S0uYQ00L.dpuf
|